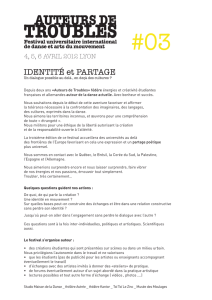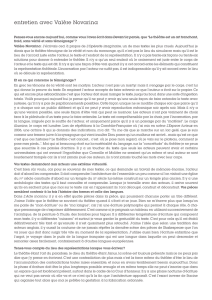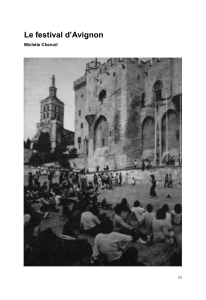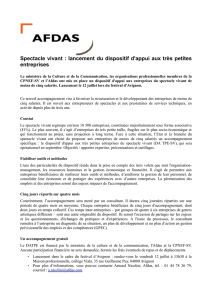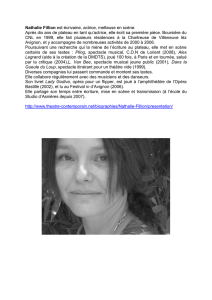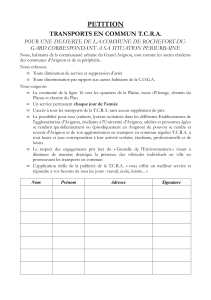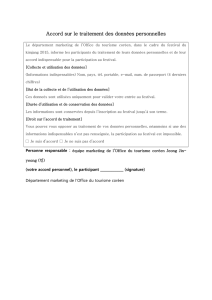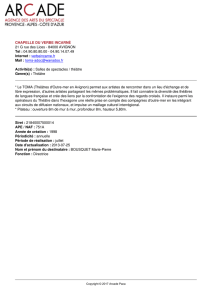Entretien avec Boris Charmatz

Festival d’Avignon
65eédition du 6 au 26 juillet 2011
dossier de presse
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------
05 Entretien avec Hortense Archambault
et Vincent Baudriller
------------------------------------
08 Boris Charmatz artiste associé
cENFANT
cLEVÉE DES CONFLITS
------------------------------------
13 Patrick Pineau
uLE SUICIDÉ
------------------------------------
16 Wajdi Mouawad
uDES FEMMES
------------------------------------
19 Anne Teresa De Keersmaeker / Rosas
c2CESENA avec Björn Schmelzer/Graindelavoix
cFASE
------------------------------------
23 Guy Cassiers / Toneelhuis
up2SANG ET ROSES, LE CHANT DE JEANNE ET GILLES
------------------------------------
27 Arthur Nauzyciel
uJAN KARSKI (MON NOM EST UNE FICTION)
------------------------------------
31 Romeo Castellucci
Socìetas Raffaello Sanzio
uSUR LE CONCEPT DU VISAGE DU FILS DE DIEU
------------------------------------
33 François Verret
cu2 COURTS-CIRCUITS
------------------------------------
35 Patrice Chéreau
uJE SUIS LE VENT
------------------------------------
39 Pascal Rambert
uCLÔTURE DE L’AMOUR
------------------------------------
42 Frédéric Fisbach
uMADEMOISELLE JULIE
------------------------------------
45 Katie Mitchell & Leo Warner
Schaubühne Berlin
upCHRISTINE, D’APRÈS MADEMOISELLE JULIE
------------------------------------
48 Meg Stuart / Damaged Goods
cVIOLET
------------------------------------
51 Rachid Ouramdane
cp2EXPOSITION UNIVERSELLE
------------------------------------
53 Christophe Fiat
upL’INDESTRUCTIBLE MADAME RICHARD WAGNER
------------------------------------
56 Angélica Liddell
u« MAUDIT SOIT L’HOMME QUI SE CONFIE
EN L’HOMME » : UN PROJET D’ALPHABÉTISATION
------------------------------------
59 Jeanne Moreau & Étienne Daho
2LE CONDAMNÉ À MORT
------------------------------------
61 Jalila Baccar & Fadhel Jaïbi
uYAHIA YAÏCH - AMNESIA
------------------------------------
65 Vincent Macaigne
uAU MOINS J’AURAI LAISSÉ UN BEAU CADAVRE
------------------------------------
68 Élise Vigier & Marcial
Di Fonzo Bo / Théâtre des Lucioles
uL’ENTÊTEMENT
upLA PARANOÏA
--------------------------------------
72 Sophie Perez &
Xavier Boussiron
uONCLE GOURDIN
uFAIRE METTRE (ACTE 2) - ÉCARTE LA GARDINE, TU VERRAS
LE PROSCÉNIUM / 25eHEURE
-----------------------------
75 Kelly Copper & Pavol Liška
Nature Theater of Oklahoma
u2cLIFE AND TIMES : ÉPISODES 1 ET 2
------------------------------------
77 Cyril Teste / Collectif MxM
upSUN
------------------------------------
80 Cecilia Bengolea &
François Chaignaud
cDANSES LIBRES
c(M)IMOSA avec Marlene Monteiro
Freitas & Trajal Harrell
------------------------------------
85 Xavier Le Roy
cLOW PIECES
cPRODUIT D’AUTRES CIRCONSTANCES / 25eHEURE
------------------------------------
88 Olivia Grandville
cLE CABARET DISCRÉPANT
------------------------------------
90 François Berreur
uÉBAUCHE D’UN PORTRAIT
------------------------------------
92 Anne-Karine Lescop
cPETIT PROJET DE LA MATIÈRE
------------------------------------
95 Thierry Thieû Niang
c… DU PRINTEMPS !
--------------------------------------
98 William Forsythe
ÈcUNWORT OBJETS CHORÉGRAPHIQUES
------------------------------------
100 Tino Sehgal
ucÈTHIS SITUATION
------------------------------------
102 Jean Michel Bruyère / LFKs
ÈLA DISPERSION DU FILS
106 UNE ÉCOLE D’ART
Jérôme Bel, Tim Etchells, Sung Hwan Kim, Philipp Gehmacher &
Vladimir Miller, Jean-Luc Moulène, Arthur Zmijewski et les « batailles »
111 LA VINGT-CINQUIÈME HEURE
Fanny de Chaillé, Sylvain George, Xavier Le Roy,
Barbara Matijevic & Giuseppe Chico, Sophie Perez & Xavier Boussiron
114 SUJETS À VIF
Jacques Bonnaffé, Eduard Gabia, David Lescot, Julie Nioche,
Bouchra Ouizguen, Qudus Onikeku, Pedro Pauwels, Guy Régis Jr
117 THÉÂTRE OUVERT / 40 ANS
Alain Françon / Naomi Wallace, Benoît Lambert / Philipp Löhle,
Frédéric Maragnani / Éric Pessan, Jean-Pierre Vincent / Sam Holcroft
123 AVIGNON créations photographiques de Stéphane Couturier
126 Territoires cinématographiques
127 Le Théâtre des idées
128 Les Rencontres européennes
129 Cycle de musiques sacrées
130 France Culture en public
131 École au Festival
132 Informations pour les spectateurs
133 Informations pratiques
134 Démarche environnementale
135 Budget prévisionnel de l’édition 2011
137 Calendrier
139 Les partenaires du Festival d’Avignon
152 Kadmos
154 Bureau de presse du Festival d’Avignon
u
THÉÂTRE
c
DANSE
p
VIDÉO PERFORMANCE
2
MUSIQUE
È
INSTALLATION
Sommaire


Entretien avec
Hortense Archambault et Vincent Baudriller
directeurs du Festival d’Avignon
Après les chorégraphes Jan Fabre et Josef Nadj, vous avez demandé à Boris Charmatz d’être l’artiste associé
du prochain Festival d’Avignon. Pourquoi ce choix ?
V. B. : Parce qu’il nous permet de regarder les arts de la scène d’un autre point de vue, grâce aux réflexions que nous avons
menées avec lui depuis presque deux ans. Après nous être intéressés à la narration avec Wajdi Mouawad, puis à la musicalité
de l’écriture avec Christoph Marthaler et Olivier Cadiot, nous voulions retrouver un chorégraphe qui, après Jan Fabre et Josef
Nadj, abordait la scène à partir du corps. Boris Charmatz, chorégraphe et danseur dont nous apprécions les créations depuis
longtemps, nous est apparu comme un artiste qui se posait la question de la place de la danse dans le paysage artistique,
en essayant de briser les codes et les cadres traditionnels de cet art. Ses réflexions sur les rapports entre l’œuvre et les
publics, entre l’œuvre et l’histoire de la danse, entre l’œuvre et la transmission d’une mémoire, faisaient de lui un chorégraphe
emblématique d’une “famille” qui a déplacé l’art chorégraphique contemporain français vers des territoires où il s’aventurait
peu, en le faisant dialoguer avec les arts visuels, en modifiant l’action des mouvements et des gestes et, plus généralement,
en s’interrogeant sur la place de cet art dans la société. Cette démarche sera également présente avec les spectacles de
Xavier Le Roy ou l’exposition et l’atelier de Jérôme Bel. Cela permettra à un public très large, dépassant le public traditionnel
de la danse, de rencontrer des créateurs qui ont aussi aujourd’hui le désir d’ouvrir leur travail au plus grand nombre.
H. A. : Boris Charmatz nous a dit qu’il avait le sentiment d’être associé au Festival depuis très longtemps, puisqu’il y venait
avec ses parents comme spectateur et que cela lui avait donné une connaissance du théâtre qui l’avait beaucoup influencé
lorsqu’il avait choisi de devenir chorégraphe.
Le corps est essentiel dans le spectacle vivant. Avec Boris Charmatz et certains artistes que vous avez invités
cette année, avez-vous le sentiment qu’il sera encore plus questionné et de manières très diverses ?
H. A. : Quand on parle avec un chorégraphe, on prend conscience que le corps peut raconter beaucoup de choses et que
son langage intéresse de plus en plus les metteurs en scène. Ceux-ci fréquentent d’ailleurs davantage les spectacles de danse
et font souvent appel à des chorégraphes pour travailler avec eux. Cela participe à un mouvement plus vaste que nous
constatons depuis des années, qui tend à abolir les frontières entre les formes artistiques, et où les différents registres
d’écritures artistiques peuvent se nourrir et s’enrichir mutuellement.
V. B. : La présence d’Anne Teresa De Keersmaeker, de William Forsythe, de Meg Stuart est la preuve que ce questionnement
sur le corps est déjà très divers à l’intérieur même de l’art chorégraphique. La question du corps est aussi très présente
chez certains metteurs en scène de théâtre comme Vincent Macaigne ou Sophie Perez et Xavier Boussiron, mais aussi chez
des acteurs comme Patrick Pineau ou Nicolas Bouchaud. La question du corps se pose doublement : pour certains le corps
modifie la parole offerte, pour d’autres la parole modifie le corps.
Comment organisez-vous le Festival entre fidélité à des artistes et propositions artistiques nouvelles ?
V. B. : Une programmation, c’est en effet le moyen de répondre aux deux besoins que nous ressentons dans les milieux
artistiques : d’un côté, permettre à des créateurs d’inscrire leurs projets dans le temps et, de l’autre, permettre à ceux qui
arrivent avec de nouveaux langages artistiques d’avoir les moyens de présenter leurs créations dans les meilleures conditions
possibles. Cette année, la programmation de la Cour d’honneur correspond bien à ce double mouvement, puisqu’elle
accueillera d’abord Boris Charmatz, qui pour sa deuxième venue à Avignon se confrontera pour la première fois à une salle
de 2 000 places, puis Guy Cassiers, souvent venu au Festival, qui la découvrira aussi et enfin Anne Teresa De Keersmaeker,
qui y était venue en 1992, et qui conviera les spectateurs à partager une expérience imaginée pour ce lieu. Dans l’ensemble
de la programmation, beaucoup d’artistes viennent pour la première fois, non seulement dans les lieux identifiés pour les
découvertes – La Vingt-cinquième heure ou Sujets à vif –, mais aussi dans de grands lieux. C’est le cas pour Vincent Macaigne,
Katie Mitchell, Nature Theater of Oklahoma, Xavier Le Roy… D’autres reviennent pour une seconde fois, comme François
Verret, Angélica Liddell, Cyril Teste, Fadhel Jaïbi et certains sont déjà des fidèles du Festival, comme les artistes associés des
éditions précédentes Wajdi Mouawad, Romeo Castellucci ou Frédéric Fisbach.
H. A. : Certains artistes incarnent pour nous une mémoire vivante du Festival dont la présence est indispensable à chaque
édition, comme un rappel de son histoire. Ce sera le cas cette année avec Jeanne Moreau, dont tout le monde sait qu’elle fut
présente lors de la première Semaine d’Art à Avignon, et avec Patrice Chéreau qui n’était pas revenu depuis 1988. Pour les
plus jeunes artistes, la question est toujours de savoir à quel moment il est intéressant pour eux de venir se présenter au
Festival, qui est un lieu très exposé et donc risqué. C’est une de nos responsabilités d’imaginer quel sera ce meilleur moment.
V. B. : Le Festival d’Avignon aura soixante-cinq ans cette année. Il doit avancer en s’appuyant à la fois sur son histoire et
sa mémoire et sur ses capacités d’invention créatrice. De la même façon qu’il y a chaque année plusieurs générations de
spectateurs dans les salles, il doit y avoir plusieurs générations de créateurs sur les plateaux. À cet égard, le retour de Théâtre
Ouvert, qui viendra fêter ses quarante années d’existence, est emblématique de ce croisement de générations puisque
Jean-Pierre Vincent et Alain Françon partagerons avec Benoît Lambert et Frédéric Maragnani les mises en espaces de textes
d’auteurs français et étrangers.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
1
/
152
100%