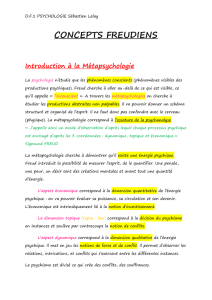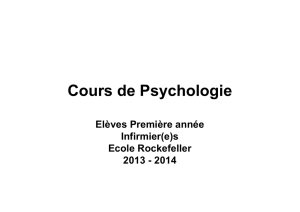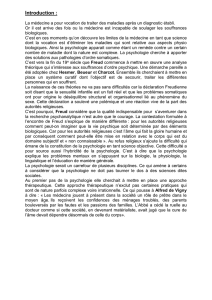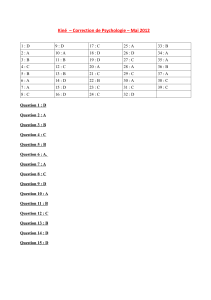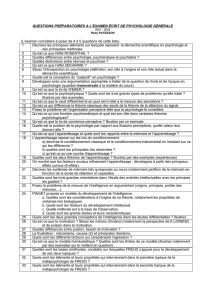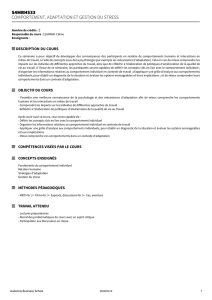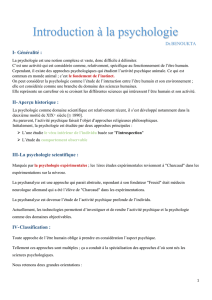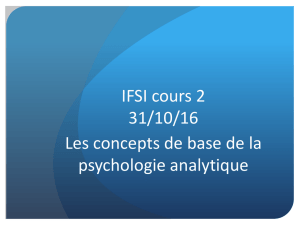Métapsychologie et neurosciences. Un point de vue

1
Métapsychologie et neurosciences.
Un point de vue
Vassilis Kapsambelis
Psychiatre et psychanalyste,
membre de la Société psychanalytique de Paris
La lecture d’articles aussi riches que ceux de Iacovos Cléopas et de Elsa Schmid-
Kitsikis mettent l’analyste qui s’intéresse au développement de la métapsychologie
dans une situation de stimulation intellectuelle. Cléopas propose une synthèse
audacieuse, qui utilise un concept issu d’une expérience différente (le concept de
transitionnalité) pour aboutir à une nouvelle formulation du monisme
métapsychologique. Schmid-Kitsikis postule que l’établissement de rapports entre la
métapsychologie et certaines autres sciences relèvent essentiellement d’une démarche
de type analogique, dont il convient de discuter le fondement épistémologique.
Sans prétendre à un texte aussi abouti et aussi bien argumenté que les leurs, qu’il me
soit permis d’exposer ici, brièvement et de façon certainement aussi subjective que
sujette la caution, la façon dont je comprends la métapsychologie freudienne, et plus
précisément la démarche freudienne, dans ses rapports avec les neurosciences de son
époque. Il me semble que ces réflexions, directement inspirées de ces deux articles,
pourrait nous permettre d’entrevoir la façon dont Freud comprenait, et la question de
l’opposition monisme – dualisme, et la question des « apports » ou du « dialogue »
entre psychanalyse et neurosciences.
Il faut sans doute commencer par le rappel de quelques éléments fondamentaux. Freud
a défini un « champ de connaissances » : le psychisme. À l’époque où il met en place
ses propres recherches, ce champ commençait progressivement à émerger comme
champ autonome, en se détachant progressivement de la philosophie. Rappelons ici
que, alors que la philosophie existe comme terme, et comme activité de recherche,
depuis l’antiquité grecque, le terme de psychologie apparaît seulement à la fin du 16
ème
siècle, et ce n’est au cours du 19
ème
siècle qu’il acquiert une consistance scientifique.

2
Freud s’intéresse à ce champ, mais se trouve dans un dilemme, dont aucun des termes
ne lui paraît satisfaisant.
D’un côté, il y a toujours la psychologie comme branche de la philosophie. Cette façon
de faire de la psychologie ne l’intéresse pas, et d’ailleurs elle n’est pas « moderne » :
le 19
ème
siècle se caractérise précisément par la séparation entre psychologie et
philosophie. Peu avant lui, d’autres chercheurs dont il connaît les travaux, de
formation initiale philosophique, ont déjà renoncé aux outils et objets traditionnels de
la philosophie pour étudier le psychisme. Tel est le cas, par exemple, de Pierre Janet,
qui décide délibérément de s’intéresser aux « automatismes », c’est-à-dire à une
activité mentale méprisée des philosophes, qui considèrent qu’elle relève davantage de
la physiologie et de la réflexologie que du psychisme spécifiquement humain. La
« découverte de l’inconscient » doit beaucoup à cette séparation de la psychologie
d’avec la philosophie : c’est en affirmant qu’une partie essentielle du psychisme
échappe à la connaissance accessible par un travail de conscience, qu’un nouveau
champ de connaissances peut émerger.
D’autre part, il a une formation initiale de neurophysiologiste. De ce fait, il ne conçoit
pas que le fait psychique puisse émerger autrement qu’en rapport avec les
mouvements de la matière vivante, et plus précisément de la matière nerveuse, comme
d’ailleurs il ne conçoit pas que ce fait psychique soit indépendant des grandes lois
biologiques qui régissent l’homme en tant que mammifère. Mais, de la même façon
que la philosophie ne lui paraît pas adéquate pour traduire le fait psychique, de la
même façon il pense qu’il serait très naïf d’imaginer une correspondance bi-équivoque
entre structures ou fonctionnements cérébraux et telle ou telle activité ou espace
psychiques. Il est intéressant de noter qu’une partie de son travail pré-psychanalytique,
celui qui porte sur les aphasies, s’emploie également à prouver que les localisations
cérébrales ne sont que d’un intérêt plutôt limité, ne donnent qu’une idée assez
grossière des troubles du langage, et que les manifestations cliniques des aphasies
nécessitent des modèles plus complexes et « associationistes » pour être précisément
décrites.
C’est pour résoudre ce dilemme entre philosophie et neurosciences (car si le terme est
récent, l’activité, elle, apparaît au milieu du 19
ème
siècle), que Freud part dans la
direction d’une « psychologie scientifique » ou « métapsychologie ». Dans ces
formulations, le « méta- » correspond au « scientifique », et vient atténuer et préciser
le terme de « psychologie » : il indique que la nouvelle théorie continue d’être une
psychologie, mais se désolidarise de l’appartenance traditionnelle de la psychologie à
la philosophie, en ayant l’ambition de rallier le domaine des sciences.

3
Examinons comment Freud réalise la synthèse de son dilemme initial.
D’une part, et étant donné qu’il s’agit toujours de construire une psychologie, une
bonne partie de son œuvre décrit effectivement des mécanismes psychologiques – ou,
plus exactement, décrit des mécanismes en termes psychologiques. Freud ne pense pas
qu’il soit possible à échéance prévisible, ou même épistémologiquement probable, de
pouvoir substituer à la psychologie – à l’étude du fait psychique – une étude des
fonctions du cerveau et plus généralement du corps. Il semble considérer qu’il est
impossible qu’une étude neurobiologique du corps humain, aussi poussée et détaillée
soit-elle, et quelle que soit l’étendue de ses découvertes, puisse rendre compte de façon
satisfaisante de tous les faits (phénomènes et mécanismes) qui font partie du champ de
la psychologie. Quelle que soit l’évolution, semble-t-il dire, on aura toujours besoin
d’une « psychologie » pour étudier le champ de connaissances qui s’appelle
psychisme. Or, cette idée reste toujours remarquablement valide. Et d’ailleurs elle est
tellement valide, que l’ « homme neuronal » des années 1990 a finalement eu besoin
de l’homme de la psychologie, en l’occurrence de l’ « homme cognitif », pour avancer
dans ses travaux, d’où l’appellation mixte de « sciences neurocognitives ».
Mais d’autre part, cette psychologie doit être « scientifique », c’est-à-dire qu’elle doit
tenir compte de l’organisation neuronale, et plus largement biologique, de l’être
humain. Quel est le sens exact de ce « tenir compte » ? C’est ici que l’on mesure
l’originalité de la solution freudienne. Elle consiste en ceci. Il faut aller chercher,
pense Freud, dans des champs de connaissances en dehors de la psychologie (la
biologie des mammifères, l’organisation fonctionnel du système nerveux central…),
certains grands principes, incontestables, fondamentaux du point de vue de
l’organisation et du fonctionnement du vivant, et de les « importer » en psychologie,
en leur trouvant un système de « représentation ». Ce point nécessite toute notre
attention. Il ne s’agit pas ici, me semble-t-il, d’une « démarche analogique » ; Freud ne
cherche pas à établir une « analogie » entre tel phénomène biologique et telle
manifestation psychique. La représentation doit être comprise au sens littéral du terme,
celui d’une entité qui représente une autre entité. Freud a hésité dans ses formulations :
tantôt c’est la pulsion qui « représente » la poussée biologique dans le psychisme,
tantôt c’est la représentation inconsciente qui « représente » la pulsion. Mais dans tous
les cas, le rapport est celui d’une représentation : de quelle façon un phénomène
(mouvement biologique, mais aussi traumatisme, facteur extérieur…) se fait-il
représenter dans le psychisme, afin de pouvoir être soumis au travail spécifique,
l’élaboration, qui caractérise cet « appareil » de l’organisme qu’est l’appareil
psychique ?

4
Nous possédons plusieurs exemples de ces « importations » freudiennes à partir des
neurosciences de son époque, suivies de leur « représentation » pour fonder une
métapsychologie. Par exemple, au niveau des lois générales du vivant : importation
des principaux instincts qui semblent gouverner la vie des mammifères, l’instinct de
conservation de l’individu (tout ce qui se rapporte à la recherche de la nourriture, à
l’autoprotection ou à la défense) et celui de la conservation de l’espèce (tout ce qui se
rapporte à la sexualité et à la reproduction). Et de fait, nous utilisons toujours les
représentations correspondantes dans notre psychologie : l’opposition fondamentale
entre objectalité et narcissisme. Par exemple, au niveau du fonctionnement
élémentaire : importation de la logique de la propagation de la charge électrique à
travers les neurones en tant qu’entité quantitative, économiquement déterminée, ainsi
que de la logique des connexions réciproques entre neurones selon des systèmes de
facilitation ou d’inhibition de la propagation. Et de fait, nous utilisons toujours dans
notre métapsychologie les notions d’investissement, de désinvestissement, de contre-
investissement, de fluidité ou de stase de la libido. Par exemple (à nouveau au niveau
général) : élaboration d’une deuxième théorie des pulsions que, malgré les évidents
prolongements anthropologiques et même philosophiques de sa conception, Freud
tient toujours à étayer avant tout sur une hypothèse concernant la nature générale des
cellules (l’opposition entre cellules somatiques, qui s’autodétruisent selon leur propre
temporalité, et cellules germinales, qui ont vocation à se perpétuer grâce à leur union
avec leurs équivalents d’autres organismes). Et de fait, nous pensons toujours les
manifestations psychiques en termes de pulsions de vie et de pulsions de mort, et
même nous considérons toujours que la destructivité propre aux pulsions de mort
concerne avant tout l’individu et seulement secondairement, par détournement, l’objet.
Par exemple (à nouveau au niveau élémentaire) : importation des connaissances sur les
différentes aires de représentation cérébrale issues des travaux de la neurologie de la
deuxième moitié du 19
ème
siècle sur les aphasies et les agnosies pour élaborer une
topologie exclusivement psychique, distinguant représentations de chose et
représentations de mot, représentations conscientes et représentations inconscientes,
ou encore perceptions et représentations – les premières issues d’excitations provenant
de l’univers qui est extérieur au psychique (les cinq organes de sens pour le monde en
dehors du corps, les perceptions proprioceptives pour ce qui concerne le corps), les
secondes issues du travail effectué entre mémoire et fantasme (schéma général qui
d’ailleurs est adopté en grande partie par les sciences cognitives contemporaines). Par
exemple (au niveau général) : considérer que si la pulsion a comme destin naturel la
recherche de satisfaction, le principe de fonctionnement du psychisme est logiquement
le principe de plaisir/déplaisir (qui ne constitue pas, de ce fait, un « couple d’opposés »
avec le « principe de réalité », comme certains psychanalystes ont pu le penser,

5
puisque ledit « principe de réalité » est au service du principe de plaisir, en tant que
garde-fou contre le déplaisir).
Est-ce que la psychologie ainsi constituée (la métapsychologie), sur la base de ces
importations, sait de quoi elle parle ? Freud répond sans hésiter : non. Nous ne savons
rien des pulsions dans leur dimension biologique, et rien également des quantités
d’excitation ou de libido. Mais sur ce point Freud a une conception assez claire.
Comme notre travail à nous, psychanalystes, reste une « psychologie », il nous suffit
d’introduire dans les équations qui sont les nôtres un « x » inconnu (la pulsion, la
quantité…) et de le reporter en tant que tel d’équation en équation : cet « x » inconnu
restera le même tout au long des opérations, ce qui ne les empêchera pas d’avancer.
Telle est, me semble-il, très exactement la place de la biologie dans la
métapsychologie selon Freud : elle y est essentiellement importée, certains de ses
principes de base deviennent, une fois dûment représentés, des principes de base de la
psychologie qui en découle, mais elle reste par ailleurs un « x » inconnu auquel la
psychologie ainsi construite ne prête qu’un intérêt somme toute assez limité,
puisqu’elle en a déjà tiré l’essentiel dont elle avait besoin pour le travail qui est le sien.
Et on pourrait ajouter que telle est, toutes proportions gardées, la place des
contributions d’autres champs de connaissances à la métapsychologie. Freud, par
exemple, pose sans autres commentaires le fait que le surmoi est construit, au départ, à
partir du père (du père réel), ce qui lui suffit pour décrire un élément d’une deuxième
hypothèse topique. Le champ de connaissances auquel il emprunte cette notion – ce
objet « père » – est manifestement l’anthropologie, chargée de nous apprendre de
quelle façon et depuis quand l’espèce humaine s’organise comme famille à trois pôles
distincts et constamment présents dans la constitution du sujet (mère – enfant – père).
Ce champ est également celui de l’histoire des religions, ou de l’étude des origines du
sentiment religieux. Freud, en tant que penseur, ne se prive pas de faire quelques
incursions psychanalytiques dans ce domaine de connaissances (par exemple la
« horde primitive », ou encore la monographie sur Moïse), comme par ailleurs il ne se
prive pas du droit de donner, ici et là, une idée concernant la biologie ou l’éthologie
humaines… Mais fondamentalement, son travail est celui d’un « métapsychologue »,
le fait que l’être humain possède une pulsion (et un père) lui suffit pour avancer ses
« équations », et s’il s’aventure dans le champ des biologistes (ou des anthropologues),
c’est davantage pour faire avancer sa métapsychologie, que pour nourrir une
éventuelle discussion interdisciplinaire.
On comprend que, de mon point de vue, la question de Freud n’est pas tout à fait celle
du monisme ou du dualisme. D’ailleurs, il me semble que toute hypothèse de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%