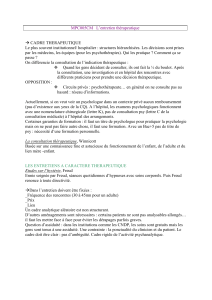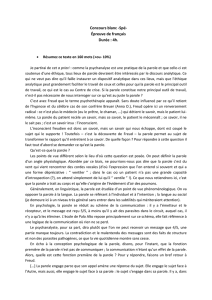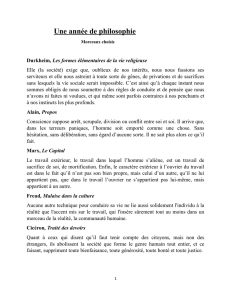Paul-Laurent Assoun FREUDISME ET INDIFFÉRENTISME

Paul-Laurent Assoun
FREUDISME ET INDIFFÉRENTISME
POLITIQUE: OBJET DE L'IDÉAL ET OBJET
DE LA DÉMOCRATIE
Le « freudisme » nous dispose-t-il à quelque « position » déterminée envers la ou le (1)
politique
?
Nous formulons ainsi la question pour faire droit à une autre, moins nuancée: peut-on
inférer de Γ expérience freudienne non seulement une explication du politique ou des lumières
sur le mécanisme sociopolitique, mais bien une position politique? C'est ici les relations de
Freud à la politique qu'il convient de (ré)interroger (2). Pourtant, elles nous intéressent pour
tout autre chose qu'un aspect de la doxa de Freud
:
comme point de départ pour formuler de la
façon la plus radicale la question du rapport du « freudisme » même à l'entendement politique.
On sait que la position de Freud envers la politique se déploie autour de deux pôles
:
un
désir originaire — infantile — à l'endroit de la politique et un abstentionnisme ultérieur à
l'égard de la « chose politique ».
« Faire de la politique », c'est cela qu'eût aimé faire Freud si... il n'avait eu à fonder la
psychanalyse! C'est ce qui se manifeste dans son ambition politique à des signes précis et
somme toute conventionnels (3).
Se tenir éloigné de la politique, c'est ce qu'a fait Freud ensuite
:
le fait qu'il ait attendu sa
soixante-quatrième année pour devenir « citoyen » de Vienne résume ce comportement.
Freud définit une position d'abstinence — compromis entre désir et abstention — envers
la politique: en consommer le moins possible, abstinence déchirée régulièrement par des
HERMÈS 5-6, 1989 345

PAUL-LAURENT ASSOUN
tentations d'en parler quand même — ce qu'exprime symboliquement son étude sur Wilson,
étrange adieu de la psychanalyse à la politique, véritable critique de l'illusion politique.
I. Une politique couleur chair
Quelle position cela donne-t-il
?
Rappelons-en les deux formules-clés, d'une translucidité
cryptée dont Freud avait le secret. A Eastman qui lui demande
:
« Qu'êtes-vous politique-
ment
?
», il répond avec aplomb
:
« Politiquement, je ne suis rien. » Au milieu d'une « dis-
cussion politique animée » où, raconte Jones, « il se vit accusé de n'être ni blanc, ni rouge, ni
fasciste ni socialiste, il répliqua en souriant
:
"Non, chacun doit être couleur chair" ou encore:
"On devrait être couleur de chair" (4) ».
Négligeons pour l'instant le conditionnel: on trouve chez Freud une revendication de
non-être, voire de non-sens politique. Quitte à se disqualifier
—
c'est une faute en notre temps
d'être hors de la politique —, Freud se ¿¿qualifie du politique. Mais cette « nullification » va de
pair avec un
impératif:
contre l'ultimatum proprement politique d'afficher une « couleur » sur
son blason, il revendique bien autre chose qu'un idéal décoloré, soit un retour à ce qui a
couleur... d'homme — point nécessairement «humaniste», au reste.
Comment cela est-il donc à recevoir
?
Freud ne se leurre pas
:
devenir couleur chair, rien ne
devrait aller plus de soi (il suffit de renoncer à tout maquillage), mais rien n'est plus difficile:
c'est pourquoi somme toute ce qui devrait être un truisme passe pour un paradoxe, voire une
provocation.
Est-ce là un « neutralisme » politique
?
On peut objecter que Freud a donné des signes
précis et non contradictoires d'engagement (5). Parlons plutôt d'« indifférentisme ». Terme
somme toute remarquable
;
tandis que Γ« indifférence » se distingue par sa négativité, le suffixe
y rajoute un caractère doctrinaire. Si l'indifférence est cet « état mental qui ne contiendrait ni
plaisir, ni douleur, ni un mélange de l'un et de l'autre » (6), l'indifférentisme serait
le parti
pris...
de n'en avoir pas.
Liberté d'indifférence prise en son sens rigoureux, selon laquelle « rien ne nous nécessite
pour l'un ou l'autre parti » (7).
Freud n'était pas neutre, puisqu'il prenait le chemin des bureaux de vote, paraît-il, quand
un candidat « libéral » — au sens de l'époque —, se présentait dans sa circonscription. Mais il
présente cette démarche comme contingente
:
non que son choix ne soit ferme et raisonné, mais
il se découpe sur le fond d'une non-nécessité. C'est un événement, jamais une nécessité de
principe.
L'indifférentisme n'est donc pas abstentionnisme paresseux ou irraisonné: c'est une
certaine position du politique. Celle-ci se laisse évaluer à partir de ce qu'il en est de la politique,
d'être de l'ordre de la
croyance.
L'indifférentisme est une certaine position envers la foi, en
346

Freudisme et indifférentisme politique
même temps qu'un refus de s'inféoder à une certaine problématique de la croyance. Le croyant
est de parti pris, il ordonne le sens à partir de l'adhésion à un objet substantiel. C'est ce que
sollicite la politique et commande l'entendement politique
:
être pour ou contre.
L'indifférentisme ne signifie pas résiliation de la foi, mais décision de sortir du chantage à la
« foi » que contient la politique. Freud sait bien que l'ignorer, ce n'est pas possible. Ce qu'il
faut, c'est la traiter comme un réel, cette part d'Anankè qu'il ne faut ni nier, ni fuir et surtout
pas...
idéaliser.
Le problème c'est que, justement, le politique touche à l'idéal
—
cela, Freud le sait par sa
théorie de l'idéalisation (8). Il faut donc croire que son savoir de l'inconscient le met en mesure
de professer cette sagesse anti-idéaliste à l'usage de la raison politique. C'est à ce titre un
anti-Wilson
:
il ne place dans la politique ni âme ni foi. C'est seulement le lieu où le gâchis coûte
le plus cher. Lieu électif du mensonge, mais aussi sans contradiction, lieu où le réel fait loi de la
façon la plus crue.
La politique est donc le lieu où l'écart de l'idéal et du réel est le plus pathétiquement
actif,
en ce sens qu'elle vit de leur confusion tout en en exigeant la disjonction.
En affichant cet « indifférentisme », Freud rend pensable une véritable thèse
:
l'objet de la
politique est vide, et c'est cet objet qui reproduit l'illusion et soutient les croyances dites
politiques.
Le « freudisme » donne vue sur ce vide, pourrait-on dire, en ce sens qu'il le met à nu. Ce
que Freud évoque à travers son « non-être politique », c'est celui de l'objet. Manière de
suggérer: «je sais qu'il est vide». Ce n'est pas prétexte à s'en évader. C'est au contraire le
réaliser totalement. Position en ce sens « cynique » — à cela près que le cynisme politique
consiste à enrober la réalité de la domination par le discours de l'idéal. Pour déterminer une
position de « citoyen contre les pouvoirs »
—
que Freud accrédite (9), il faut être passé par cette
vision du vide de l'objet. C'est pourquoi l'État n'est pas pour Freud le royaume de Dieu sur
terre,
mais l'instance qui triche sur la qualité des allumettes... (10)
Voilà le vrai défi à la politique
:
l'aborder en un lieu qui n'est pas celui de la foi, inventer un
indifférentisme vigilant à la hauteur de son cynisme.
II.
L'indifférence impossible au politique
L'indifférentisme est donc paradoxalement réponse à la question de savoir comment il est
impossible de rester indifférent à la politique ou, mieux, pourquoi la politique ne nous laisse pas
tranquille
;
pourquoi, non contente de gérer notre réalité, elle interpelle notre foi. C'est du point
de vue d'un indifférentisme ainsi conçu que la question de la croyance politique se pose de la
façon la plus incontournable.
C'est par là que je rencontre la formule étrange de Lacan, peut-être la plus révélatrice de sa
347

PAUL-LAURENT ASSOUN
propre position à l'endroit du politique
:
C'est le défi lancé dans sa conférence sur « la science et
la vérité »
:
« Qui d'entre vous écrira un essai, digne de Lamennais, sur l'indifférence en matière
de politique? (11) » C'est dans ce contexte qu'il évoque « l'agnosticisme politique de Freud »
qu'il relate à l'ordre « capitaliste ».
On remarquera le défi, lancé en 1965
:
c'est cela qu'il nous faudrait
:
une réécriture de
YEssai sur l'indifférence en matière de religion de Lamennais dans l'ordre politique. On
reconnaît la métaphore qui positionne la « matière politique » en ce lieu d'un traité imaginaire
dont pourtant, faut-il comprendre, la psychanalyse pressent l'opportunité, sinon la nécessité.
A défaut de relever le défi de Lacan, rappelons ce que le Traité de Lamennais comprenait
pour voir s'esquisser, fût-ce comme mirage, YEssai sur
Vindifférence
en matière de politique, dont
il passait commande. Manière de préciser cet « indifférentisme » prémédité qui serait l'envers
du freudisme. Traité alors intempestif
—
les acteurs de mai 68 ne semblaient pas précisément
indifférents en matière politique —, quoique dans l'après-coup, la signification de l'événement
semble avoir mis à nu les profondeurs que pouvait prendre l'indifférence en la matière,
mesurées par la désillusion, entendons le retour du réel.
Qu'on ne s'y trompe pas: le but de Lamennais est de réfuter le système de
l'indif-
férence (12). C'est donc un système d'apologétique, mais qui porte, moins que sur l'athéisme,
sur cette croyance que l'athéisme accrédite — à entendre littéralement. L'indifférence, c'est
cette foi athée qu'est la tolérance ou mieux le tolérantisme.
Il y a trois systèmes d'indifférence (13)
:
celui qui réduit la religion à une fiction nécessaire
au peuple (14) ; celui qui la réduit à une foi générale mais sans connaissance des modes du culte
— c'est la religion naturelle (15) ; enfin, celui qui admet la révélation, mais laisse à la libre
pensée le soin de l'interpréter — soit le protestantisme (16).
Lacan donc nous recommande une critique de la position indifférentiste. La politique se
soutient, faut-il comprendre, d'une foi qui se récuse, qui fait l'impasse sur l'Autre.
Le machiavélisme — qui, remarquons-le, sert de métaphore au religieux chez Lamennais
— se caractérise par cette position
:
peu me chaut la politique, elle est faite pour que l'Autre y
croie, que le peuple se prenne pour lui-même.
Le naturalisme positionne la politique comme ce Bien générique du politique en général
:
c'est, disons-le, l'humanisme.
Le protestantisme enfin, c'est dans l'ordre politique l'idée que le texte prime l'autorité, que
l'Église — entendons le Parti — est inutile.
Aucune de ces positions n'est tenable
:
je ne peux pas croire « pour de rire », l'Autre me
tient par la religion du peuple
;
je ne peux me fier à une « religion naturelle », je dois être d'une
certaine couleur; enfin, le Parti tient à l'entendement politique. On retrouve le syndrome
freudien: un individualisme, un agnosticisme et au centre une «politique couleur chair».
Celle-ci a fait son deuil, est-il besoin de le dire, de toute croyance apologétique en la consistance
de l'Autre (17): il n'empêche qu'elle cherche à penser ce qui, dans le sujet, ne peut rester
indifférent... à l'Autre. Freud invente en ce sens une forme inédite d'indifférentisme...
348

Freudisme et indifférentisme politique
A.
L'illusion politique: de la foi à l'idéal
Nous pouvons revenir par là à la position freudienne. Cette forme subtile d'indifférentisme
politique s'étaie, au plan de la théorie, sur un réseau de considérations dont il éclaire la
cohérence.
D'une part, la politique, comme la religion, renvoie à l'illusion puisqu'elle travaille dans la
Wunscherfüllung et ce rapport à l'Autre. La question se pose alors de l'avenir de l'illusion
politique qui, elle, tient au réel de l'homme. Cela éclaire, on le verra, l'engagement précis de
Freud dans la Société des Nations.
D'autre part, il
s'agit
de rendre compte de cette prise de la croyance dans la pratique
sociale, de sorte que le lien soit possible
:
c'est la fonction princeps de la thématique de Y idéal.
L'idéal soutient en ce sens la foi du « groupe » et l'attache à la réalité sociale.
Cela éclaire enfin la mise en perspective du social dans le malaise de la civilisation et le titre
auquel la politique y est intéressée. Nous avons suggéré ailleurs que cela inviterait à une
relecture de la postmodernité sociopolitique (18).
C'est, en l'occurrence, le maillon central qui nous intéressera.
Pour situer cet objet du politique, il faut faire retour à ce schéma métapsychologique du
social que Freud livre dans
Psychologie
des
masses
et
analyse
du moi
—
ouvrage-charnière entre
la référence au meurtre originaire du père comme condition symbolique du lien social (Totem et
tabou) et le diagnostic relatif au Malaise dans la civilisation, sur les mauvais « alliages » de la
pulsion de mort. Il est relevé que le social travaille dans l'idéalisation — ce qui suppose de
ressusciter le père immolé aux fins de l'idéaliser, l'idéal faisant du même coup écran, faut-il
comprendre, au travail de sape de la pulsion de mort.
Freud aborde le lien au niveau de ces « foules artificielles » dont la cohérence est assurée
par une contrainte extérieure — le prototype en étant (nous sommes en 1921) l'Église et
l'Armée. « Une telle foule primaire est une somme d'individus qui ont mis un seul et même objet
à la place de leur idéal du moi et se sont en conséquence, dans leur moi, identifiés les uns aux
autres» (19).
Pas moyen donc défaire lien sans faire passer son narcissisme dans un-objet extérieur qui
sert alors de support collectif à l'idéal du moi, en une véritable autogestion narcissique. Cette
version inconsciente du « contrat social » est ce qui rend possible l'identification réciproque.
Sans tirer ici toutes les conséquences d'un modèle dont nous avons cherché depuis quelques
années à montrer la portée (20), contentons-nous de pointer, dans ce schéma, qui met l'accent
sur la « clause d'idéalisation », une étrange lacune qui exprime la leçon freudienne relative au
nexus du social et au politique.
Qu'on consulte en effet ce schéma du chapitre VIII
349
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%