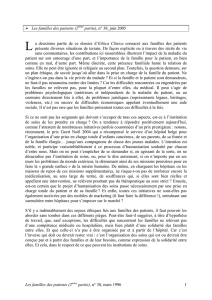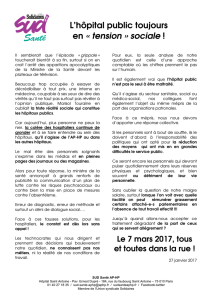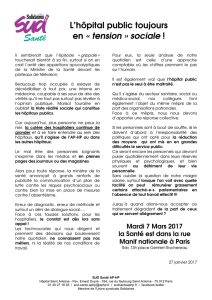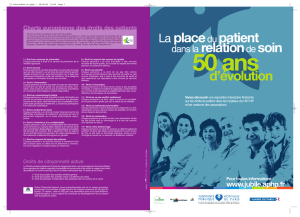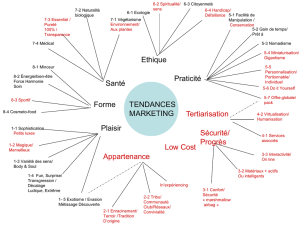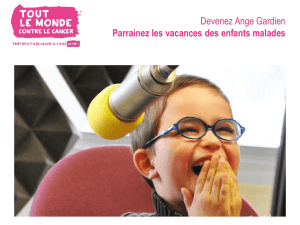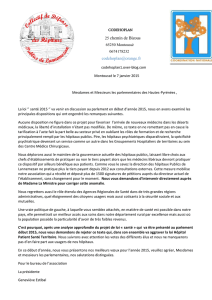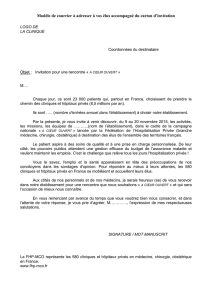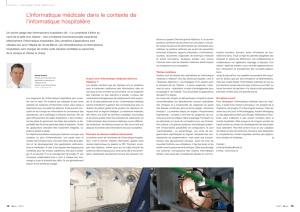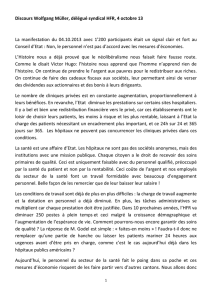Untitled


2
Sommaire
L’humanisation de l’hôpital :
de l’accueil des pauvres à la démocratie sanitaire
p.3
L’exposition itinérante :
un outil de découverte et de sensibilisation
p.4
Les thèmes des panneaux p.5
Le descriptif technique p.6
Le comité de pilotage p.7
Pour prolonger la réflexion : un DVD p.8
ANNEXES
En savoir plus
1. Eléments pour une définition de l’humanisation
2. Chronologie
3. Quelques panneaux
p.10
p.11
p.16
Renseignements pratiques
Musée de l'AP-HP
3, avenue Victoria, 75004 Paris
: 01 40 27 50 05
Mail. [email protected]
www.aphp.fr/musee

3
L'humanisation de l'hôpital :
de l'accueil des pauvres à la démocratie sanitaire
Un mouvement de réforme amorcé dès les années 1930
« L’humanisation » de l’hôpital désigne le projet de réforme profonde de l’institution
hospitalière pour tenter de l’ajuster aux mouvements de la société, à l’évolution de ses modes
de vie et de ses attentes. Amorcé dès la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales, dont la
couverture du risque maladie ouvre l’hôpital aux classes moyennes, il se confirme avec sa
transformation en service public (décret du 17 avril 1945) accessible à tous les citoyens,
désormais appelés les usagers. Car c’est à l’hôpital qu’ils bénéficient de la science médicale la
plus moderne. Pour tous et en moins de deux décennies, l’hôpital devient la référence : de la
naissance à la mort, le lieu du premier comme du dernier recours.
Une volonté politique à partir de 1958
Parallèlement à l’explosion des techniques médicales, l’institution travaille à se moderniser et
à « s’humaniser ». Le mot va, dès 1956, acquérir la dimension d’un slogan dans le cadre d’une
politique nationale. L’ampleur de ce mouvement au sein de l’histoire hospitalière du XXe
siècle, est majeure et proportionnelle à la pesanteur des héritages. Issu de l’hospice, l’hôpital
accueille toujours massivement les pauvres et les assistés jusqu’en 1945. L’arrivée d’une
nouvelle population révèle brutalement les limites d’un cadre qui appartient à un autre âge.
Tout est à repenser. Mais par où commencer et comment satisfaire en même temps aux
efforts d’investissements réclamés par la science, et à ceux exigés par l’élévation du niveau de
vie ? Comment concentrer l’attention à la fois sur la dimension matérielle de l’humanisation et
sur sa dimension relationnelle? Et comment ne pas perdre de vue la visée ultime de
l’humanisation : l’acquisition d’autres façons de parler, de regarder et d’écouter les
patients ?... Pendant ce temps, la société évolue, les malades s’organisent, les médias
dénoncent, les droits des patients prennent force de loi et la “démocratie sanitaire” fait ses
premiers pas (loi du 4 mars 2002). Le chantier de l’humanisation est permanent et ne cesse de
s’étendre, relayé par d’autres notions : « qualité », « sollicitude », « bientraitance »…, chacune
conduisant à de nouvelles applications.

4
L’exposition itinérante :
Outil de découverte et de sensibilisation
L'exposition itinérante est destinée à favoriser un éveil sur les principaux aspects de
cette histoire et à rendre largement accessible une information sur ce mouvement
majeur de l’hôpital du XXe siècle. Elle en rappelle les principales étapes, qui ont abouti
au système actuel de gouvernance des hôpitaux. Il s'agit donc d'un outil
d'appréhension du passé permettant une meilleure compréhension des
problématiques présentes et futures.
Cette exposition est une déclinaison mobile, légère et facile à monter de l'exposition
temporaire L'humanisation de l'hôpital. Mode d'emploi, présentée au Musée de l'AP-HP
du 21 octobre 2009 au 4 juillet 2010.
Elle a été conçue à partir d’une étroite collaboration avec un comité de pilotage,
composé de professionnels des hôpitaux et de représentants des usagers. Son
contenu, à la fois synthétique, clair et accessible, est adapté aux publics variés qu'elle
est susceptible de rencontrer dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux ou
instituts de formation.
L’accueil de l’exposition peut s’inscrire naturellement dans un programme de
formation ou un projet culturel organisé par les établissements de santé.

5
Les thèmes des panneaux
L'humanisation de l'hôpital. Affaire à suivre
Panneau introductif.
Un chantier sans limites ?
Un mouvement de fond, touchant tous les domaines de la vie hospitalière :
architecture, décoration, alimentation, information, etc.
Confort, bien-être
La volonté d'adapter l'hôpital aux évolutions de la société, notamment en ce qui
concerne les standards d’hébergement et de vie.
"Dire et faire" ou le best of des circulaires
La diffusion des mesures d'humanisation passe, dans un premier temps, par le
recours aux circulaires à l’attention des personnels.
Destination : les droits des malades
Le rôle joué par la législation, depuis la circulaire ministérielle du 16 mars 1945
jusqu'à la loi du 4 mars 2002.
Boîte à idées
L'humanisation à travers les premières réalisations, parmi les plus innovantes,
tantôt à l'initiative des individus, tantôt à l'initiative des institutions.
Beau fixe ?...
L'évaluation des résultats, mise en place à la fois par le Ministère de la Santé et par
les établissements de santé.
Partenaires à l’hôpital
La place et le rôle du patient et des associations dans l'organisation de l'hôpital
aujourd’hui : des partenaires investis aux côtés des professionnels pour améliorer
la qualité du système de santé.
Ensemble, inventer l'hôpital
Quelques idées pour l'hôpital de demain sur les thèmes du relationnel, des
nouvelles technologies et du partage des données.
Et pour en savoir plus…
Invitation à visiter l'exposition L'humanisation de l'hôpital. Mode d'emploi au Musée
de l'AP-HP (jusqu’au 4 juillet 2010) ou à découvrir le DVD.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%