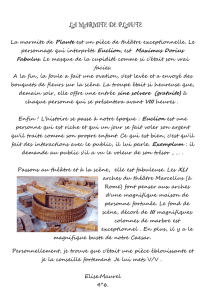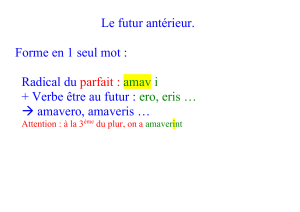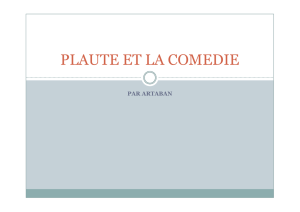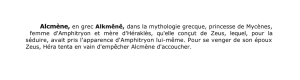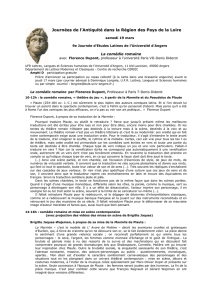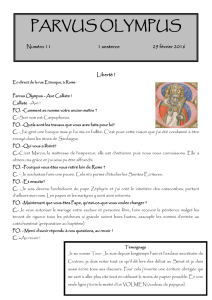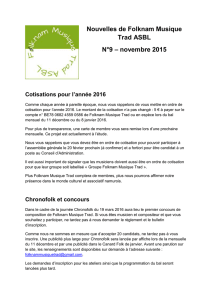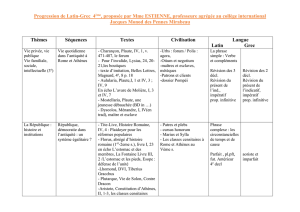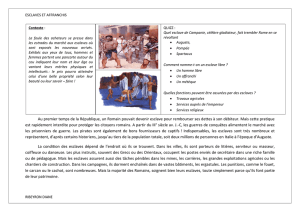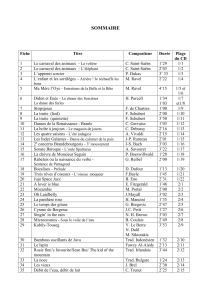1 La langue des esclaves chez Plaute : stylème - Marie

1
La langue des esclaves chez Plaute : stylème ou réalité ?
Marie-Ange JULIA, Lycée Henri IV et Centre Alfred Ernout
Le latin parlé par les esclaves dans les comédies de Plaute, tel du moins qu’il s’y
présente, offre des traits si proches de ceux des langues parlées modernes qu’on est en
droit de s’interroger sur l’intérêt historique de tels énoncés : y a-t-il réalisme ou
fantaisie ?
L’esclave est souvent le meneur de jeu, il est rusé, vantard et doué d’une exubérance
verbale prodigieuse. Ce critère a conduit à l’affirmation que la langue de Plaute serait
« une création essentiellement littéraire et que [ce serait] un contre-sens que d’en donner
une traduction trop réaliste ; loin de chercher à imiter le parler de la vie courante, le
poète stylise[rait] et transpose[rait] »1. Toutefois, quatre traits de la langue parlée par les
esclaves conduisent à nuancer une telle affirmation : la condition d’esclave se manifeste
parfois par une couleur de peau (Pseudolus est dit v. 1218 subniger) ou une langue
différente de celle parlée par les maîtres. La langue des esclaves de Plaute ne semble
être ni une fantaisie, ni même un simple stylème, mais renvoie à une certaine réalité, qui
préfigure d’ailleurs l’évolution future de la langue latine. Deux pièces l’illustrent
effectivement : le Pseudolus, qui laisse largement la parole à l’esclave Pseudolus, en
regard de ses maîtres, Calidore et Simon, et du léno Ballion ; et l’Amphitryon, qui
permettra de comparer la langue de l’esclave Sosie à celle des dieux, d’un roi et d’une
reine.
Cette réalité linguistique n’est pas sans rapport avec le genre étudié. L’échange du
maître et de l’esclave est en effet doublé d’un autre échange au théâtre : on parle de
« double énonciation », étant donné qu’un personnage s’adresse à son énonciataire
direct autant qu’aux spectateurs. La présence d’un auditoire, physiquement présent,
exerce une influence significative sur le choix des mots et sur les stratégies
informationnelles adoptées. Le public visé devait traiter l’information en temps réel et
souvent dans le bruit. Caractériser la parole des personnages contribuait ainsi à
l’identification du rôle de chacun : c’est une forme de polyphonie, phénomène rendu
possible par le fait que le locuteur-personnage est un être de discours, participant à cette
image de l’énonciation apportée par l’énoncé. Il est donc prévisible que l’on entende
dans le discours la voix d’un esclave qui a les propriétés que l’on reconnaît dans la vie
quotidienne. Oswald Ducrot a décrit ce qui se dit sur la scène non pas comme un mode
de communication spécifique, mais comme une utilisation parmi d’autres du langage
ordinaire, au même titre qu’une conversation ou qu’un discours politique2. L’esclave de
Plaute est donc un être fictif, intérieur à l’œuvre, dont la parole est conforme (nous ne
disons pas identique) à celle d’un locuteur de même condition.
1 H. ZEHNACKER et J.-C. FREDOUILLE, Littérature latine, PUF, Paris, 1993 [2001], p. 34.
2 O. DUCROT, Le dire et le dit, Les Éditions de Minuit, Paris, 1984, p. 205-206, a décrit ce qui se dit sur
la scène non pas comme un mode de communication spécifique, mais comme une utilisation parmi
d’autres du langage ordinaire, au même titre qu’une conversation ou qu’un discours politique.

2
1. Un vocabulaire différent
La comparaison tout d’abord des verbes utilisés par les esclaves et de ceux utilisés
par les maîtres permet de relever des différences importantes. Plaute utilise, par
exemple, des verbes qui n’apparaîtront pas ou très peu après lui, dans la littérature que
nous possédons. Il semblerait difficile de supposer pour chaque verbe une création de
Plaute. C’est le cas par exemple de blatire « dire, débiter en bavardant » :
(1) PLAUTE, Amphitryon 626, AMPH. Qui, malum, intellegere quisquam potis est ? ita
[nugas blatis !
« AMPHITRYON.- Comment, diantre, y comprendre quelque chose ? Tu débites de telles
sornettes ! » (trad. A. Ernout)
On retrouve ce verbe chez Aulu-Gelle (4, 1, 4), dans le cadre d’une conversation
entre un grammairien et un philosophe qui cherche à utiliser le mot propre à l’inverse
des esclaves, et chez Tertullien (De pallio II, 1). Le verbe, une onomatopée au départ,
était sans doute de très bas niveau de langue, voire appartenait à la langue d’esclaves
venus de Grèce ; le grec a βλάξ.
1.1. Les verbes employés par les esclaves sont plus souvent préverbés
De façon générale, les verbes employés par les esclaves de Plaute sont plus souvent
préverbés que ceux employés par les maîtres. On sait que la langue parlée affectionne la
préverbation : elle permet de marquer le signifiant et de faciliter sa compréhension.
Pseudolus n’hésite pas à cumuler les préverbes lorsqu’il s’adresse à Singe, un locuteur
de niveau social similaire :
(2) PLAUTE., Pseudolus 1044-1045, PS. Quid tu intus, quaeso, desedisti ? Quam diu
Mihi cor retunsumst oppugnando pectore.
« PSEUDOLUS.- Qu’avais-tu à rester là ? que tu as été long ! Mon cœur est moulu à force
d’avoir bondi contre ma poitrine. » (trad. A. Ernout)
1.2. Les verbes relèvent plus souvent de la 1ère conjugaison
Il apparaît, par ailleurs, dans les deux pièces retenues que les esclaves privilégient les
verbes relevant de la première conjugaison. La propension de la langue pour cette
conjugaison en général explique la plupart des supplétismes du français : celui de aller,
manger, porter, etc. Certains verbes de la première conjugaison sont des hapax et sont
donc sans doute des créations littéraires ; c’est le cas de potitare :
(3.a.) PLAUTE., Amphitryon 250-252 et 260-261,
SO. Perduelles penetrant se in fugam ; ibi nostris animus additust.
Vortentibus Telobois telis complebantur corpora,
Ipsusque Amphitruo regem Pterelam sua obtruncauit manu. (…)
Post ob uirtutem ero Amphitruoni patera donata aurea est,
Qui Pterela potitare solitus est rex.

3
« SOSIE.- Les ennemis prennent la fuite ; l’ardeur des nôtres en redouble ; dans leur
retraite les Téléboens sont accablés de traits. Amphitryon lui-même a égorgé de sa main
leur roi Ptérélas. (…) Après quoi pour prix de sa valeur, mon maître Amphitryon a reçu
en don la coupe d’or où le roi Ptérélas avait coutume de boire. » (trad. A. Ernout)
D’autres verbes de la première conjugaison au point 3.a. sont en revanche usuels3 :
obtruncare est employé une vingtaine de fois par Tite-Live ; on peut en déduire qu’il
s’agit d’un verbe de la langue parlée. De plus, l’expression penetrant se in fugam est
aussi intéressante, non parce qu’elle est unique mais parce qu’elle constitue une variante
de la tournure usuelle dans la prose narrative ; celle-ci d’ailleurs apparaissait quelques
vers plus haut dans une partie chantée :
(3.b.) PLAUTE, Amphitryon 238, SO. Sed fugam in se tamen nemo conuortitur.
« SOSIE.- Mais pourtant pas un ne prend la fuite. » (trad. A. Ernout)
(cf. TITE-LIVE, XXX, 18, 13, Extemplo in fugam omnes uersi).
1.3. Les verbes employés par les esclaves sont parfois des variantes diastra-
tiques, qui entreront dans des processus supplétifs
Le vocabulaire des esclaves pouvait être différent car il évoluait contrairement à la
langue écrite, en général normée, ou contrairement à la langue standardisée de l’élite
romaine. Les esclaves parlaient-ils mal exprès ou non, comme les Français qui se
revendiquent de plus en plus de telle ou telle tradition ou de telle ou telle pensée pour
dire qu’ils se réclament de cette pensée, de cette tradition4 ? De fait, plusieurs verbes
fréquemment employés par les esclaves constituent des variantes diastratiques, qui
entreront dans des processus supplétifs en latin tardif ou, plus tard encore, dans les
langues romanes.
1.3.1. sapiō
Le premier verbe concerné est assez fréquent dans les comédies de Plaute et se
trouve à l’origine du français savoir. Sapio est utilisé cinq fois dans le Pseudolus, à
chaque fois par l’esclave :
(4) PLAUTE, Pseudolus 496, PS. Desiste ; recte ego meam rem sapio, Callipho.
« PSEUDOLUS.- N’insiste pas ; je connais bien mon affaire, Calliphon. » (trad. A.
Ernout)
Meam rem sapio, comme au point 4, devait être une expression courante dans la
conversation. Celle-ci invite une nouvelle fois à penser que la langue des esclaves n’est
pas stylisée, c’est celle de la vie de tous les jours.
3 On trouve aussi perreptaui (Amphitryon 1011), verbe préverbé et de la première conjugaison alors que
le simple repere appartient à la troisième conjugaison, ludificant (Amphitryon 1047) et migro
(Amphitryon 1143).
4 J. de ROMILLY, Dans le jardin des mots, Éditions de Fallois, Paris, 2007, p. 285.

4
1.3.2. portō
On remarque également que la langue des esclaves privilégie les verbes réguliers,
alors que les maîtres emploient plus fréquemment des verbes irréguliers. Ce trait
explique la deuxième variation diastratique que l’on relève dans les pièces de Plaute.
Elle concerne le procès de « porter » un objet : les maîtres recourent au verbe ferre, les
esclaves au verbe portāre.
Cette variation révèle l’importance des interactions verbales dans l’évolution d’un
supplétisme : on trouve l’orthonyme quand les personnages sont des hommes libres, de
même niveau social ; en revanche, si le locuteur est un maître qui s’adresse à son
esclave ou son affranchi, il emploie le terme marqué, comme au point 5 :
(5.a.) PLAUTE., Miles gloriosus 1191, PA. Ego illi dicam ut me adiutorem qui onus
[feram, ad portum roget.
« (PALAESTRIO.-) Moi, je lui dirai de me demander de l’aider à porter les paquets
jusqu’au port. » (trad. A. Ernout)
(5.b.) PLAUTE, Asinaria 689-690, ...magis decorumst
Libertum potius quam patronum onus in uia portare.
« (…) Il est plus convenable que ce soit l’affranchi qui porte les paquets en chemin
plutôt que le maître. » (trad. pers.)
Cette répartition sociale a dû se maintenir longtemps car on la retrouve chez Juvénal,
chez qui les deux formes, à la troisième personne du singulier, sont voisines :
(5.c.) JUVÉNAL, 3, 251-253, Corbulo uix ferret tot uasa ingentia, tot res
impositas capiti, quas recto uertice portat
seruulus infelix et cursu uentilat ignem.
« Corbulon aurait peine à porter tant d’énormes vases et tout l’attirail que porte sur sa
tête un malheureux petit esclave, le cou raide, avivant par sa course le feu du réchaud ».
Portāre a été, en effet, longtemps limité à des idiolectes, ceux du port ou du camp,
ou ceux des esclaves à Rome. Ce n’est que dans la littérature chrétienne que la forme
portō ne semble plus être connotée5.
1.3.3. comēsse
La troisième variation diastratique concerne le procès de « manger ». Ballion, maître
qui affirme à plusieurs reprises sa supériorité hiérarchique en affectant une langue
soutenue, recourt à la forme d’impératif archaïque du tout premier verbe « manger » du
latin en s’adressant à ses esclaves, tandis que l’esclave Harpax parle des autres
esclaves en employant la forme préverbée qui est entrée en variation diastratique avec la
forme simple, au point de la remplacer dans tout le paradigme de l’espagnol par
exemple.
5 M.-A. JULIA, Genèse en latin des supplétismes verbaux des langues romanes, Peeters, Bibliothèque
d’Études Classiques n°58 (sous presse), Louvain-la-Neuve, p. 255-257.

5
(6.a.) PLAUTE, Pseudolus 139, Harpaga, bibe, es, fuge.
« (BALLION.-) Agrippe, bois, mange, enfuis-toi. » (trad. A. Ernout)
(6.b) PLAUTE, Pseudolus 1107, Luxantur, lustrantur, comedunt quod habent.
« (HARPAX.-) Ils font la noce, ils fréquentent les mauvais lieux, ils mangent tout ce
qu’ils ont. » (trad. A. Ernout)
Le choix de comēsse n’est pas neutre : il est marqué socialement. C’est un terme de
bas niveau de langue, qui est dans la majorité des occurrences chez Plaute employé par
un esclave, un marchand de filles ou une courtisane.
La troisième variation diastratique est encore le fait de Ballion, qui a la langue la plus
soutenue de tous les personnages de la pièce. C’est un maître qui s’affirme comme tel et
qui veut se donner une haute position sociale par le recours à des formes archaïques ou
désuètes : on ne trouve jamais la forme héritée et orthonymique ī « va » dans la bouche
d’un esclave (celui-ci dit le plus souvent abī), alors que Ballion emploie souvent cette
forme monosyllabique qui manque d’étoffe phonique à l’oral, même lorsqu’il s’adresse
à un esclave :
(7.a.) PLAUTE, Pseudolus 170, I, puere, prae.
« (BALLION.-) Va devant, petit ». (trad. pers.)
Cette forme est affectée, nullement spontanée dans la langue parlée par le peuple. Si
elle se trouve encore employée par des maîtres, elle ne l’est plus que dans un sens très
affaibli et elle est toujours suivie d’une autre forme d’impératif. Dans cette tournure
grammaticalisée, ī est un morphème d’ordre, jussif, qui vient renforcer, intensifier
l’impératif ; la valeur lexicale de la tournure est portée par le second verbe à
l’impératif :
(7.b.) PLAUTE, Pseudolus 349, I, gladium adfer.
« (CALIDORE.-) Va chercher une épée ». (trad. pers.)
1.3.4. ambulō ?
Une autre forme signifiant « aller » pourrait fournir un bon exemple de supplétisme
survenu dans la langue parlée par les esclaves. Il s’agit de la forme ambulās, qui
appartient au paradigme du futur verbe supplétif du français aller et que l’on trouve
dans la bouche de Sosie. Elle entre dans une construction directive normalement
contradictoire avec un verbe de mouvement intrinsèque :
(8) PLAUTE, Amphitryon 342, ME. Quo ambulas tu, qui Vulcanum in cornu
[conclusum geris ?
« MERCURE.- Où vas-tu, toi, qui portes Vulcain enfermé dans de la corne ? » (trad. A.
Ernout)
À l’époque archaïque, īre et ambulāre ne sont pas synonymes, le premier restant un
terme générique, non marqué du déplacement, le second indiquant un mouvement
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%