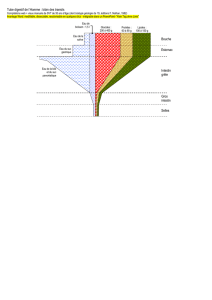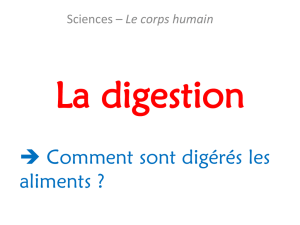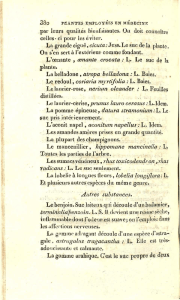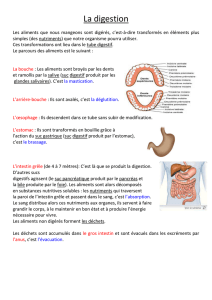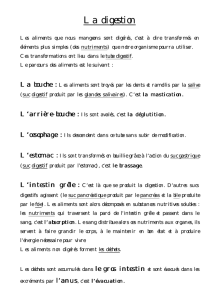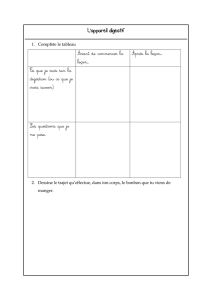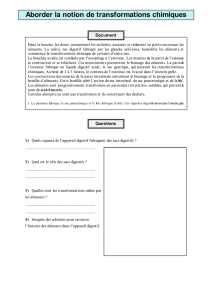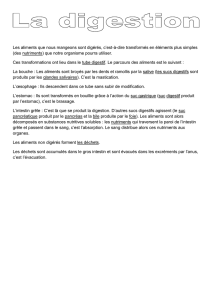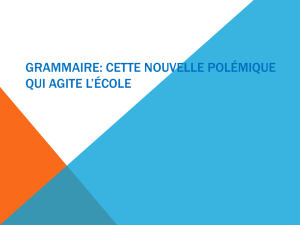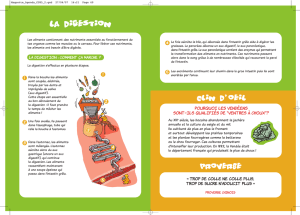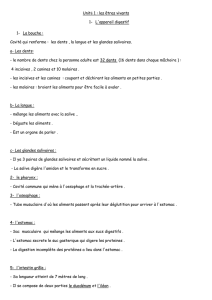Notes de cours

CNAM
TL 19900 – Intelligence artificielle
Enseignant : GENTHON Philippe
Rédacteur : LE GALLO Cédric
1 / 80

Table des matières
Contact :
GENTHON Philippe (genthon@cict.fr)
http://www.geocities.com/phgent
Ouvrage conseillé :
HATON Jean-Pierre : Le raisonnement en intelligence artificielle (InterEditions)
1. L’intelligence artificielle............................................................................. 5
1.1. Définition .........................................................................................................................5
1.2. Petite histoire de l’Intelligence Artificielle ..............................................................................5
1.2.1. Aux origines................................................................................................................5
1.2.2. La première grande avancée : le test de Turing................................................................6
1.2.3. L’Intelligence Artificielle au carrefour des sciences ............................................................7
1.2.4. Les pionniers de l’IA .....................................................................................................7
1.2.5. GPS : General Problem Solver........................................................................................8
1.2.6. Eliza et le traitement du langage naturel .........................................................................8
1.2.7. Le problème de l’explosion combinatoire .........................................................................9
Les années 1960 à 1970 .......................................................................................................................10
SHRDLU et le « Monde des blocks »........................................................................................................10
Les années 1970..................................................................................................................................10
1.2.8. Prolonger l’Intelligence ............................................................................................... 11
1.2.9. L’ère commerciale...................................................................................................... 11
2. Différences Homme/machine .................................................................. 13
2.1. Objets manipulés ............................................................................................................ 13
2.2. Sémantique du langage.................................................................................................... 13
2.3. Raisonnement sur les données .......................................................................................... 14
2.3.1. Déduction ................................................................................................................. 14
2.3.2. Abduction ................................................................................................................. 14
2.3.3. Induction.................................................................................................................. 14
2.4. La méthode scientifique.................................................................................................... 15
2.5. La méthode de Descartes ................................................................................................. 16
3. Introduction à la logique.......................................................................... 17
3.1. Disciplines de la logique ................................................................................................... 17
3.2. Notions élémentaires de logique formelle ............................................................................ 17
3.3. Quantification ................................................................................................................. 19
3.4. Les opérations logiques élémentaires ................................................................................. 19
3.4.1. La disjonction............................................................................................................ 19
3.4.2. La négation............................................................................................................... 19
3.4.3. La conjonction ........................................................................................................... 19
3.4.4. L’implication.............................................................................................................. 19
3.4.5. L’équivalence ............................................................................................................ 19
3.4.6. Utilisation des quantificateurs ...................................................................................... 19
Propriétés élémentaires ........................................................................................................................19
Propriétés utiles...................................................................................................................................20
4. Syllogismes aristotéliciens....................................................................... 21
4.1. Vérité d’une assertion P ou de sa négation .......................................................................... 21
4.1.1. Loi de non contradiction.............................................................................................. 21
4.1.2. Principe du tiers exclu................................................................................................. 21
2 / 80

4.1.3. Principe de bivalence .................................................................................................. 21
4.2. Loi de non contradiction ................................................................................................... 21
4.3. Principe du tiers exclu...................................................................................................... 21
4.4. Principe d’ambivalence..................................................................................................... 22
4.5. Logique élémentaire ........................................................................................................ 23
4.5.1. Modus ponens (notion de dépendance) ......................................................................... 23
4.5.2. Modus tollens (raisonnement par l’absurde) ................................................................... 24
4.6. Etude de l’implication....................................................................................................... 24
4.6.1. Fonctions booléennes de variables booléennes ............................................................... 24
Avec une seule variable ........................................................................................................................24
Avec deux variables..............................................................................................................................25
Avec trois variables ..............................................................................................................................25
Avec n variables...................................................................................................................................25
4.6.2. Application du modus ponens ...................................................................................... 25
4.6.3. Contraposition (miroir avec inversion)........................................................................... 26
4.6.4. Opérations élémentaires ............................................................................................. 26
Implication..........................................................................................................................................26
OU logique (non exclusif : trois 1 dans la colonne) ...................................................................................26
OU exclusif (deux 1 dans la colonne) ......................................................................................................26
Négation de l’implication.......................................................................................................................26
Négation du OU ...................................................................................................................................27 U
ET logique...........................................................................................................................................27
4.6.5. Exercice 1................................................................................................................. 28
4.6.6. Exercice 2................................................................................................................. 29
5. Logique propositionnelle.......................................................................... 30
5.1. Introduction ................................................................................................................... 30
5.1.1. Premier paradoxe ...................................................................................................... 30
5.1.2. Second paradoxe ....................................................................................................... 31
5.1.3. Cas de prémisses sans rapport avec le réel.................................................................... 31
5.2. Les propositions .............................................................................................................. 31
5.2.1. Les ebf ..................................................................................................................... 31
Démonstrations d’ebf............................................................................................................................32
Sémantique de l’ebf..............................................................................................................................32
Remarques..........................................................................................................................................33
5.2.2. Sujet et prédicat des propositions................................................................................. 34
5.2.3. Rapport entre le sujet et le prédicat.............................................................................. 34
5.2.4. Les classes de propositions.......................................................................................... 35
5.3. Les modes...................................................................................................................... 36
5.3.1. La position du moyen terme : notion de figure ............................................................... 36
5.3.2. Les modes concluants................................................................................................. 37
Modes concluants de la première figure (« modes parfaits »).....................................................................37
Modes concluants de la deuxième figure .................................................................................................38
Modes concluants de la troisième figure ..................................................................................................39
Modes concluants de la quatrième figure, dite « galénique »......................................................................39
Remarques sur les figures.....................................................................................................................39
5.3.3. Validation des modes concluants .................................................................................. 40
L'extension des termes de la conclusion ne peut être plus importante que dans les prémisses .......................40
Le moyen terme doit être universel au moins une fois dans les prémisses...................................................40
On ne peut tirer de conclusion à partir de deux prémisses particulières.......................................................40
On ne peut tirer de conclusion à partir de deux prémisses négatives ..........................................................40
Deux prémisses affirmatives ne peuvent donner une conclusion négative....................................................40
La conclusion doit être aussi faible que la prémisse la plus faible................................................................40
5.4. Conclusion sur les modes ................................................................................................. 41
6. Introduction à PROLOG............................................................................ 42
6.1. Etude de cas : les sorites.................................................................................................. 42
6.1.1. Définition d’un sorite .................................................................................................. 42
6.1.2. Sorites de Lewis CAROLL............................................................................................. 42
Premier exemple..................................................................................................................................42
Second exemple...................................................................................................................................43
6.2. Skolémisation ................................................................................................................. 44
6.3. Application de la Skolémisation à PROLOG .......................................................................... 46
6.3.1. Arbre généalogique .................................................................................................... 46
6.3.2. Notion de fonction en PROLOG ..................................................................................... 47
6.3.3. Exercice complémentaire ............................................................................................ 48
7. Arithmétique de PROLOG ......................................................................... 49
7.1. Ensemble de définition ..................................................................................................... 49
3 / 80

7.2. Opérateurs ..................................................................................................................... 49
7.2.1. Addition.................................................................................................................... 49
Définition du prédicat somme ................................................................................................................49
Utilisation du prédicat somme................................................................................................................50
Exemples d’addition .............................................................................................................................50
7.2.2. Multiplication............................................................................................................. 51
7.2.3. Factorielle................................................................................................................. 51
7.2.4. Infériorité ................................................................................................................. 51
Infériorité stricte..................................................................................................................................51
Infériorité large....................................................................................................................................52
7.2.5. Division euclidienne.................................................................................................... 52
7.2.6. Puissance ................................................................................................................. 53
7.3. Divers exemples.............................................................................................................. 53
7.3.1. Traducteur de chiffres................................................................................................. 53
7.3.2. Fonction d’Ackerman .................................................................................................. 54
7.3.3. Enigme de Syracuse ................................................................................................... 54
8. Les listes.................................................................................................. 55
8.1. Définition et syntaxe........................................................................................................ 55
8.2. Illustration du lien entre arithmétique et liste ...................................................................... 56
8.3. Concaténation de listes .................................................................................................... 56
9. Les dessins .............................................................................................. 57
9.1. Concept ......................................................................................................................... 57
9.2. Théorie de Waltz : modélisation......................................................................................... 57
9.2.1. Sept octants pleins : deux points de vue ....................................................................... 58
9.2.2. Un octant plein : sept points de vue.............................................................................. 58
9.2.3. Cinq octants pleins : trois points de vue ........................................................................ 59
9.2.4. Trois octants pleins : cinq points de vue ........................................................................ 59
9.2.5. 18 formes élémentaires (hors cas de symétries)............................................................. 59
9.3. Exemple d’application : le tétraèdre ................................................................................... 60
9.3.1. Les fourches.............................................................................................................. 60
9.3.2. Les pointes ............................................................................................................... 61
9.3.3. Les elles ................................................................................................................... 61
9.3.4. Le tétraèdre .............................................................................................................. 62
10. Théorie des jeux .................................................................................... 63
10.1. Le hasard ..................................................................................................................... 63
10.1.1. Définition ................................................................................................................ 63
10.1.2. Types de jeux de hasard ........................................................................................... 64
10.2. Etude des duels............................................................................................................. 65
10.2.1. Noyau d’un jeu ........................................................................................................ 65
10.2.2. Algorithme de recherche du noyau.............................................................................. 66
10.2.3. Duels : forme développée.......................................................................................... 68
Choix des gains....................................................................................................................................68
Algorithme du mini-max........................................................................................................................68
Algorithme
α
-
β
.....................................................................................................................................69
10.2.4. Notion de stratégie de jeu ......................................................................................... 69
10.2.5. Duels : forme normale .............................................................................................. 71
10.2.6. Duels : forme normale à double stratégie .................................................................... 78
Configuration 1....................................................................................................................................78
Configuration 2....................................................................................................................................79
Configuration 3....................................................................................................................................79
Configuration 4....................................................................................................................................79
Configuration 5....................................................................................................................................79
Configuration 6....................................................................................................................................79
Remarques..........................................................................................................................................79
Télécharger l’interpréteur PROLOG : http://www.swi-prolog.org/
4 / 80

1. L’intelligence artificielle
L’intelligence artificielle, souvent abrégée avec le sigle IA, est définie par l’un de ses créateurs, Marvin
LEE MINSKY, comme « la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui
sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisantes par des êtres humains car elles demandent
des processus mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire
et le raisonnement critique ».
1.1. Définition
Il existe différentes définitions de l’intelligence artificielle, car :
¾ L’adjectif artificielle est relativement facile à appréhender : ce type d’intelligence est le résultat
d’un processus créé par l’homme, plutôt que d’un processus naturel biologique et évolutionnaire,
¾ En revanche, la notion d’intelligence est difficile à définir :
o La capacité à acquérir et de retenir les connaissances, d’apprendre ou de comprendre
grâce a l’expérience.
o L’utilisation de la faculté de raisonnement pour résoudre des problèmes, et pour répondre
rapidement et de manière appropriée à une nouvelle situation.
o Etc.
En substance, le terme « intelligence » vient du latin :
¾ « inter » qui signifie « entre » ;
¾ Et « legere » qui signifie « lier ensemble » (historiquement, le terme legere s’applique aux épis
de blé).
En grec, nous aurions l’équivalence suivante : « syn » et « these ».
Le terme « artificielle » indique quant à lui l’opposition au « naturel » au sens de qui est créé par
l’Homme.
Les problèmes soulevés par l’intelligence artificielle concernent des domaines divers comme :
¾ l’ingénierie, notamment pour la construction des robots,
¾ les sciences de la cognition, pour la simulation de l’intelligence humaine,
¾ la philosophie pour les questions associées à la connaissance et à la conscience.
1.2. Petite histoire de l’Intelligence Artificielle
L’histoire de l’intelligence artificielle (IA) se confond avec celle de l’informatique en général. Nous
pouvons toutefois identifier quatre périodes : la pré-IA, les débuts de l’IA, l’IA d’avant les systèmes
experts, l’IA commerciale.
1.2.1. Aux origines
La préhistoire de l’IA commence au XVIe siècle, au moment où la médecine découvre progressivement
les lois de fonctionnement des principaux organes du corps humain. Le coeur est naturellement comparé
à une pompe, le poumon à un soufflet. Au siècle suivant, le perfectionnement des automates frappera les
imaginations et il deviendra naturel de penser à la possibilité de créer des mécanismes intelligents.
5 / 80
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
1
/
80
100%