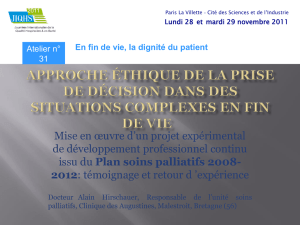Partenariat clinique entre un EHPAD et un réseau de soins

© La Revue de Gériatrie, Tome 35, N°4 AVRIL 2010 263
MISE AU POINT
Partenariat clinique entre un EHPAD et un
réseau de soins palliatifs : bénéfices et limites
Clinical partnership between an institution for elderly people
and a palliative care network: benefits and limits
Clémentine VAQUIN-VILLEMINEY, Pascale GAUTHIER, Eric PAUTAS, Pascale FOUASSIER, Inès DECASSIN
Auteur correspondant : Dr Pascale Gauthier, Unité de Soins Palliatifs
Gériatriques, Hôpital Charles Foix (AP-HP), 7 avenue de la République –
94200 Ivry-sur-Seine, France.
E-mail : [email protected]
Réseau de Soins Palliatifs Epsilon (CVV, ID), Versailles ; Unité de Soins Palliatifs
Gériatriques (PG, PF) ; Unité de Gériatrie Aiguë (EP), Hôpital Charles Foix (AP-HP),
Ivry-sur-Seine ; France.
Article reçu le 16.09.2009 et accepté le 14.12.2009.
RÉSUMÉ ________________________________________
Le cadre légal actuel en France incite à garantir
l’accès des patients âgés à des structures spécialisées
en soins palliatifs et en prise en charge de la douleur,
qu’ils soient hospitalisés ou qu’ils vivent au domicile
ou en EHPAD. Pour renforcer l’impact des textes
législatifs, deux récents plans du ministère de la
Santé ont notamment pour objectif, pour les sujets
âgés vivant en EHPAD, le développement de réseaux
de santé dont l’activité principale est axée sur la prise
en charge de la douleur ou la gestion de la fin de vie.
Cette mise au point reprend les éléments constitu-
tionnels d’une coopération entre un réseau de soins
palliatifs et un EHPAD, s’intégrant plus générale-
ment dans une démarche qualité d’un établissement.
Sont soulignés les avantages d’un tel partenariat :
soutien aux résidents et à leur famille, soutien aux
équipes soignantes et au médecin traitant qui peu-
vent être en difficulté devant une situation de fin de
vie ou la gestion complexe d’une douleur. Sont aussi
abordées les difficultés de sa mise en place, parfois
atténuées par la simple information des soignants sur
l’existence et les rôles d’un réseau de soins palliatifs,
et par la participation du réseau à la formation des
personnels de l’EHPAD.
Mots clés : Soins palliatifs - EHPAD - Réseaux -
Convention.
SUMMARY ______________________________________
The current legal framework in France incites to
guarantee the access of elderly subjects to structures
specialized in palliative care and pain management
whether these subjects are hospitalized, or living at
home, or institutionalized. To reinforce the impact of
the legislative texts, two recent plans of the ministry
for Health concerning in particular, institutionalized
elderly subjects, aim to develop heath networks
whose principal activity is centered on pain and end-
of-life management.
This article reviews the constitutional elements of a co-
operation between a palliative care network and an
institution for elderly people. Based on a quality
approach, it highlights the advantages of such a part-
nership: support for residents and their families,
support for medical teams and attending physicians,
which can encounter problems in pain and end-of-life
management. Implementation difficulties are also
discussed as well as measures that sometimes attenuate
them: information of caregivers about the existence of
the palliative care network and its roles, participation of
the network in the training of the institution’s staff.
La Revue de Gériatrie 2010 ; 35:263-269.
Key words: Palliative care - Institution for elderly
people - Networks - Convention.

© La Revue de Gériatrie, Tome 35, N°4 AVRIL 2010 264
Partenariat clinique entre un EHPAD et un réseau de soins palliatifs : bénéfices et limites
En 2006, moins d’une personne sur dix mourait
en EHPAD, alors que les enquêtes d’opinion
montrent que les français souhaitent majoritai-
rement décéder à domicile (1). En particulier, la majorité
des personnes âgées hébergées en EHPAD expriment le
choix de mourir au sein de leur structure de vie. Même
si toutes les situations de fin de vie ne nécessitent pas la
mise en œuvre de soins palliatifs, ces soins doivent
cependant constituer un droit lorsqu’ils se révèlent
nécessaires. La loi du 9 juin 1999 vise ainsi à garantir
l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement, que ce
soit au sein des institutions sanitaires ou médico-sociales
ou à domicile (2). En complément, la loi de 2002, relative
aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, reconnaît comme droit fondamental de la
personne le soulagement de la douleur, a fortiori pour
tout malade requérant des soins palliatifs (3). Enfin, la loi
Léonetti de 2005, relative au droit des Malades et à la
fin de vie, donne un cadre légal au développement des
soins palliatifs, en particulier en favorisant le développe-
ment de structures adaptées à l’intérieur même des
EHPAD (4). A ces textes législatifs, on peut ajouter l’exis-
tence de deux plans du ministère de la Santé : le plan
Douleur 2006-2010 et le plan Soins Palliatifs 2008-
2012 (5-6). La priorité du plan Douleur est d’améliorer la
prise en charge de la douleur des personnes âgées et en
fin de vie, notamment en la renforçant dans les réseaux
de santé. Alors qu’en 2008 existaient 110 réseaux avec
une activité dominante en soins palliatifs ou de lutte
contre la douleur prenant en charge environ 27 500
patients, le plan prévoit le doublement de cette activité,
avec l’amélioration de la coordination des profession-
nels. L'objectif est d'atteindre 50 000 patients pris en
charge en 2012 par la création de réseaux dans les
territoires qui n'en sont pas pourvus et avec le renforce-
ment des réseaux là où ils existent déjà (6).
L’optimisation de la prise en charge des patients en fin
de vie résidant en EHPAD passe par le développement
d’une démarche palliative au sein de l’établissement.
Celle-ci est rendue obligatoire par la circulaire du 19
février 2002 relative à l'organisation des soins palliatifs
et de l'accompagnement (7). Cette circulaire met en
particulier l'accent sur les missions et les modalités de
fonctionnement des réseaux de soins palliatifs interve-
nant au sein des EHPAD. Elle précise d’autre part que
les schémas régionaux d’organisation inciteront chaque
EHPAD à établir un partenariat clinique avec ces
réseaux.
Nous abordons dans cette mise au point, les effets posi-
tifs d’un développement du partenariat clinique entre
EHPAD et réseaux de soins palliatifs sur les soins apportés
aux personnes, mais aussi les difficultés qui peuvent être
rencontrées dans la mise en œuvre de ces dispositions.
DÉMARCHE QUALITÉ EN EHPAD ET SOINS
PALLIATIFS OU COMMENT LA CULTURE PALLIA-
TIVE SE FAIT UNE PLACE DANS LES ÉTABLISSE-
MENTS MÉDICO-SOCIAUX _________________________
L'élément nouveau introduit par la réforme de la tarifi-
cation des EHPAD est la formalisation systématique de
démarches d'évaluation et d'amélioration continue de la
qualité, dans le cadre de conventions tripartites établies
entre chaque établissement, l'Assurance Maladie et le
Conseil Général du département. Les EHPAD sont
impliqués de façon réglementaire dans une démarche
qualité appuyée sur un référentiel, qui est l’outil d’auto-
évaluation ANGELIQUE (Application Nationale pour
Guider une Évaluation Labellisée Interne de la Qualité
pour les Usagers des Établissements) (8). Ce référentiel
ANGELIQUE évoque la question des soins palliatifs à
travers 2 points :
-le premier concerne l’organisation de la continuité des
soins par le médecin coordonnateur, qui doit s’assurer
que la fin de vie au sein de l’EHPAD fait l’objet d’une
prise en charge spécifique des résidents (par exemple
soins d’accompagnement adaptés incluant la famille,
respect des convictions religieuses), et qu’il existe un
programme de formation continue du personnel
soignant ;
-le second concerne la formalisation d’une filière de
soins spécifiques (douleur, soins palliatifs ….), sous la
forme d’une convention entre l’EHPAD et une équipe
mobile ou une unité de soins palliatifs de proximité.
Une démarche palliative de qualité nécessite dans cha-
que institution, qu’elle soit médico-sociale ou sanitaire,
un investissement dans la formation d’un référent en
soins palliatifs et de l’ensemble du personnel en charge
des résidents. Il est également indispensable d’inclure la
dimension palliative dans le projet médical de l’établisse-
ment, associant l’organisation d’un soutien des
soignants, et une réflexion sur l’accueil et le soutien des
familles (7). L’enjeu pour un EHPAD est de mettre en
place une réflexion éthique sur la fin de vie de ses
résidents, en respectant leurs droits, en écoutant leurs
souhaits et ceux de leurs proches, et en permettant une
prise en charge palliative de qualité au sein de l’établis-
sement.
La mise en place d’une telle démarche palliative
nécessite aussi des compétences extérieures visant à

© La Revue de Gériatrie, Tome 35, N°4 AVRIL 2010 265
Partenariat clinique entre un EHPAD et un réseau de soins palliatifs : bénéfices et limites
situation de fin de vie. La prise en charge palliative
consiste à guider les proches tout au long de l’aggrava-
tion d’une maladie chronique incurable, en identifiant les
symptômes présents et à venir, en rassurant sur leur
prise en charge active. Cela contribue à améliorer la
collaboration avec l’équipe en charge du résident, et cela
permet de soutenir et d’accompagner l’entourage
épuisé par la durée de la maladie et angoissé par l’aggra-
vation de celle-ci. Le partenariat clinique entre un réseau
et un EHPAD permet donc de renforcer le cadre
médical autour du résident, ce qui peut avoir un carac-
tère rassurant pour les familles. Elles se retrouvent face
à une équipe complémentaire de soignants disponibles
pour les écouter, les soutenir et répondre à leur ques-
tions qu’elles soient médicales, sociales, psychologiques
ou organisationnelles. Dans ce cadre, le rôle du psycho-
logue coordinateur est de repérer les familles en diffi-
culté, de reconnaître une souffrance qui peut engendrer
l’agressivité ou la fuite vis à vis de l’équipe, et de leur
proposer un soutien. Le psychologue du réseau est éga-
lement à la disposition des familles qui se savent et se
disent en difficulté, et qui souhaitent être soutenues dans
la prise en charge de leur proche malade. Son rôle est
alors de faire une évaluation psychologique et d’orienter
si nécessaire le proche vers un confrère de proximité.
Dans les situations de fin de vie en EHPAD, les réseaux
de soins peuvent enfin sensibiliser les proches aux symp-
tômes liés à l’agonie, ce qui leur permet d’appréhender
plus sereinement la mort (10).
C’est dans ce soutien aux patients et aux familles que les
bénévoles d’accompagnement prennent le plus naturel-
lement leur place. De nombreuses associations de bénévoles
existent en France, dont les deux tiers sont regroupées au
sein de l’UNASP (Union Nationale des Associations pour
le développement de Soins Palliatifs) ou de la fédération
JALMALV (Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie) (11).
Ce mouvement associatif a d’ailleurs été souvent à l'ori-
gine de la prise de conscience des professionnels de
santé de la nécessité du développement des soins palliatifs.
Le plan soins palliatifs 2008 - 2012 prévoit d’ailleurs de
former 7 000 bénévoles par an (6). Les réseaux de soins
palliatifs signent des conventions avec ces associations
et peuvent donc faciliter l’action des bénévoles dans un
EHPAD, en accord avec l’équipe de la structure.
L’intervention des bénévoles dans un EHPAD est régie
par une convention (12).
Soutien à l’équipe soignante de l’EHPAD
La plupart des EHPAD souhaitent accueillir leurs rési-
dents jusqu’au décès, mais ce souhait est parfois difficile
à réaliser sur le plan pratique devant l’émergence d’obs-
tacles variés : épuisement professionnel des soignants,
améliorer le travail des soignants, aides spécifiquement
apportées par les membres d’un réseau de soins palliatifs
(soignants experts, psychologues ou bénévoles d’accom-
pagnement) (9). Les réseaux de soins palliatifs sont
chargés de coordonner l'action des soignants et des
équipes mobiles prenant en charge un patient atteint
d'une maladie grave et potentiellement mortelle. Ils per-
mettent le respect du désir des patients en ce qui
concerne le choix du lieu de prise en charge et prennent
également en compte les capacités de l’entourage à
accepter ce choix.
AVANTAGES D’UN PARTENARIAT ENTRE UN
EHPAD ET UN RÉSEAU DE SOINS PALLIATIFS
Un travail de concertation avec un réseau de soins
palliatifs peut apporter, au sein d’un EHAPD, les sou-
tiens nécessaires au patient et sa famille, aux soignants
et au médecin traitant.
Soutien au résident et à sa famille
Au cours de leur séjour dans un EHPAD, les résidents
sont fréquemment confrontés aux décès successifs d’au-
tres patients institutionnalisés. Ils sont donc fragilisés
psychiquement par la réalité de leur finitude au travers
de cette expérience de la mort. De plus, il peut exister
un isolement social expliquant la rareté ou la pauvreté
d’un soutien par les échanges avec les proches.
L’implication d’un réseau de soins palliatifs dans
l’EHPAD permet de détecter les résidents en difficulté et
de leur proposer, entre autres choses, de rencontrer la
psychologue coordinatrice dans le cadre d’un suivi de
deuil.
Le réseau peut aussi aider l’EHPAD à mettre en place
une information des résidents sur leur droits, en particulier
sur la possibilité de désigner une personne de confiance,
en ayant même éventuellement un rôle d’aide au choix
de cette personne de confiance. Cette démarche peut
permettre aux résidents de préparer les conditions de leur
mort, de recueillir leurs directives anticipées et, par la
même, d’évoquer leurs souhaits, leurs refus, et de les
rassurer sur la capacité de l’institution à les accompa-
gner jusqu’au bout de leur vie.
Les réseaux de soins palliatifs ont également pour
mission de soutenir et d’accompagner les proches du
malade résidant en EHPAD. L’accompagnement est
d’abord inscrit dans le cadre de l’information faite aux
familles sur l’évolution d’une situation médicale. En effet
il est primordial d’aider un proche à reconnaître une

© La Revue de Gériatrie, Tome 35, N°4 AVRIL 2010 266
Partenariat clinique entre un EHPAD et un réseau de soins palliatifs : bénéfices et limites
d’antibiothérapie de malades en fin de vie….). La colla-
boration avec un réseau de soins palliatifs peut enrichir
ces discussions sur le travail de l’équipe, et aider à
clarifier et argumenter la décision retenue auprès des
soignants, afin que l’équipe adhère à la cohérence du
projet de soins, après que chacun ait pu exprimer son
point de vue. Lors des réunions de relecture de cas
cliniques ou de cas éthiques, sont repris des cas com-
plexes, analysés “à froid”. Le réseau de soins palliatifs
peut animer ces réunions et apporter une expertise exté-
rieure. Les thèmes abordés sont proposés selon les
besoins de l’EHPAD. Enfin, le réseau organise des réu-
nions post-décès afin de permettre à chacun d’évoquer
les difficultés rencontrées lors de la prise en charge ou
d’oser verbaliser ses émotions ou ses interrogations
restées sans réponse au moment du suivi du résident.
Le réseau de soins palliatifs peut aussi assurer un soutien
technique à l’équipe soignante de l’EHPAD. Les infir-
mières des réseaux de soins se rendent disponibles
auprès des équipes soignantes en tant que conseillères et
non en tant que soignantes à proprement parler. Elles
peuvent ainsi être amenées à prodiguer des conseils sur
les soins de bouche, à discuter autour des protocoles de
pansements d’escarre ou encore à participer à l’évalua-
tion de la douleur d’un patient. Ces conseils peuvent être
donnés par téléphone ou directement au lit du malade.
Enfin, la formation initiale et continue de l’ensemble des
acteurs concernés par les soins palliatifs, et en particulier
le personnel des EHPAD, constitue l’un des leviers essen-
tiels pour garantir l’accès de tous à des soins palliatifs de
qualité. La formation au sein d’un EHPAD a un triple
objectif : permettre un apprentissage théorique homo-
gène au niveau de l’équipe en termes de connaissances
cliniques, psychologiques et éthiques des patients en
soins palliatifs, apprendre à se connaître, et encourager
chaque soignant à prendre la parole. Sensibiliser l’en-
semble de l’équipe n’est pas toujours facile. Il convient
de choisir le meilleur créneau horaire et un rythme
adapté, ce qui oblige les réseaux de soins qui organisent
les formations à intervenir de façon répétée afin de tou-
cher l’ensemble du personnel. Les thèmes à aborder
correspondent aux besoins des équipes soignantes de
l’établissement. Les sujets les plus demandés sont : la
prise en charge de la douleur, les soins de bouche, la
prise en charge des symptômes de fin de vie, la réflexion
éthique en fin de vie autour de l’arrêt de la nutrition et
de l’alimentation, et la mort. Face à l’importance des
attentes des professionnels, des personnes malades et
des familles, la Direction Générale de la Santé a initié et
confié, en juillet 2002, à la Société Française de
Gériatrie et Gérontologie, en lien avec l’ensemble des
anxiété des équipes devant une complication
aiguë, difficulté d’accès au plateau technique, disponi-
bilité du personnel face à la souffrance des familles,
manque de personnel. Le travail en étroite collaboration
avec les structures complémentaires, type réseau de
soin, permet de lever certains obstacles en collaborant
avec l’équipe du réseau pour les soins techniques et la
prise en charge des symptômes. L’équipe soignante de
l’EHPAD peut déléguer une partie de la prise en charge
au réseau, qui est souvent plus disponible.
La prise en charge de résidents en fin de vie nécessite
souvent de la part des soignants un investissement
important face à des situations exigeantes. Ainsi,
contrairement à certaines idées reçues, la charge globale
de travail peut s’intensifier lorsque les soins deviennent
palliatifs et non plus curatifs, même si ce travail est
rarement valorisé. Un des objectifs, pour l’EHPAD qui
travaille en partenariat avec un réseau, est d’établir un
projet global de soins dans lequel les soins palliatifs sont
intégrés au même titre que les soins curatifs, afin qu’ils
soient considérés par l’équipe soignante comme un
objectif positif et non comme un abandon de soins. De
plus, la confrontation à la souffrance et à la mort est un
facteur majeur d’épuisement professionnel (13). Or, la
qualité de la prise en charge palliative des personnes en
fin de vie dépend souvent plus de l’implication des
personnes que de l’organisation médicale, soignante
et administrative. Le réseau de soins palliatifs offre un
soutien, parfois même par des moments informels de
discussion “à chaud” entre soignants, temps d’échange
précieux permettant une expression libre des émotions,
qui permet de prévenir l’épuisement des soignants.
De façon plus formelle, le travail interdisciplinaire entre
les deux équipes participe à l’élaboration de la réflexion
et donc facilite la prise de décision palliative partagée et
collégiale. En effet, il est important que plusieurs
espaces de parole soient ouverts au sein des EHPAD :
réunions interdisciplinaires de discussion de cas de mala-
des, réunions de relecture de cas cliniques ou de cas
éthiques, réunions post-décès. Les réunions interdiscipli-
naires de discussion de cas de malades permettent à
chaque soignant de comprendre la démarche médicale à
travers une réflexion globale, d’y participer en apportant
les éléments nécessaires à la prise de décision palliative
concernant les patients qu’il prend en charge. En pré-
sence de tous les membres de l’équipe, les problèmes
médicaux, mais également l’information donnée aux
malades et aux familles, le contexte psychologique ou les
questions d’ordre éthique sont abordés (arrêt des traite-
ments curatifs, arrêt ou renoncement à une alimentation
ou une hydratation artificielle, décision de transfusion ou

© La Revue de Gériatrie, Tome 35, N°4 AVRIL 2010 267
Partenariat clinique entre un EHPAD et un réseau de soins palliatifs : bénéfices et limites
sociétés savantes concernées, la création puis la diffusion
d’un outil de sensibilisation et de formation appelé
MobiQual (Mobilisation pour l’amélioration de la Qualité
des soins) (14). Dans le cadre de ce programme de santé
publique, le “classeur soins palliatifs” peut être utilisé par
tout soignant, en particulier par les professionnels des
structures fixes et mobiles de soins palliatifs, par les soi-
gnants et référents soins palliatifs des institutions gériatri-
ques et par les médecins coordonnateurs. En 2008, les
tutelles se sont engagées à mettre en place des actions de
formation MobiQual auprès du personnel des structures
médico-sociales et des services de soins à domicile (6).
Soutien pour le médecin traitant
Le suivi par le réseau intègre des évaluations médicales
en fonction de l’évolution des symptômes de fin de vie.
L’information médicale est ensuite transmise aux
équipes soignantes et au médecin traitant dans le but
d’adapter au plus vite les traitements mis en place. Le
médecin du réseau suggère différentes propositions au
médecin traitant, qui reste le décideur principal. Depuis
2008, le Ministère de la Santé s’est engagé à améliorer
l’information des professionnels de santé, en particulier
des médecins traitants, à travers la diffusion de docu-
ments relatifs à la démarche palliative et aux dispositions
de la loi sur le droit des malades, et à la fin de vie. Les
réseaux de soins palliatifs participent à cette action de
santé publique en s’associant à cette campagne de com-
munication auprès, en autres, des médecins traitants
intervenant au sein d’EHPAD. Le soutien d’un réseau
vient encourager les médecins traitants à prendre en
charge des malades en fin de vie. Les soins palliatifs
nécessitent des connaissances théoriques spécifiques
sans lesquelles un médecin généraliste peut se sentir
démuni face à l’un de ses patients. Or, l’enseignement
théorique des soins palliatifs n’est intégré au programme
du second cycle des études médicales que depuis 1996.
Le diplôme d’études spécialisées complémentaires
“Douleur et Soins palliatifs” n’est mis en place que
depuis 2008 (6). Il est donc logique qu’un regard expert
puisse s’avérer utile pour discuter autour d’un cas com-
plexe. Le soutien autour des discussions thérapeutiques
ou éthiques avec les équipes de l’EHAPD peut aussi être
un motif de sollicitation du réseau.
LIMITES OU DIFFICULTÉS D’UN PARTENARIAT
ENTRE UN EHPAD ET UN RÉSEAU DE SOINS
PALLIATIFS ____________________________________
Aux yeux du patient, l’articulation entre les différents
intervenants ne semble pas toujours aussi simple, la
multiplication des interlocuteurs pouvant être un incon-
vénient. Il est important de bien expliquer que le méde-
cin coordinateur du réseau de soins palliatifs est à la dis-
position de chacun des professionnels, du patient et de
sa famille, pour un rôle d’expertise médicale, clinique et
thérapeutique, mais qu’il ne le fait que quand il est
“invité” au sein de l’EHPAD par le médecin coordina-
teur de la structure et auprès du malade par le médecin
traitant.
Lorsque le médecin du réseau de soins palliatifs évalue
un résident en fin de vie et propose un traitement au
médecin référent, il est fréquent que ces conseils ne
puissent pas être suivis en raison de problèmes organisa-
tionnels liés à l’EHPAD, dont les deux principaux sont :
le sous-effectif infirmier et en particulier l’absence de
personnel infirmier la nuit, et le mode de tarification des
EHPAD.
Le manque de personnel au sein des EHPAD entraîne à
moyen et long termes un épuisement professionnel des
soignants, avec pour conséquence ultime la maltraitance
de la personne âgée. Ce “burn out” est également
responsable d’un turn-over trop rapide des soignants au
sein des établissements. Les soignants, ainsi soumis à ce
stress continu, sont moins disponibles en temps et n’ont
pas l’état d’esprit nécessaire pour recevoir une forma-
tion continue. Les réseaux de soins qui proposent des
formations aux équipes des EHPAD ont parfois l’im-
pression d’un manque de motivation, alors qu’il s’agit
plutôt d’indisponibilité psychique par épuisement pro-
fessionnel. L’absence de personnel infirmier la nuit est
une véritable contrainte pour la mise en place de traite-
ments en continu (par exemple une perfusion d’antalgi-
que sur 24h). En 2006, une étude réalisée dans 134 éta-
blissements du Val d’Oise accueillant des personnes
âgées, dont 48 EHPAD, montrait que seuls 13 établisse-
ments étaient dotés d’une infirmière de nuit, permet-
tant de dispenser un traitement morphinique à un
patient douloureux, et qu’un établissement utilisait une
seringue électrique de morphine malgré l’absence d’in-
firmière de nuit (15). L’autorisation d’intervention de
l’Hospitalisation à Domicile (HAD) en EHPAD doit per-
mettre, en théorie, de pallier le manque de personnel
qualifié la nuit et d’administrer des traitements en
continu (16). En pratique, très peu d’établissements ont
recours à l’HAD et il est probable que cette structure ne
pourrait pas répondre à une augmentation importante
de ce type de demande. Pour tenter de garantir la
prise en charge en soins palliatifs des personnes en
fin de vie en EHPAD, des expériences seront menées
entre 2008 et 2012 avec la présence d’infirmières de
nuit formées (6). Une étude réalisée par la Direction
 6
6
 7
7
1
/
7
100%