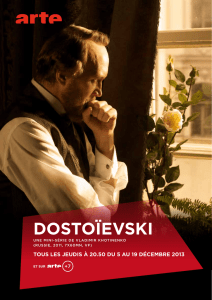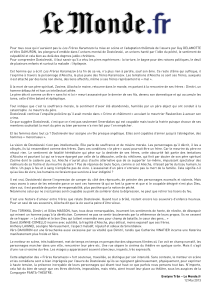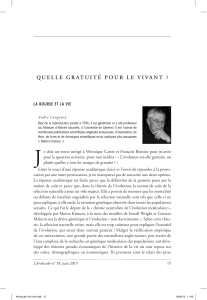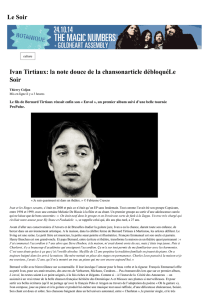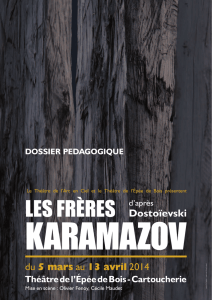mémoire en texte intégral version pdf

UNIVERSITÉ LYON 2
Institut d’Etudes Politiques de Lyon
En quoi, dans l’œuvre de Dostoïevski, la
question de Dieu renvoie-t-elle à celle de la
liberté ?
Mélanie LEGAT
Diplôme IEP 4eme année
Séminaire de Monsieur Bernard Lamizet
Année 2006-2007
Le 5 Septembre 2007
Jury : Monsieur Lamizet et Monsieur Gelas


Table des matières
Remerciements . . 4
Introduction . . 5
Chapitre 1 Les Carnets du Sous-Sol . . 8
- L’attraction du néant dans la lutte contre le " Bien et le Beau" chez l’homme du souterrain-
. . 8
Chapitre 2 Crime et Châtiment . . 18
- Raskolnikov ou l’impuissance de la raison à justifier la violation de la loi morale divine-
. . 18
Chapitre 3 L’idiot . . 32
- Première ébauche dostoïevskienne de l’incarnation de " l’éternel idéal de beauté » - . . 32
Chapitre 4 Les Possédés . . 39
- Stavroguine ou la tragédie de l’homme fait Dieu- . . 39
- Kirilov . . 40
- Chatov . . 43
- Piotr Stepanovitvch . . 46
- Stavroguine . . 48
Chapitre 5 Les Frères Karamazov . . 55
- Synthèse et couronnement de l’œuvre. Biographie spirituelle - . . 55
Dmitri . . 56
Ivan . . 60
La légende du grand inquisiteur . . 63
Conclusion . . 73
Bibliographie . . 78

En quoi, dans l’œuvre de Dostoïevski, la question de Dieu renvoie-t-elle à celle de la liberté ?
4 LEGAT Mélanie_2007
Remerciements
Je remercie Monsieur Lamizet pour son soutien et ses précieux conseils tout au long de mon travail.
Merci d’avoir porté tant d’attention à un travail qu’il m’était très cher de mener à bien.
Je remercie également Monsieur Gelas d’avoir accepté de faire partie du jury à l’occasion de
ma soutenance.
Merci à mes amis qui m’ont soutenu dans les instants de doute profond, à Elise pour qui, il y
a comme pour moi, « un avant et un après Dostoïevski », à Camille, à Julien.
Merci à ma « familius » qui m’a apporté son réconfort au quotidien et qui a relu ce mémoire
entre deux troncs de fuste norvégienne.

Introduction
LEGAT Mélanie_2007 5
Introduction
Dans l’ouvrage collectif intitulé Dostoievski, Henri Troyat parle de "destinée
dostoïevskienne" lorsqu’il tente de relater la vie de l’écrivain russe. Il est vrai que la
biographie de Dostoïevski est extrêmement riche, parsemée d’embûches, de drames et
d’intenses tourments spirituels. Son enfance et sa jeunesse se passeront assez tristement
et rêveusement, entre un père autoritaire, mesquin, avare, et une mère profondément
pieuse mais qui mourra alors qu’il n’est qu’un enfant. Son père l’envoie alors, lui et son
frère Michel à St-Petersbourg afin de préparer le concours de l’Ecole des Ingénieurs. Ces
études ne plaisent pas aux deux frères, déjà portés vers les lettres et Fiodor passera ses
nuits à dévorer des romans ; « Balzac est grand »dira-t-il à Michel. En 1839, son père est
sauvagement assassiné par ses moujiks poussés à bout par les mauvais traitements que
le docteur leur infligeait depuis la disparition de sa femme. Dostoïevski se sentira toujours
plus ou moins coupable après l’assassinat de son père d’avoir pendant très longtemps
sincèrement souhaité sa mort. On retrouvera d’ailleurs une nécrologie de son père sous les
traits du père des frères Karamazov, Fiodor.
Il démissionne en Septembre 1844 de son emploi d’ingénieur pour l’Etat, alors qu’il
a déjà commencé son premier roman Les Pauvres gens. Lorsqu’il donne lecture de son
manuscrit à Grigorovic, celui-ci s’empresse de le porter à Belinski (critique russe très
renommé à l’époque). Ceux-ci viendront chez le jeune écrivain au milieu de la nuit, au bord
des larmes, émus par tant de génie. Belinski y voit en effet, un roman social, ce qui est
vrai sous certains aspects mais ce premier roman est surtout le résultat d’une inspiration
religieuse certaine ; Dostoïevski est, à cette époque, schillérien. Mais très vite, son caractère
emporté et son immense orgueil lui font perdre tous ses soutiens. Cette désaffection le
plonge dans le doute : « Vraiment, je n’ai jamais traversé une époque aussi pénible, écrit-
il ; l’ennui, la tristesse, l’apathie et l’attente fiévreuse et convulsive de quelque chose de
meilleur me torturent ».
1847 marque pour l’écrivain le « temps des cercles » et notamment celui de
Petrachevski. Les individus dont il s’est entouré sont très cultivés, font preuve d’une
intelligence fine et ont tous choisi, le socialisme, le fouriérisme en connaissance de cause.
Cependant, leur engagement idéologique se situe davantage dans la réaction à un système
qu’ils jugent oppressif et dont ils souhaitent une réforme en profondeur. L’année 1849 sera
marquée par une certaine radicalisation. Dostoïevski lira lors de l’un des dîners au cercle
la lettre de Belinski à Gogol où il accuse celui-ci d’un excès de religiosité : c’est la fameuse
lettre qui causera à D. ses quatre années de bagne. Il a donc fréquenté majoritairement deux
cercles : celui des Petrachevistes et celui de Dourov (qualifié à l’époque par Dostoïevski
de ‘religieux jusqu’au ridicule’). Entre l’un à tendance résolument socialiste et athée et
l’autre plus modéré cherchant une synthèse entre socialisme et christianisme, quelle était
la position de Dostoïevski ? Une chose est certaine : il n’a jamais lu ni Proudhon, ni Fourier
et s’il est charmé par l’utopie contenue dans le projet fouriériste il n’en reste pas moins
convaincu que celui-ci est inapplicable sur le sol russe. Quoiqu’il en soit, il est fermement
opposé au servage et révolté par cet état d’esclavage, il semble qu’il balançait entre une
solution révolutionnaire et d’autres plus modérés qui eussent pris en considération les
intérêts des propriétaires fonciers. Dans la nuit du 22 au 23 Avril 1849, les « conspirateurs »
sont arrêtés. La grâce de l’empereur leur est lue alors qu’ils ont déjà été amenés au poteau
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
1
/
78
100%