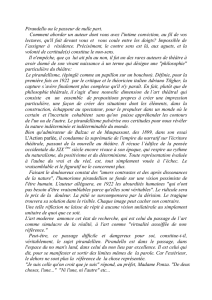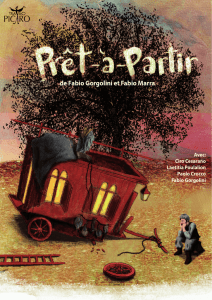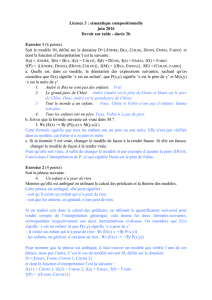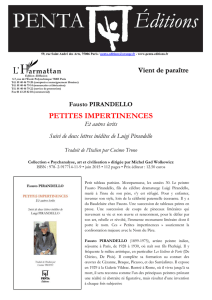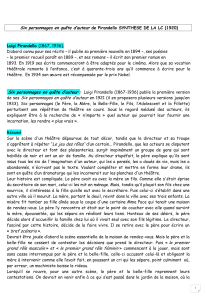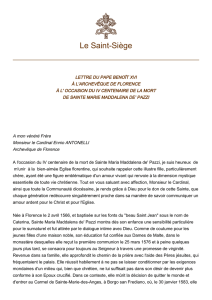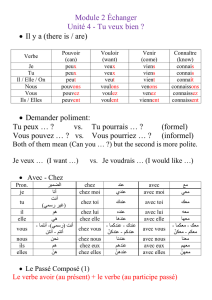Le Plaisir d`être honnête

Le Plaisir d'être honnête
de Luigi Pirandello
mise en scène Marie-José Malis
!
du 24 janvier au 12 février 2012
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Dossier pédagogique
Hinde Kaddour /
Dominique Genequand
T+ 41 22 328 18 13
Comédie de Genève
Bd des Philosophes 6
CH-1205 Genève
T+ 41 22 320 50 00
F+ 41 22 320 00 76
www.comedie.ch
Création
à la Comédie de Genève
!
!
!

!
2
Le Plaisir d'être honnête!
Sommaire
Le projet en quelques mots........................................................................... 3
Générique ........................................................................................................ 4
Mettre en scène Pirandello, par Marie-José Malis...................................... 5
Résumé analytique ......................................................................................... 6
Luigi Pirandello ............................................................................................... 8
Bibliographie .................................................................................................10
Marie-José Malis .......................................................................................... 11
Le masque chez Pirandello.......................................................................... 12
Jung et la persona........................................................................................ 13
L'œuvre de Pirandello .................................................................................. 14
Pirandello, un théâtre combinatoire - Extraits de la monographie de G. Genot.17
Le contexte historique ................................................................................. 22
Texte en regard : Nantas, d’Émile Zola, 1878 ............................................ 23
Le thème de la honte : occurrences ........................................................... 37
Notes sur les personnages, par Luigi Pirandello - Trad. de Ginette Herry .... 39
Le Plaisir d'être honnête : Acte I - Traduction de Ginette Herry ...................... 40
Le Plaisir d'être honnête : Le texte original - Acte 1, scène 1............................ 52
Le Plaisir d'être honnête : La nouvelle d'origine.............................................. 56
Critique : On ne sait comment (1934), mise en scène Marie-José Malis .......... 61

!
3
Le Plaisir d'être honnête
Le projet en quelques mots
Quarante-cinq ans de carrière littéraire, quatre recueils de poèmes, sept romans, plus de
deux cents nouvelles, une quarantaine de pièces de théâtre, ainsi que deux volumes
d'essais : l’œuvre de Pirandello est une « œuvre-monde ». Elle offre de vastes champs
d’investigation dans différents domaines.!
Domaine littéraire – dans Le Plaisir d’être honnête, on peut voir en filigrane les prémices
de la révolution pirandellienne. !
Domaine philosophique – si le « pirandellisme » est une notion aventureuse, trop
souvent plaquée sur le théâtre de Pirandello, il y a dans ses pièces une manière d’opérer,
un « donner à penser » qui le rapproche des philosophes. Ses Essais offrent également
une belle matière à la réflexion.!
Domaine cinématographique – Pirandello a connu les débuts de cinecittà, auxquels il a
consacré un roman. De plus, si ses propres tentatives d’adapter Six personnages en
quête d’auteur à l’écran ont échoué, son œuvre a été l’occasion d’une production
cinématographique de qualité.!
Domaine historique – l’Italie du Sud, de la fin du XIXe aux premières décennies du XXe,
est la toile de fond de l’œuvre de Pirandello. L’auteur a également été pris dans les
tourbillons du fascisme.
Domaine politique – Baldovino, à titre privé, interroge les principes sociaux et les valeurs
qui devraient sous-tendre la vie politique. Il est le personnage qui doit refonder quelque
chose dans une trajectoire personnelle, mais en écho au début du siècle.!
Domaine psychanalytique – Freud, puis Jung, fondent, au moment où Pirandello écrit Le
Plaisir d’être honnête, les bases de leur réflexion sur ce qui constitue la personnalité d’un
individu. Pirandello présente des personnages qui se façonnent des masques et luttent
contre leur animalité.

!
4
Le Plaisir d'être honnête
Générique
En marge du spectacle!
Mercredi 1er février 2012!
Rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation.!
Lundi 30 janvier 2012
Dans le cadre des Lundis de la Comédie ;
conférence de Martin Rueff, professeur ordinaire à l'Université de Genève, traducteur,
poète, intitulée « Hardiesse de Pirandello : la vie comme forme pure » ;
à 19h, au studio Claude Stratz ;
réservation fortement recommandée en raison de la capacité réduite de la salle ;
plein tarif Fr. 10.- / tarif réduit Fr 5.- / gratuit pour les abonnés
texte : Luigi Pirandello
mise en scène : Marie-José Malis
traduction : Ginette Herry (L’avant-scène théâtre n°1318)
avec : Juan Antonio Crespillo, Anne Durand, Roberto Garieri, Rachel Gordy,
Olivier Horeau, Nicolas Rossier, Alexandra Tiedemann, Olivier Yglesias
scénographie : Jean-Antoine Télasco, Adrien Marès
création lumière : Jessy Ducatillon
création son : Patrick Jammes
création costumes : Pascal Batigne
production : Comédie de Genève, Cie La Llevantina

!
5
Le Plaisir d'être honnête
Mettre en scène Pirandello, par Marie-José Malis
Voilà ce que j’aime dans l’exercice de la mise en scène aujourd’hui, il faut décider : verser
les textes soit du côté du pessimisme ou du faux humanisme ambiant, soit du côté de la
construction politique et de l’invention des formes de notre nouveau courage.
Pirandello, en France particulièrement, est mis d’habitude du côté du relativisme. Et je
dis, avec d’autres, qu’il est le contraire. Qu’il est du côté de la plus exacte lutte pour
penser encore les conditions du sublime et d’un possible, contre le renoncement.
Dans Le Plaisir d’être honnête, un homme, un déclassé, est requis par des nobles
obsédés par leur réputation, afin de jouer le rôle d’un mari de façade. Or, contre toute
attente, le rôle à jouer fabrique un homme nouveau, la fiction cynique produit
l’assomption d’une vérité. On découvre que la vertu - au sens que lui donnaient nos pères
en politique - pourrait bien n’être qu’une discipline, une construction décidée qui organise
sa fidélité.
Pirandello avait une intuition - celle de son temps et celle de la modernité - qu’il serait bon
que nous réinterrogions : il est possible que l’humanité soit une construction sans
garantie, sans dieu, sans justification ni direction assurée. Et que, malgré l’angoisse
provoquée, cela soit une bonne nouvelle. L’homme ne serait alors que les masques qu’il
se donne. Mais il peut choisir ces masques, et vivre sous la discipline de ce choix.
C’est ainsi que je m’explique cette fascination de Pirandello pour les jeux de la réalité et
de l’illusion. Non pas comme une sentence sur la toute puissance du faux, mais comme
une méditation sur le vrai. Un vrai dont il faut saluer qu’il dépende du désir des hommes,
et de leur capacité à choisir les fictions qui les formeront à leur matière. Qui dépendrait
donc du courage, et de la fantaisie, et se trouverait encore dans la lutte et les décisions
que les hommes portent pour en assurer la venue. Le théâtre de Pirandello dirait ainsi,
contre le néant des ambiguïtés, une tâche des hommes et déclarerait la possibilité même
de la politique.
Le théâtre devient alors le lieu où s’explorent les conditions de cette liberté nue : une
fabrique où se traverse le risque du pire et où s’exauce l’arrivée d’une décision de dignité.
Il est à cet égard le laboratoire de la liberté des hommes.
Le moment revient où nous devons assumer que mettre en scène des textes, ceux de la
modernité entre autres, c’est opérer un choix de lecture. Non pas seulement une
interprétation singulière, mais une décision à vue, une imitation de ce que signifie
organiser la décision du possible, dans ce temps de l’histoire.
Il y a des textes qui s’attrapent par les cheveux : à une infime différence près, nous les
mettons du côté du nihilisme ou du sublime, c’est-à-dire de ce qui contredit le temps et
sa certitude que rien n’arrive jamais. Sur le plateau, nous ne cherchons jamais que le
théâtre. Le théâtre comme laboratoire des ressources politiques qu’un monde se donne.
Des acteurs portent le temps qu’il faut, le travail de fidélité à une intuition de bonheur,
pour que d’une longue obscurité, l’arrivée de ce qu’il n’y a pas soit éclaircie comme
donnée aussi de notre monde.
Avec Pirandello, la représentation sera cette médiation sur comment, mine de rien, en
feignant de mimer ses propres conventions bourgeoises et les impasses de notre monde
paresseux, le théâtre ne vit et ne se construit un public que de sa passion pour la vérité.
Qu’il est cette folie du vrai sous les attaques du mensonge et de la peur.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
1
/
61
100%