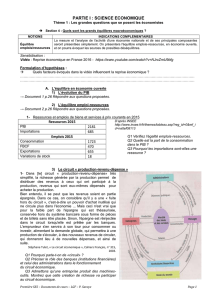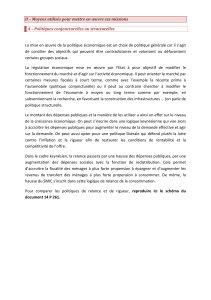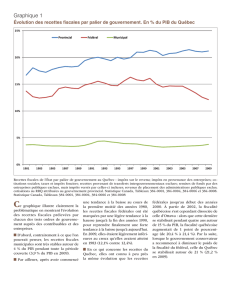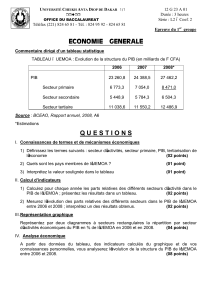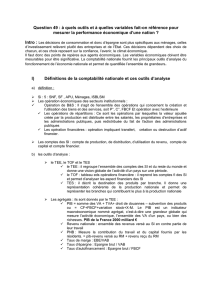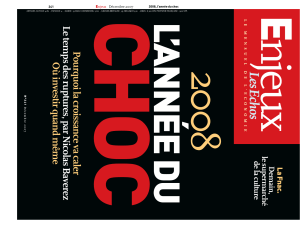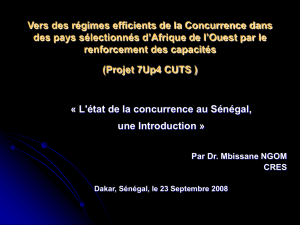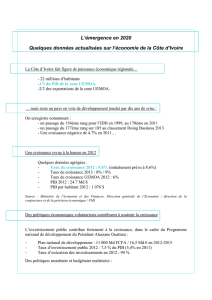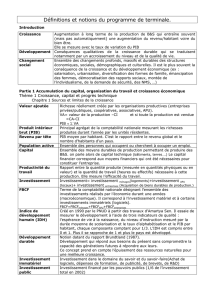MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES AU SENEGAL

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple-Un But-Une Fois
……………………..
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES
FINANCES
………………………
CENTRE D’ETUDES DE POLITIQUES POUR LE
DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS
DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
………..
COMMISIONNER FOR MACROECONOMIC
POLICY
…………
ECONOMIC POLICY UNIT
MOBILISATION DES RESSOURCES INTERIEURES AU SENEGAL
Souleymane DIALLO
Novembre 2011

2
TABLE DES MATIERES
Liste des figures ....................................................................................................................................... 2
Liste des Tableaux .................................................................................................................................... 2
Liste des abréviations et acronymes ......................................................................................................... 3
Résumé .................................................................................................................................................... 4
Résumé analytique ................................................................................................................................... 4
I. CONTEXTE, REVUE DE LITTERATURE ET HYPOTHESES DE TRAVAIL ............................................ 5
II. Politique économique de Mobilisation de Ressources intérieures .................................................... 9
1. L’environnement politique ............................................................................................................ 9
2. L’environnement institutionnel ................................................................................................... 14
III. Performances en matière de mobilisation de ressources intérieures .............................................. 16
1. Recouvrement de recettes budgétaires ....................................................................................... 16
2. Le Marché des titres publics ....................................................................................................... 19
3. Le Marché financier ................................................................................................................ 20
4. Le secteur des assurances ......................................................................................................... 23
5. Institutions de sécurité sociale ................................................................................................... 24
IV. Efficacité de la gestion des ressources intérieures ..................................................................... 24
1. Critères de convergence de la CEDEAO :............................................................................. 24
2. Politiques inappropriées et exonérations ............................................................................... 25
V. Défis liés à la mobilisation de ressources intérieures ..................................................................... 27
VI. Recommandations pour une meilleure politique de mobilisation de ressources intérieures. ...... 28
CONCLUSION ......................................................................................................................................... 29
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................. 30
ANNEXES ............................................................................................................................................ 31
Notes de fin de page ............................................................................................................................... 32
Liste des figures
Figure 1: Evolution du ratio recettes douanières rapportées aux recettes fiscales .............................. 18
Figure 2: Emission de Bons de Trésor en milliards de FCFA .................................................................. 20
Figure 3: Evolution des taux d'épargne privée nationale et intérieure ................................................ 21
Figure 4: Evolution de la part des crédits bancaire à l'économie ......................................................... 22
Figure 5: Comparaison du déficit budgétaire hors dons (% du PIB) au seuil communautaire .............. 24
Liste des Tableaux
Tableau 1: indicateurs macroéconomiques de 2000 à 2010 .................................................................. 6
Tableau 2: Ecart épargne investissement en moyenne sur la période 2000-2010 ................................. 7
Tableau 3: principales taxes au Sénégal ................................................................................................ 10
Tableau 4: produits d'épargne proposés par les principales banques en 2011 .................................... 12
Tableau 5: Types de crédits accordés par les principales banques en 2011 ......................................... 12
Tableau 6: Types de branches d'assurance au Sénégal ......................................................................... 13

3
Tableau 7: financement des branches de la sécurité sociale dans le secteur privé (IPRES et CSS) ...... 14
Tableau 8: Répartition des banques au niveau des régions en mai 2011 ............................................. 16
Tableau 9: Evolution de la structure fiscale de 2000 à 2010................................................................. 17
Tableau 10: dépôts au niveau des établissements financiers à caractère bancaire suivant le terme . 21
Tableau 11: Crédit accordé par les établissements financiers à caractère bancaire suivant le terme 22
Tableau 12: l'épargne mobilisée auprès des institutions de micro finance .......................................... 22
Tableau 13: évolution crédits accordés par la micro finance ................................................................ 23
Tableau 14: Structure des placements du secteur des assurances ....................................................... 23
Tableau 15: critères de convergence de second rang ........................................................................... 25
Tableau 16: bilan dépenses fiscales en 2008 ........................................................................................ 25
Tableau 17 Tableau synoptique des avantages accordés aux investisseurs (hors secteur minier) ...... 26
Tableau 18: Tableau synoptique des recommandations au pays ......................................................... 28
Tableau 19: matrice de corrélation linéaire entre les variables explicatives du modèle ...................... 31
Tableau 20: estimation équation à long terme ..................................................................................... 31
Tableau 21: Test de racine unitaire pour le résidu de l'équation de long terme .................................. 32
Tableau 22: estimation économétrique MCE relation de court terme ................................................. 32
Liste des abréviations et acronymes
AMAO Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
BRVM Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
CA Chiffre d’Affaires
CDC Caisse de Dépôts et Consignations
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CFCE Contribution Forfaitaire à la Charge de l’Employeur
CIMA Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance
CGU : Contribution Globale Unique
CSS Caisse de Sécurité Sociale
DGCPT Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor
DGID Direction Générale des Impôts et Domaines
DGD Direction Générale des Douanes
DMC Direction de la Monnaie et du Crédit
EFE : Entreprise Franche d’Exportation
FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine
FNR Fonds National de Retraite
IADM Initiatives d’Allègement de la Dette Multilatérale
IMEC Institutions mutualistes d’Epargne et de Crédit
IMF Impôt Minimum Forfaitaire
IPRES Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal
IRPP Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
IRVM/IRCM Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières et des Capitaux Mobiliers
IS Impôt sur les Sociétés
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement
PIB Produit Intérieur Brut
PPTE Pays Pauvres Très Endettés
SFD Systèmes Financiers Décentralisés
TOB Taxe sur les Opérations bancaires
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

4
Résumé
L’objet de cette étude est d’explorer les opportunités qu’offre l’économie pour une
mobilisation efficiente des ressources intérieures au Sénégal en vue d’assurer le financement
du développement et corriger le déséquilibre extérieur structurel. La collecte de recettes
budgétaires est contrainte par le poids du secteur informel mais elle pourra être accrue à court
terme par un meilleur suivi des entreprises, un système d’échange de données entre les régies
et les banques et direction de transport terrestre et une simplification du système fiscal. A long
terme, les réformes nécessaires sont le développement du secteur financier et la collecte des
taxes foncières ainsi que la rationalisation des dépenses fiscales. Pour la mobilisation de
l’épargne privée, il faut un renforcement de la supervision du système financier, la stabilité du
cadre macroéconomique, la participation active des sociétés d’assurance et des institutions de
prévoyance sociale au marché financier, qui sera étendu à la CEDEAO, un maillage du
territoire par les établissements de crédit avec des produits innovants, notamment les plans
d’épargne actions.
Mots clés : ressources intérieures, CEDEAO, recettes budgétaires, épargne privée.
Résumé analytique
Le Sénégal est un pays côtier et sahélien, membre de l’UEMOA et de la CEDEAO. Il a
réalisé des performances économiques au cours des dernières années. Cependant, il enregistre
un déficit structurel des transactions courantes imputable aussi bien à l’Etat qu’au secteur
privé. Aussi, la mobilisation de ressources intérieures dans le pays est-elle indispensable pour
corriger ce déficit et financer le développement économique et social.
L’environnement politique et institutionnel de mobilisation de ressources intérieures y
est bien encadrée, par des textes nationaux et de l’UEMOA. Toutefois, la multiplicité des
textes de référence dans le système fiscal nécessite une rationalisation et une unification en un
document unique. De même, la concentration des établissements de crédit dans la région de
Dakar et le vieillissement du personnel des régies financières imposent des mesures de
correction à travers une politique optimale de recrutement.
Grâce au cadre politique et institutionnel et à la performance économique des dernières
années, les ressources intérieures (publiques et privées) ont progressé continuellement, mais
demeurent insuffisantes pour assurer le financement des programmes de développement et
corriger le déséquilibre extérieur structurel de l’économie.
Toutefois, des marges de progression importantes des ressources intérieures persistent
en raison de : (i) l’étendue des dépenses fiscales ; (ii) des perspectives de croissance
économique favorables à moyen et long terme ; iii) de la bonne santé financière des
établissements de crédit ; (iv) du nombre limité de comptes de la clientèle au niveau des
établissements de crédit ; (v) de la faible couverture de la population en police d’assurance ; et
(vi) de la timide participation des ménages, des entreprises et des institutions de prévoyance
sociale au marché financier.
Les principaux défis à relever pour réussir le pari de mobilisation de ressources
intérieures portent sur la formalisation du secteur informel, la mise en place d’un mécanisme
efficace de prélèvement des taxes urbaines, la rationalisation des dépenses fiscales, la réforme
des systèmes de retraite, le développement du secteur financier à travers la réduction des
transactions en espèces, l’établissement d’un marché financier à l’échelle de la CEDEAO et
l’instauration d’une culture financière pour une plus grande participation des ménages, des
entreprises, des sociétés d’assurance et des institutions de prévoyance sociale au marché
financier. Les établissements financiers doivent étendre leur maillage du territoire avec des
produits innovants, notamment les plans d’épargne actions au niveau des banques ou des
sociétés d’assurance.
Par ailleurs, la politique de mobilisation de ressources intérieures doit être en cohérence
avec la stratégie de croissance et de développement pour éviter une épargne privée oisive et
une épargne publique qui affecte la compétitivité de l’économie.
Enfin, la CEDEAO doit élaborer une politique régionale de fiscalisation du secteur
minier pour éviter des concurrences nuisibles entre les pays membres.

5
I. CONTEXTE, REVUE DE LITTERATURE ET HYPOTHESES DE TRAVAIL
Le Sénégal est un pays côtier membre de UEMOA et de la CEDEAO. Il a accédé à
l’indépendance en 1960 et instauré le multipartisme politique en 1974. Sa population est
estimée à environ 12 millions d’habitants en 2010 pour une superficie de 196 700 Km2, soit
une densité de 61 habitants/ Km2.
Le Sénégal est un pays sahélien avec une saison des pluies qui s’étale de juin à octobre
et qui est caractérisée par des précipitations moyennes de 894 mm en 2010, variant du nord
au sud où les précipitations moyennes annuelles dépassent 1200 mm.
Le Sud Ouest du pays subit depuis 1982 une rébellion indépendantiste y installant un
climat d’insécurité, sur une superficie de 14 749 Km2, soit 7,5% du territoire national entre la
Gambie et la Guinée Bissau.
Présentation de l’économie sénégalaise
L’agriculture concentre, en moyenne, plus de la moitié de la population active occupée,
en particulier en milieu rural. Les principales cultures du pays sont l’arachide, le mil et le
sorgho, tandis que la principale denrée alimentaire du pays est le riz dont la production
intérieure a atteint l’équivalent du tiers de la consommation totale. Encore sujette aux aléas
climatiques, l’agriculture voit son poids baisser dans l’économie. La valeur ajoutée de
l’agriculture passe de 14% du PIB dans les années 80 à 8% en 2010.
Par ailleurs, grâce à 714 Km de côtes réputées parmi les plus poissonneuses au monde
avec celles de la Mauritanie, l’activité de pêche est le deuxième secteur d’exportation du pays
(163,2 milliards FCFA en 2010, soit 15,6% des exportations de biens), après le tourisme.
Au total, le secteur primaire (agriculture, élevage, forêt, chasse et pêche) représente
15% du PIB en 2010 contre 20% dans les années 80 et 25% pendant les années 60.
Misant sur sa position géographique de carrefour vers l’Afrique, l’Europe et
l’Amérique, le Sénégal a opté dès les années 60 pour le développement du tourisme qui,
depuis 2007 constitue la 1ère source de devises du pays (222,8 milliards en 2010, soit 3,5% du
PIB correspondant à environ 800 000 touristes).
L’économie sénégalaise est essentiellement tertiaire (commerce, transport et
télécommunications, services immobiliers, tourisme et autres services) avec les services
marchands qui représentent plus de 45% du PIB en 2010. Au total, le secteur tertiaire
contribue à plus de 60% à la formation du PIB.
Le secteur secondaire contribue à un peu plus de 20% à la formation du PIB. Il est
constitué essentiellement d’industries alimentaires, d’industries chimiques (fabrication
d’acide phosphorique, cimenteries, et raffinerie de pétrole) et du BTP.
Les activités extractives ont longtemps concerné : (i) le phosphate exploité dans la
région de Thiès pour la fabrication d’engrais et d’acide phosphorique dont les exportations
constituent la troisième source de devises du pays (103,2 milliards FCFA en 2010) ; (ii) le sel,
extrait particulièrement au niveau de la petite côte (entre Dakar et Kaolack), (iii) le calcaire à
la sortie de la capitale pour la fabrication de ciment et (iv) le sable pour les besoins de
construction de BTP. Depuis 2009, l’exploitation de l’or au Sénégal oriental a pris une
importance avec des exportations dépassant 80 milliards par année, soit la quatrième source
de devises du pays.
En ce qui concerne le secteur informel, son poids a peu changé depuis les années 80 ; il
a généré 49,4% de la valeur ajoutée totale de l’économie sur la période 1980-2004 et 46,8%
en 2005-2009. Le secteur informel constitue l’essentiel du secteur primaire (98%) tandis qu’il
est moins important dans les secteurs secondaire (43,5% sur la période 2005-2009) et tertiaire
(46,3%).
L’économie a enregistré de 1960 à 1994 une croissance inférieure au croît
démographique (2,7%), en raison notamment d’une faible compétitivité. En 1994, la monnaie
nationale commune à tous les pays de l’UEMOA, le FCFA, a été dévaluée de 50% en
monnaie étrangère par rapport au Franc Français de l’époque, auquel elle était arrimée,
suivant une parité fixe avec une convertibilité illimitée. A la faveur de la dévaluation et de
l’ensemble du programme de réformes structurelles ayant suivi, l’économie a enregistré l’une
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%