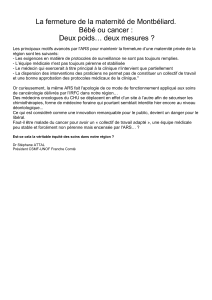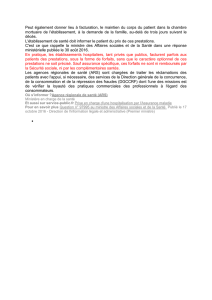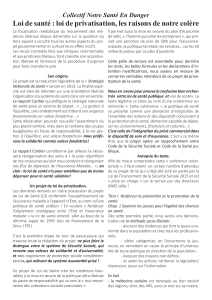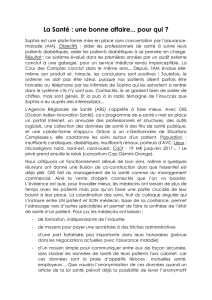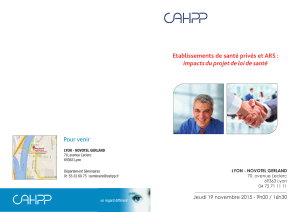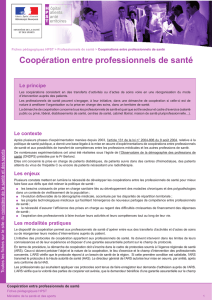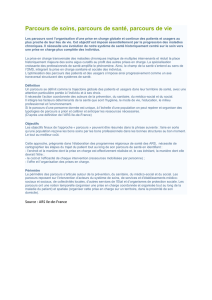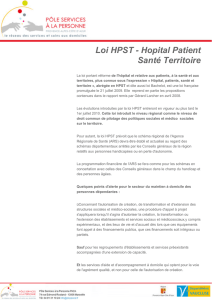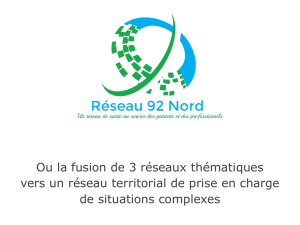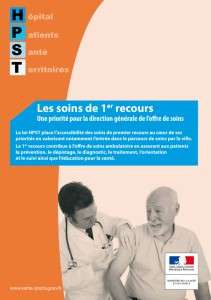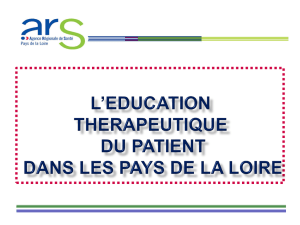La loi « HPST »

12 Le Cardiologue 324 – Septembre 2009
9
Le sort de l’hôpital public : l’ambition du Gouvernement est
clairement d’amener l’hospitalisation publique au même niveau de
restructuration que l’hospitalisation privée. Les regroupements sont
donc au programme, sans doute « à marche forcée », sous la houlette
des futurs directeurs d’Agences Régionales de Santé qui auront toute
latitude pour les imposer au travers de CHT (Communautés Hospita-
lières de Territoire). Les coopérations public/privé seront également
encouragées au travers de GCSM (Groupement de Coopération Sa-
nitaire de Moyens).
9
La clinique privée pas oubliée : formellement, elle pourra
prétendre se mettre sur les rangs lors de l’attribution des MIG (Mis-
sion d’Intérêt Général : permanence des soins et AMU, soins palliatifs,
formation initiale des professionnels,… ). L’avis de la CME devra être
présenté, avant signature, tous les 5 ans avec le directeur de l’ARS,
du COM (Contrat d’Objectif et de Moyen). Mauvaise nouvelle : une
clause « anticoncurrence » l’empêchera de débaucher, pendant 2
ans, un praticien de l’hôpital public voisin.
9
La définition des soins de « premier recours » : le lé-
gislateur définit assez précisément ce que devront être les soins de
premier recours et leurs acteurs, médecins et pharmaciens, mais elle
oublie de préciser ceux qui relèvent du « second recours », et d’un
éventuel « troisième ». La prochaine fois peut-être ?
9
Cap sur les « pôles de santé » : à côté des maisons de santé
pluridisciplinaires (légalisées antérieurement), la loi fait place à des
« pôles », qui pourront également faire du « second recours », et
qui surtout, et comme les réseaux, s’ouvrent l’accès aux fonds per-
mettant de rétribuer la coordination des soins. Cette disposition sera
analysée pour savoir si elle peut servir de support aux « Maisons du
Cœur et des Vaisseaux » préconisées par le dernier Livre Blanc.
9
Déserts médicaux, rendez-vous en 2012 : le législateur a
reculé devant l’intention initiale de « taxer » les installations en zones
surdenses par le biais d’un contrat « Santé Solidarité ». Son applica-
tion est renvoyée à 2012, ce qui oblige les partenaires conventionnels
à trouver d’ici là des aménagements à la liberté d’installation.
9
Prévenir l’Ordre en cas d’absence : lorsqu’il s’absentera
pour vacances, congrès, etc. tout médecin devra prévenir l’Ordre
départemental en donnant le nom d’un confrère en charge de la
continuité des soins due à sa patientèle.
9
Transfert d’activité : le transfert d’activité médicale à un pa-
ramédical sort de son côté expérimental ; c’est désormais le directeur
d’ARS qui l’autorisera sur le fondement d’un référentiel à charge de
la HAS (Haute Autorité de Santé). Délai à prévoir.
9
Secteur optionnel : les négociateurs de la Convention ont
jusqu’au 15 octobre pour « inventer » le secteur optionnel. Les inter-
locuteurs de la profession ne sont disposés à le concéder qu’aux seuls
chirurgiens/anesthésistes/obstétriciens prêts à abandonner le secteur
2. Mais les syndicats ne veulent rien céder des « avantages acquis »
du secteur 2. Dossier explosif !
9
Refus de soins, gare ! si un patient s’estime victime d’un
refus de soins par un professionnel, il pourra porter plainte contre
lui auprès de la Caisse La profession n’a pu sauver que d’extrême
justesse la présomption d’innocence du médecin dans cette affaire,
mais gare !
9
DPC = FMC + EPP : en fusionnant la double obligation de FMC
et d’EPP, le Gouvernement invente le « Développement Professionnel
Continu » mais oublie d’en prévoir le financement public.
9
ARS, un directeur omnipotent : l’État attend des 26 direc-
teurs d’Agences Régionales de la Santé qu’ils réussissent là où lui a
régulièrement échoué depuis cinquante ans, notamment à maîtriser
enfin les dépenses ! Un super-préfet sanitaire qu’il va falloir appren-
dre à connaître. Prochaine étape : des enveloppes régionales
9
Trois « collèges » syndicaux : le Gouvernement balkanise
un peu plus encore la représentation syndicale en organisant trois
collèges électoraux : les généralistes, les spécialistes et ceux qui tra-
vaillent en « salle d’op ». Au niveau régional seront constituées des
URPS (Unions Régionales de Professionnels de Santé) représentant
40 professions !
Loi HPST Les dispositions qui intéressent les cardiologues libéraux
Pour le lecteur pressé
La loi « HPST »
POUR LES NULS
Le dossier ci contre recense tous les articles de la Loi HPST auxquels les cardiologues sont susceptibles de se
trouver confrontés dans les mois et années à venir. Il s’agit du texte issu de compromis successifs entre le
ministre et les parlementaires. Un monument législatif sur lequel l’actualité nous obligera certainement à
revenir. Vous en trouverez ci-dessous les dispositions majeures et les problèmes qu’elles posent.

Le Cardiologue 324 – Septembre 2009
Les dispositions qui intéressent
les cardiologues libéraux
Loi HPST
Fenêtre sur
9
RÉFORME DE L’HOPITAL
Art. 1. Missions de service public des établissements
Fini la distinction public/privé et privé « non lucratif » (rebaptisé
dans le même article « établissements de santé privés d’intérêt
collectif »), la loi ne connaît plus désormais qu’un seul statut des
établissements devant leur mission de service public, synthétisée
en trois paragraphes :
- ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambula-
toire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de ré-
sidence ou d’un établissement avec hébergement […] (Maisons
de retraite, Ndlr) ;
- ils participent à la coordination des soins en relation avec les
membres des professions de santé exerçant en pratique de ville
et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre
défini par l’ARS […] ;
- ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publi-
que et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité
sanitaire. […]
Le même article stipule qu’en cas où une mission de service public
est dévolue à un établissement privé, le contrat [passé avec l’ARS,
Ndlr] engage les libéraux qui y travaillent.
Le même article dispose encore de quelques mesures
« subsidiaires » :
- les établissements de santé (publics ou « privés d’intérêt col-
lectif ») peuvent créer des centres de santé, à l’instar des asso-
ciations ou collectivités locales, où les médecins n’ont qu’un seul
statut : salarié ;
- les centres de santé, les maisons et pôles de santé et les grou-
pements de coopération sanitaire peuvent également pourvoir à
des missions de service public en fonction de « besoins » de santé
« appréciés par le SROS » ;
- lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un
territoire, c’est le Directeur de l’ARS qui en désigne l’établisse-
ment ou groupement « volontaire » ;
- l’établissement antérieurement titulaire d’une mission de ser-
vice public est prioritaire au moment de la renégociation de son
CPOM ;
- enfin d’ici 2018, nouvelle échéance retenue de la convergence
des tarifs public/privé, le Gouvernement devra présenter au
Parlement chaque année, avant le 15 octobre, un rapport sur
l’application de la T2A.
Art. 5. CME et amélioration de la qualité et sécurité
Cet article complète les obligations en ce domaine :
- l a CME contribue à la définition de la politique médicale et à
l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qua-
lité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil
et de prise en charge des usagers. […]
- L’établissement de santé met à la disposition du public les ré-
Finalement publiée au Journal Officiel du 22 juillet dernier sous le numéro 2009-879, la Loi
« Hôpital, Patients, Santé, Territoires » (HPST), dont la discussion avait occupé le printemps
du Parlement, n’a que peu souffert de son passage devant le Conseil Constitutionnel où l’avait
traduit l’Opposition. Au nombre des (rares) dispositions censurées : la possibilité d’expérimen-
ter le DMP sur clé USB, projet cher au syndicat des cardiologues et au Dr Jean-Pierre Door qui
en avait porté l’amendement. On notera d’ailleurs que cette censure porte plus sur la forme
que sur le fond, les « Sages » ayant considéré que l’État ne pouvait engager d’expérience comme
celle-là sans en fixer le terme.
Pour le reste, la rédaction du Cardiologue a sélectionné, parmi les 135 articles constituant la
loi, ceux qui impactent potentiellement sur la pratique. D’une portée inégale, ils ne sont pas à
prendre tous au premier degré, bon nombre ayant besoin pour devenir opérationnels d’un ou
plusieurs textes d’application. D’après des calculs du ministère, 145 décrets ou arrêtés sont ain-
si à écrire ! Ce qui exigera, au bas mot, quelques mois d’activité au cabinet de Mme Bachelot !
Quelques-unes
des 14 missions de service public
- Permanence des soins
- Prise en charge des soins palliatifs
- Enseignement universitaire et postuniversitaire
- Recherche
- DPC des praticiens hospitaliers et non-hospitaliers
- Formation initiale et DPC des sages-femmes et paramédicaux
- Education et prévention pour la santé
- AMU

Le Cardiologue 324 – Septembre 2009
sultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de
sécurité des soins […].
[…] L’avis de la CME est joint à toute demande d’autorisa-
tion ou d’agrément formée par un établissement de santé
privé et annexée à toutes les conventions conclues par ce
dernier.
Art. 6. Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
L’ARS conclut avec chaque établissement de santé […] un
CPOM d’une durée maximale de cinq ans. Lorsqu’il comporte
des clauses relatives à l’exécution d’une mission de service
public, le contrat est signé pour une durée de 5 ans. […]
Art. 7. Clause de « non-concurrence » des praticiens
hospitaliers (publics, Ndlr)
Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il peut être
interdit aux PH ayant exercé plus de cinq ans à titre permanent
dans le même établissement d’ouvrir un cabinet privé ou d’exer-
cer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé
à but lucratif où ils puissent rentrer en concurrence directe avec
l’établissement public dont ils sont démissionnaires […]. Les mo-
dalités d’application du présent article sont fixées par voie régle-
mentaire (décret ou arrêté, Ndlr).
Art. 19. Statut de clinicien hospitalier
La loi prévoit la création d’un statut de « clinicien hospitalier »,
« recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté
particulière à être pourvus ».
[Leur] rémunération contractuelle […] comprend des éléments
variables qui sont fonction d’engagements particuliers et de la
réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la
déontologie de leur profession.
Art. 22. Communautés Hospitalières de Territoire (CHT)
Des établissements publics de santé peuvent conclure une
convention de communauté hospitalière de territoire afin de met-
tre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun
certaines fonctions et activités grâce à des délégations ou des
transferts de compétences entre les établissements et grâce à la
télémédecine. […]
Art. 23. Groupements de Coopération Sanitaire de
Moyens
Le groupement de coopération sanitaire de moyens […] peut
être constitué pour :
1/ organiser ou gérer des activités administratives, logisti-
ques, techniques, médico-techniques, d’enseignement ou de
recherche ;
2/ réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun ; […] il
peut être titulaire de l’autorisation d’installation d’équipements
matériels lourds
3/ permettre les interventions communes de professionnels médi-
caux ou non médicaux exerçant dans les établissements ou cen-
tres de santé […] ainsi que des professionnels libéraux membres
du groupement.
Un GCSM peut être constitué par des établissements de santé
publics ou privés, des établissements médico-sociaux […], des
centres de santé et des pôles de santé, des professionnels libé-
raux exerçant à titre individuel ou en société. Il doit comprendre
au moins un établissement de santé. […]
La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux
assurés par les professionnels libéraux médicaux, dans le cadre
du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à
l’acte. […]
Le Directeur d’ARS [qui] coordonne l’évolution du système hos-
pitalier […] peut demander à des établissements publics de
santé :
1/ de conclure une convention de coopération,
2/ de conclure une convention de CHT, de créer un GCS ou un
GIP. […]
Dans l’hypothèse où sa demande n’est pas suivie d’effet, le Di-
recteur d’ARS peut prendre [autoritairement] toutes les mesures
appropriées.
9
ACCES DE TOUS À DES SOINS DE QUALITÉ
Art. 36. Soins « de premier recours »
Les soins de premier recours […] sont organisés par l’ARS au ni-
veau du territoire et conformément au SROS. [Ils] comprennent :
1/ la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le
suivi des patients,
2/ la dispensation et l’administration des médicaments, produits
et dispositifs médicaux ainsi que le conseil pharmaceutique,
3/ l’orientation dans le système de soins et le secteur médico-
social,
4/ l’éducation pour la santé.
Les soins de second recours, non couverts par l’offre de premier
recours, sont organisés dans les mêmes conditions. […]
Suivent la définition du médecin généraliste et du pharmacien
de premier recours.
Loi HPST Les dispositions qui intéressent les cardiologues libéraux
Pour l’avoir si
bien défendue
au Parlement
sous le nom
HPST, Roselyne
Bachelot a gagné
le droit de laisser
son patronyme à
« sa » loi !
Pascal Wolff

Le Cardiologue 324 – Septembre 2009
Loi HPST
Fenêtre sur
Art. 40. Pôles de Santé
Les pôles de santé assurent des activités de soins de premier re-
cours […], le cas échéant de second recours […] et peuvent par-
ticiper aux actions de prévention, de promotion de la santé et de
sécurité sanitaire […]. Ils sont constitués entre des professionnels
et, le cas échéant, des maisons de santé, des centres de santé,
des réseaux de santé, des établissements de santé, des établisse-
ments et des services médico-sociaux, des GSC. […]
Art. 41. Financement de la coordination
Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles
de santé […] peuvent percevoir une dotation de financement du
FIQCS […] Cette dotation contribue à financer l’exercice coor-
donné des soins. […]
Art. 43. Contrat santé solidarité
Un arrêté […] détermine pour une période de cinq ans, le nombre
d’internes à former par spécialité […] et par subdivision territo-
riale compte tenu de la démographie médicale […]
Le SROS détermine les zones dans lesquelles le niveau de l’offre
de soins médicaux est particulièrement élevé. A l’échéance d’un
délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du SROS, le
directeur de l’ARS évalue la satisfaction des besoins en implan-
tations pour l’exercice des soins de premier recours. […] Si cette
évaluation fait apparaître que les besoins ne sont pas satisfaits,
[…] le directeur de l’ARS peut proposer aux médecins […] d’ad-
hérer à un contrat santé solidarité par lequel ils s’engagent à
contribuer à répondre aux besoins de santé de la population […]
où les besoins ne sont pas satisfaits. Les médecins qui refusent de
signer un tel contrat, ou qui ne respectent pas les obligations qu’il
comporte pour eux, s’acquittent d’une contribution forfaitaire an-
nuelle au plus égale au plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
Art. 49. Permanence et continuité des soins
Cet article organise les conditions de fonctionnement de la mis-
sion de service public de permanence des soins et, au nom de la
continuité, des soins stipule :
lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des
raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses pa-
tients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence.
Le médecin doit également informer le conseil départemental
de l’Ordre de ses absences programmées […]. Le CDO veille au
respect de l’obligation de continuité des soins et en informe le
directeur de l’ARS.
Art. 51. Coopération et transfert d’activité
[…] Les professionnels de santé peuvent s’engager, à leur ini-
tiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet
d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins
ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient.
[…] Les professionnels [concernés, Ndlr] soumettent à l’ARS des
protocoles de coopération. Le directeur d’ARS autorise la mise en
œuvre de ces protocoles par arrêté après avis de la HAS. […]
Art. 53. Secteur optionnel
[…] A défaut de conclusion avant le 15 octobre 2009 d’un ave-
nant conventionnel […] autorisant des médecins relevant de cer-
taines spécialités sous des conditions tenant notamment à leur
formation, à leur expérience professionnelle, à la qualité de leur
pratique et à l’information des patients sur leurs honoraires, à
pratiquer de manière encadrée des dépassements d’honoraires
pour une partie de leur activité. […]
Art. 54. Refus de soins
Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une person-
ne […] au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complé-
mentaire [CMU, Ndlr]. Toute personne qui s’estime victime d’un
refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l’organisme
local d’Assurance Maladie ou le président du conseil territoriale-
ment compétent de l’Ordre professionnel concerné des faits qui
permettent d’en présumer l’existence. Cette saisine vaut dépôt
de plainte. […]
Art. 57. Dispositifs médicaux
Lorsque l’acte ou la prestation inclut la fourniture d’un disposi-
tif médical, l’information écrite délivrée gratuitement au patient
comprend, de manière dissociée, le prix d’achat de chaque élé-
ment de l’appareillage proposé, le prix de toutes les prestations
associées, ainsi qu’une copie de la déclaration de fabrication du
dispositif médical.
Art. 59. Développement professionnel continu
Le développement professionnel continu a pour objectifs l’éva-
Le glossaire de la Loi HPST
AMU Aide Médicale Urgente
ARS Agence Régionale de Santé
CDO Conseil Département de l’Ordre (des Médecins)
CHT Communauté Hospitalière de Territoire
CME Conférence Médicale d’Établissement
CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
CRSA Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
DPC Développement Professionnel Continu
ESPIC Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
ETP Education Thérapeutique du Patient
FIQCS Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination
des Soins
GCS(M) Groupement de Coopération Sanitaire (de Moyens)
GIE Groupement d’Intérêt Économique
GIP Groupement d’Intérêt Public
HAS Haute Autorité de Santé
ONDAM Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie
PRS Projet Régional de Santé
SROS Schéma Régional d’Organisation des Soins
URPS Union Régionale des Professions de Santé
T2A Tarification A l’Activité (appelé aussi TAA)

Le Cardiologue 324 – Septembre 2009
luation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des
connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique
et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue
une obligation pour les médecins. Un décret en Conseil d’État dé-
termine les modalités selon lesquelles :
1/ les médecins satisfont à leur obligation […] ainsi que les critè-
res de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
2/ l’organisme gestionnaire du DPC, après évaluation par une
commission scientifique indépendante, enregistre l’ensemble des
organismes concourant à l’offre de DPC et finance les program-
mes et actions prioritaires. Un décret fixe les missions, la com-
position et les modalités de fonctionnement de la commission
scientifique indépendante.
Les instances ordinales s’assurent du respect par les médecins de
leur obligation de DPC.
La gestion des sommes affectées au DPC, y compris celles pré-
vues le cas échéant par les conventions […], est assurée pour
l’ensemble des professions de santé par l’organisme gestionnaire
du DPC. Cet organisme est doté de la personnalité morale et […]
peut comporter des sections spécifiques à chaque profession. Les
modalités d’application du présent article, notamment les règles
de composition du conseil de gestion de l’organisme gestionnaire
du DPC, les modalités de création de sections spécifiques et les
règles d’affectation des ressources à ces sections sont fixées par
voie réglementaire. […]
Art. 78. Télémédecine
La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance
utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs
professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un
professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels
apportant leurs soins au patient.
Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer pour un patient à
risque, un suivi à visée préventive ou un suivi postthérapeutique,
de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeu-
tique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des
prestations ou des actes ou d’effectuer une surveillance de l’état
des patients.
La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions
de mise en œuvre et de prise en charge financière sont fixées par
décret en tenant compte des déficiences de l’offre de soins dues
à l’insularité et à l’enclavement géographique. […]
9
PREVENTION ET SANTE PUBLIQUE
Art. 84. Education Thérapeutique du Patient (ETP)
L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du
patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome
en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en amé-
liorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et
ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et
des médicaments afférents à sa maladie. Les compétences né-
cessaires pour dispenser l’ETP sont déterminées par décret. […]
Les programmes d’ETP sont conformes à un cahier des charges
national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont dé-
finis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces programmes
sont mis en œuvre au niveau local, après autorisation des ARS. Ils
sont proposés au malade par le médecin prescripteur et donnent
lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé. Ces program-
mes sont évalués par la HAS.
9
ORGANISATION TERRITORIALE
DU SYSTEME DE SANTE
Art. 118. Mission et compétences des ARS et planifica-
tion régionale de la politique de santé (1)
Dans chaque région […] une ARS a pour mission de définir et
de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes
et d’actions concourant à la réalisation, à l’échelon régional et
infrarégional :
- des objectifs de la politique nationale de santé […]
- des principes de l’action sociale et médico-sociale […]
- des principes fondamentaux […] du code de la Sécurité sociale
Les ARS contribuent au respect de l’ONDAM.
Les ARS sont dotées d’un conseil de surveillance (dont la loi sti-
pule plus loin qu’il est présidé par le Préfet de région) et dirigées
par un directeur général.
Auprès de chaque ARS sont constituées :
- une conférence régionale de la santé et de l’autonomie, chargée
de participer par ses avis à la définition des objectifs et des ac-
tions de l’agence […]
- deux commissions de coordination des politiques publiques
[…] dans le domaine de la prévention […], dans le domaine
[médico-social]
Les ARS mettent en place des délégations territoriales dans les
départements […]
Art. 123. Représentation des professions libérales
Dans chaque région […] une union régionale des professionnels
de santé représente, pour chaque profession, les représentants
des professionnels de santé exerçant à titre libéral. Ces URPS
sont regroupées en une fédération régionale des professionnels
de santé. […]. Les modalités de fonctionnement des URPS et de
leurs fédérations sont définies par décret en Conseil d’État. […]
Les électeurs de l’union régionale rassemblant les médecins sont
répartis trois collèges qui regroupent respectivement :
1/ les médecins généralistes ;
2/ les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ;
3/ les autres médecins spécialistes […]
Les URPS peuvent conclure des contrats avec l’ARS et assurer
des missions particulières impliquant les professionnels de santé
libéraux dans les domaines de compétence de l’agence. Elles as-
sument les missions qui leur sont confiées dans les conventions
nationales […].
n
(1) Le Cardiologue publiera un prochain « Grand Dossier » consacré à la future
gouvernance régionale
Loi HPST Les dispositions qui intéressent les cardiologues libéraux
1
/
5
100%