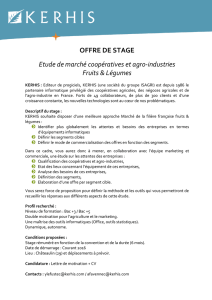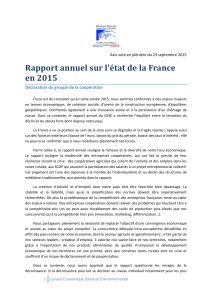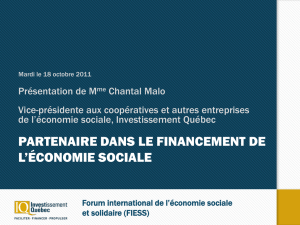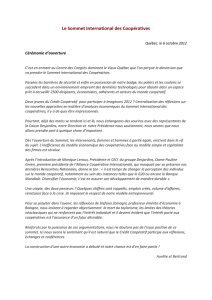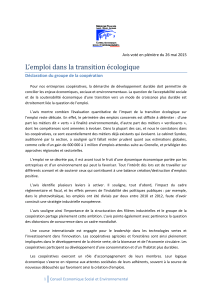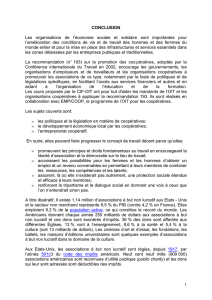Mise en page 1 - Sommet international des coopératives

Le repositionnement des coopératives féminines dans le
champ économique ivoirien: un secours pour l’État?
Koffi Parfait N’GORAN1
Introduction
En Côte d’Ivoire, comme dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, les politiques
économiques postindépendances ont mis un accent particulier sur la création
d’organisations coopératives pour soutenir le développement économique et social.
L’incitation des populations au regroupement était liée à la nécessité pour l’État
d’accroître la production de manière à financer les infrastructures, grâce aux recettes
générées par la vente des produits d’exportation. En 1963 par exemple, déjà 23
coopératives et 772 groupements à vocation coopérative (GVC) opérant dans la
production et la commercialisation étaient en activité. L’embellie économique des
années 1960 et 1970 et les mesures incitatives telles la « Coupe Nationale du Progrès»2
ont suscité une grande adhésion des populations à cette politique de création des
coopératives. Toutefois, ce qui est frappant dans l’évolution des politiques économiques
du pays, c’est la marginalisation plus ou moins marquée des coopératives féminines qui,
pendant longtemps, sont apparues comme le maillon faible du mouvement coopératif
ivoirien (Dibi, 2001). Comparées à celles des filières des produits d’exportation, on lie le
peu d’intérêt accordé par l’État aux coopératives féminines à la faiblesse des devises
tirées des productions vivrières (Bureau et al., 1984). En réalité, le « miracle ivoirien»
réalisé grâce aux performances de l’agriculture d’exportation ainsi que la sexualisation
de fait dans le domaine agricole a fortement contribué à dévaloriser l’économie des
productions vivrières. Mais, combinée au développement accéléré des villes, à l’exode
rural, à l’accroissement rapide de la population et à la forte demande urbaine en produits
alimentaires, la crise économique des années 1980 a accru l’importance du secteur
vivrier. Ainsi, avec la libéralisation progressive de l’économie et la mise en place d’une
nouvelle loi coopérative (Loi n°97-721 du 23 décembre 1997), de nombreuses femmes
se regroupent dans des organisations plus ou moins structurées pour mener leur activité.
Dans les domaines de la production, de la distribution/commercialisation des produits
vivriers, les coopératives féminines acquièrent de la notoriété et du prestige. Elles se
donnent à voir comme des entreprises à travers lesquelles se construit un leadership
féminin sur le plan économique. Au regard de ce qui précède, quelles sont pour l’État
les conséquences du repositionnement de ces organisations féminines dans le champ
économique ? De façon spécifique, comment ces coopératives ont-elles construit leur
leadership ? Représentent-elles une option crédible contre le chômage et la montée de
L’étonnant pouvoir des coopératives ...29...
02-N’Goran_Mise en page 1 12-09-05 13:57 Page29

la pauvreté ? La thèse sur laquelle repose cet article est la suivante : les coopératives
féminines génèrent des emplois plus ou moins stables pour les femmes et les jeunes.
Dans un contexte de rétrécissement du marché de l’emploi salarié, elles apparaissent de
ce point de vue comme un palliatif à l’incapacité de l’État à trouver des solutions
efficaces et durables pour les groupes sociaux les plus exposés à la pauvreté et à la
précarité sociales.
Ancrage conceptuel et méthodologique de l’étude
Au-delà des particularités socioéconomiques ainsi que des contradictions possibles dans
la pratique, l’identité coopérative repose sur sept principes et règles de bases dits
démocratiques, définis par les pionniers de Rochdale en 1840 : l’adhésion volontaire et
ouverte à tous, le pouvoir démocratique exercé par les membres, la participation
économique, l’autonomie et l’indépendance, l’éducation, la formation et l’information,
la coopération entre coopératives et l’engagement envers la communauté. Ces principes
et règles amènent à organiser la définition de la coopérative autour de son rôle dans les
processus de développement économique et social. Selon l’Alliance coopérative
internationale (ACI), la coopérative est « une association autonome de personnes
volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux
et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où
le pouvoir est exercé de façon démocratique ». Cette définition embrasse à la fois la
dimension sociale (une association), économique (une entreprise) et politique (la
propriété collective et l’exercice démocratique du pouvoir) du développement.
Dans l’Europe du XIXesiècle, les coopératives furent un instrument de lutte pour les
travailleurs agricoles et les ouvriers contre l’exploitation capitaliste (Dibi, 2001). Elles
furent mobilisées par les classes populaires pour revendiquer l’amélioration de leurs
conditions de travail et contester la reproduction des inégalités sociales. En Afrique
subsaharienne, le système coopératif a été organisé dans le cadre d’une politique
internationale qui considère les coopératives comme l’outil par excellence pour libérer
les pays en développement (Dia, 1952). Cette orientation a été reprise par la Côte d’Ivoire
lors de son indépendance en 1960. Les coopératives se sont développées sous
l’impulsion de l’État et ont principalement servi à insuffler de l’énergie à la politique de
production des matières premières agricoles (café et cacao notamment), piliers de
l’économie nationale. L’on estime d’ailleurs que cette collusion entre le rôle des
coopératives et les objectifs de la politique économique définie par le parti-État d’alors
a fortement fragilisé le mouvement coopératif ivoirien. Car, même si elles servaient à
soutenir la croissance, les coopératives étaient aussi mobilisées comme un instrument
de contrôle social et politique (N’goran, 2008). C’est un des traits caractéristiques du
...30... L’étonnant pouvoir des coopératives
02-N’Goran_Mise en page 1 12-09-05 13:57 Page30

mouvement coopératif dans de nombreux pays africains. Develtere (2009) fait remarquer
que la soumission à des impératifs économiques et idéologiques a fait perdre au système
coopératif africain, son caractère volontaire et autonome. Aujourd’hui, on assiste à
travers le monde à d’importantes évolutions dans le mouvement coopératif. Ces
évolutions sont marquées, non seulement par la redéfinition d’un cadre juridique et
institutionnel pour soutenir les activités des coopératives, mais aussi par une plus grande
reconnaissance de celles-ci dans la lutte contre la pauvreté. En effet, les inégalités et la
pauvreté induites par la mondialisation néolibérale ont provoqué un regain d’intérêt pour
l’économie sociale. Dans ce contexte, les vertus des coopératives refont surface
(Kamdem, 2010). Désormais, les coopératives apparaissent comme une solution
alternative viable (Gueye, 2010) face à la crise économique et financière qui frappe la
planète. De plus, à l’échelle internationale comme à l’échelle nationale, les coopératives
sont reconnues comme un instrument puissant de production de richesses, de création
d’emplois et de promotion d’un développement social inclusif (Molina, 2010). Elles
opèrent dans divers domaines d’activités, emploient plus de 100 millions de femmes et
d’hommes à travers le monde et comptent plus de 800 millions de membres (Levin,
2003).
En Côte d’Ivoire, l’évolution du cadre institutionnel des coopératives en 1997 a
considérablement modifié le visage du mouvement coopératif. Dans le secteur vivrier,
le taux de création des coopératives féminines s’est très vite accru. De tailles variées et
plus ou moins structurées selon les cas, ces coopératives féminines répondent aux
besoins alimentaires d’une population urbaine de plus en plus croissante. En plus de cela,
les activités économiques qu’elles développent génèrent des emplois directs et indirects
non négligeables.
Mais qu’est-ce qui explique notre intérêt pour les coopératives féminines et
particulièrement pour celles qui opèrent dans la distribution/commercialisation des
produits vivriers ? Premièrement, ces coopératives se sont développées de façon plus ou
moins marginale et n’ont pas bénéficié des mêmes appuis que les coopératives dans le
secteur des cultures d’exportation. Deuxièmement, depuis la mise en place de la nouvelle
Loi coopérative, de nombreuses initiatives de création des coopératives sont portées par
les femmes. Enfin, à travers les activités qu’elles mènent, les coopératives féminines
offrent des opportunités d’insertion sociale aux femmes et aux jeunes qui, du fait de la
crise, ont un accès limité au marché de l’emploi. Sur le plan strictement méthodologique,
la collecte des informations s’est opérée à partir de la recherche documentaire et des
entretiens. Les thèses, mémoires et articles ayant traité des sujets relatifs aux
coopératives, nous ont offert des pistes pour une meilleure lecture de la dynamique
coopérative en milieu féminin. En outre, pour mieux cerner le lien entre le
repositionnement des coopératives féminines et l’alternative qu’elles représentent en
L’étonnant pouvoir des coopératives ...31...
02-N’Goran_Mise en page 1 12-09-05 13:57 Page31

matière de lutte contre le chômage et la pauvreté, des informations de première main
ont été collectées auprès de leaders de l’économie des produits vivriers en Côte d’Ivoire.
Dans ce cas, notre choix s’est porté sur Irié Lou Colette et Botti Rosalie, respectivement
Présidente de la FENACOVICI3et de la COCOVICO4, deux organisations coopératives très
actives dans le secteur vivrier.
Les coopératives féminines dans le mouvement coopératif ivoirien
Historiquement, les regroupements sous forme de coopératives ont commencé sous
l’administration coloniale. Ils ont ensuite connu des évolutions qui les ont fait passer des
Sociétés Indigènes de Prévoyance (SIP) en 1953, aux Sociétés Mutuelles de Production
Rurale (SMPR) en 1953 et aux Sociétés Mutuelles de Développement Rural (SMDR) en
1956. À l’indépendance, l’État hérite du système coopératif colonial et y apporte des
améliorations à travers les textes de loi de 1966 (Loi n°66-251 du 05 août 1966), de
1972 (Loi n°72-853 du 21 décembre 1972) et de 1977 (Loi n°77-332 du 1er juin 1977)
instituant les modalités de constitution et de fonctionnement des coopératives. Dans les
années 90, le mouvement coopératif ivoirien change de visage avec l’adoption en 1997
d’une nouvelle loi coopérative. La « modernisation » des entreprises coopératives et
l’accroissement de leur compétitivité sont le principal leitmotiv de ladite loi. Mais avant
cette mutation de son cadre juridique et institutionnel, le mouvement coopératif ivoirien
était caractérisé par la très faible représentativité des coopératives féminines.
Une apparition plus récente et une faible représentativité
Le mouvement coopératif ivoirien s’est longtemps caractérisé par la prédominance des
coopératives du secteur de l’économie de plantation. Il a fallu attendre pratiquement la
fin de la deuxième moitié de la décennie 1960 pour que les premières coopératives
féminines fassent leur apparition. Ainsi, c’est en 1968 que se crée la coopérative des
vendeuses de poissons de Treichville5. Entre 1982 et 1987, dix GVC féminins opérant
dans la production, la distribution/commercialisation des vivres voient le jour (Zizigo,
1989). Jusqu’à la fin des années 80, la Direction de la Mutualité et de la Coopération
(DMC) a dénombré près de 3000 GVC dont 2555 dans le seul secteur du café et du cacao,
337 dans le secteur du coton, et le reste dans les secteurs du vivrier, de la pêche, de
l’élevage, du transport et de l’habitat.
Les données ci-dessus montrent qu’au fil du temps, le nombre de coopératives féminines
a relativement augmenté. Mais le niveau d’accroissement reste très faible par rapport
aux coopératives du secteur des cultures d’exportation. C’est notamment autour de
quelques leaders féminins comme Nanti Lou Rosalie, Zamblé Lou Madeleine et Irié Lou
Colette que se mettent en place les réseaux de regroupements les plus connus du secteur
...32... L’étonnant pouvoir des coopératives
02-N’Goran_Mise en page 1 12-09-05 13:57 Page32

vivrier en Côte d’Ivoire. D’une manière générale, ces coopératives féminines sont des
initiatives endogènes organisées autour des affinités ethniques, religieuses (N’goran,
2008) ou socioprofessionnelles (Kouadio, 2010).
La configuration du mouvement coopératif dans le contexte actuel tranche avec celle
qui a prévalu jusqu’à la fin des années 90. Il y a une nette évolutionqui se traduit par la
multiplication des initiatives de création de structures coopératives féminines tant dans
le domaine de la production que dans le domaine de la distribution/commercialisation
des produits vivriers. Mais en réalité, la faible proportion des coopératives féminines
dans le mouvement coopératif ivoirien est à mettre en lien avec les distorsions entre
productions d’exportation et productions vivrières dans les politiques économiques de
la Côte d’Ivoire (Diabaté, 1973 ; Dibi, 2001 ; N’goran, 2008).
Une position tributaire des enjeux économiques nationaux
À l’indépendance, la Côte d’Ivoire, sous l’impulsion d’Houphouët Boigny,6se lance dans
une politique volontariste de développement de l’agriculture d’exportation. Pour ce faire,
d’importantes structures étatiques telles que la CFDT7, la MOTORAGRI8, la SATMACI9sont
créées. Des investissements massifs sont faits. Par ailleurs, les plans de développement
économique et social insisteront sur la nécessité de mettre en place une agriculture de
groupe qui devrait permettre des économies d’échelle. Pour atteindre cet objectif, l’État
met un accent particulier sur le regroupement des producteurs en coopératives afin
d’accroître la productivité agricole. En fait, les missions assignées aux coopératives
coïncident avec la vision des gouvernants ivoiriens : stimuler la production afin que par
le jeu de l’exportation, des devises puissent être engrangées pour assurer la « moder -
nisation» et le développement du pays. Pour ce faire, l’État institue la « Coupe Nationale
du Progrès » en 1967 pour célébrer les producteurs les plus méritants. L’on évalue à
environ 3 000, le nombre d’exploitants agricoles ayant été récompensé, et à plus d’un
milliard de francs CFA le montant déboursé par l’État pour récompenser les lauréats dans
le cadre de la « Coupe Nationale du Progrès ».
Très vite, la bonne tenue des cours des matières premières agricoles sur le marché
mondial favorise l’émergence d’une économie florissante. Jusqu’en 1980, la Côte d’Ivoire
a un taux de croissance de l’ordre de 8 % (Kipré, 2005: 225). Cette performance baptisée
« miracle ivoirien » va conforter l’État dans la poursuite de la politique d’extension de
l’économie de plantation. L’attention particulière qu’il accorde au secteur des cultures
d’exportation contribue à reléguer le secteur vivrier et ses acteurs au second plan. Or en
quantité, les productions vivrières représentent au moins deux fois l’ensemble de la
production des cultures d’exportation et interviennent dans la sécurité alimentaire. En
2002 par exemple, avec un volume de 11 000 000 tonnes, les cultures vivrières viennent
L’étonnant pouvoir des coopératives ...33...
02-N’Goran_Mise en page 1 12-09-05 13:57 Page33
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%