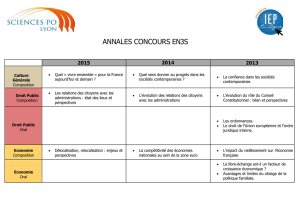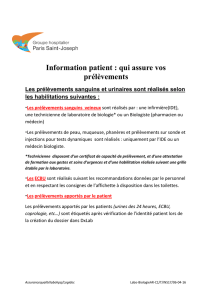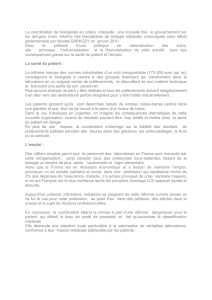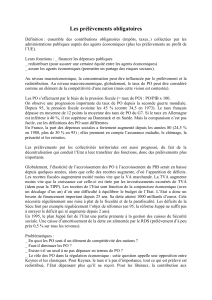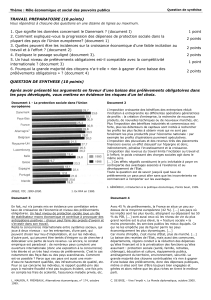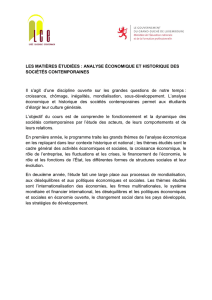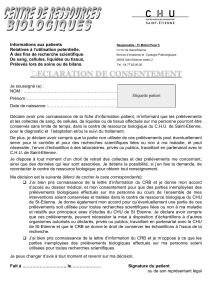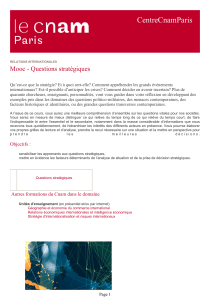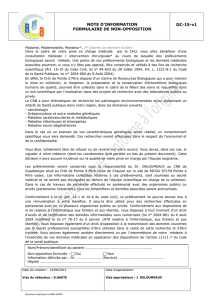mise - Ecricome, concours aux ecoles de commerce

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
ESPRIT DE L’ÉPREUVE
ÉPREUVES SPÉCIFIQUES
annales officielles
SUJET CORRIGÉ RAPPORT
ESPRIT GÉNÉRAL
Le préambule du programme officiel d’AEHSC (BO du 20 juillet 1995) rappelle que l’en-
seignement “a pour objet l’étude des principaux phénomènes économiques et sociaux
aux XIXème et XXème siècles”. Cette matière “se situant principalement dans la conti-
nuité des enseignements de la série économique et sociale du baccalauréat général”
est caractérisée par l’interdisciplinarité entre l’analyse historique, économique et
sociale. Elle se démarque donc de l’enseignement universitaire spécialisé. L’épreuve du
concours exige une démarche synthétique de la part des candidats et les amène à
confronter l’analyse économique et sociale aux données historiques de ces deux
derniers siècles.
L’AEHSC a pour objectif de donner aux étudiants des instruments d’analyse et des clés
de compréhension du monde contemporain afin qu’ils soient capables de proposer une
réflexion autonome à propos de phénomènes complexes. Ils sont donc invités à s’af-
firmer par le choix de leurs références et de leurs arguments ainsi que par la fermeté
de leurs conclusions personnelles. Jamais la correction des copies ne sanctionne les
opinions exprimées.
Cette épreuve, abordable mais sélective, doit permettre de mettre en valeur la matu-
rité intellectuelle nécessaire pour suivre avec profit l’enseignement dispensé dans les
ESC de la banque d’épreuves Ecricome.
Forme de l’épreuve
Le candidat traite l’un des deux sujets proposés sous forme de dissertation. Les sujets
peuvent couvrir en totalité ou en partie le champ historique du programme, voire se
limiter à une période récente. Ils ne correspondent jamais à une question de cours et
offrent toujours la possibilité de développer une “réflexion autonome”. La dissertation
consiste à démontrer deux (ou trois) idées directrices par des arguments reposant sur
des références théoriques et des exemples historiques précis et diversifiés.
Evaluation
L’évaluation des devoirs tient compte de la présentation matérielle (lisibilité de
l’écriture, clarté de la mise en page), de la correction orthographique et de la maî-
trise de la langue (vocabulaire, syntaxe, style).
Elle repose surtout sur une claire définition des concepts, des “mots clés” et sur
la rigueur de la formulation de la problématique et de l’argumentation. Le choix
judicieux des références théoriques et des exemples historiques est valorisé.
246
ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
>>

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
ÉPREUVES SPÉCIFIQUES
annales officielles
Cette année, 2526 candidats ont composé ; l’équipe de correcteurs comptait 29
membres, le nombre de copies corrigées par professeur s’élevait de 63 à 100.
Les sujets ont été globalement appréciés par les étudiants et les professeurs :
“Les sujets étaient intéressants et ne présentaient pas de piège”. Les enseignants les
ont trouvés cohérents vis-à-vis de l’enseignement dispensé dans les classes prépara-
toires et suffisamment discriminants pour distinguer les candidats.
Le choix des candidats a été assez équilibré car le premier sujet a été sélectionné
par 60 % d’entre eux et donc le second par 40 %. La moyenne générale des deux sujets
s’élève à 10,03 et l’écart-type s’établit à 3,82. Les notes s’échelonnent de 1 à 20.
19,5 % des candidats ont obtenu une note supérieure ou égale à 14/20, alors que
18,9 % n’ont pas atteint 7/20.
APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES DES CORRECTEURS
Les correcteurs ont observé qu’il y avait très peu de copies fantaisistes ou sans
aucun contenu. Globalement, les règles de la dissertation sont mieux respectées (défi-
nition des termes, analyse du sujet, construction, présentation). Presque toutes les
copies sont clairement construites et formalisées. Mais l’absence de vraie problématique
a été pénalisante. On reconnait en général d’assez bonnes connaissances factuelles.
Il ne faut pas oublier que, pour tous les sujets qui n’ont pas de limites chrono-
logiques explicites, les candidats se doivent d’en définir une et de la justifier.
247
ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
>>
ESPRIT DE L’ÉPREUVE SUJET CORRIGÉ RAPPORT
SUJET 1
La dotation en facteurs explique-t-elle l'évolution de la spécialisation
internationale des nations ?
SUJET 2
RAPPORT
Les prélèvements obligatoires représentent-ils un frein à la
croissance économique dans les PDEM?
ÉPREUVE 2006
Durée : 4 heures
Aucun document n’est autorisé. Le candidat traitera au choix l’un des deux sujets suivants.

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
ESPRIT DE L’ÉPREUVE
ÉPREUVES SPÉCIFIQUES
annales officielles
SUJET CORRIGÉ RAPPORT
Il convient d’éviter de citer un auteur dont on ne maîtrise pas l’orthographe du
nom ou dont on se remémore très vaguement la théorie. Il faut bannir “l’à peu près“,
car cela dessert évidemment le candidat.
L’orthographe doit être surveillée, il semble que la relecture de certaines copies
ait été beaucoup trop sommaire. Parfois des mots manquent dans le texte, car leur
rajout n’a pas été effectué lors de la lecture finale.
Les correcteurs ont été particulièrement sensibles à la définition des termes prin-
cipaux des deux sujets.
Les principaux reproches ont porté principalement sur :
L’absence de comparaison spatiale et temporelle,
L’insuffisance ou la mauvaise maîtrise des théories attendues,
Les maladresses de construction de la dissertation.
APPRÉCIATIONS DES CORRECTEURS CONCERNANT LE SUJET 1
Le sujet 1 semble un bon sujet puisqu’il a été très discriminant : D’un côté de
très bonnes copies et de l’autre des copies qui n’était pas au niveau attendu. Ce sujet
a aussi permis d’évaluer les compétences acquises par les élèves dans la discipline.
Ce sujet nécessitait d’abord une définition précise des termes : dotation en
facteurs et spécialisation internationale. Ensuite, il traitait de “l’évolution” de la spé-
cialisation internationale. Or cette dimension a souvent été considérée de façon trop
succincte ou carrément négligée. Certains correcteurs déplorent que l’analyse de la
situation au XIXe siècle ait été souvent sacrifiée. Les changements qui ont marqué la
spécialisation internationale des pays développés à économie de marché et des pays
en développement n'ont pas toujours été bien identifiés. Les facteurs explicatifs
autres que la dotation factorielle n'ont pas été suffisamment repérés et explicités.
L’approche théorique devait être rigoureuse et témoigner de la compréhension des
théories classiques et contemporaines du commerce international. Cette dimension ne
devait toutefois pas conduire à un catalogue en s’affranchissant de toute analyse
problématique : Le simple exposé des théories du commerce international a été péna-
lisé puisqu’il s’agissait de rendre compte de l’évolution des spécialisations.
On déplore fréquemment les plans caricaturaux (type oui/non), le manque de
connaissances sur les “nouvelles théories du commerce international”, des approxima-
tions dans les références des ouvrages d’auteurs (Smith, Ricardo,…).
Les meilleures copies ont une certaine maitrise du modèle HOS, du paradoxe de
Leontiev, du théorème Stolper Samuelson et du théorème de Rybczynski. Cependant,
certains étudiants maîtrisent encore mal l’importance des dotations factorielles dans
les théories du commerce international (commerce des biens comme substitut aux flux
de facteurs). De longs développement sur Smith ou Ricardo ont été pénalisés lorsque
le lien avec des dotations n’a pas été soutenu (par exemple des ressources spécifiques
dans le cas de l’avantage absolu, une plus forte productivité du travail et donc des
écarts technologiques dans le cas des avantages comparatifs ricardiens). Les bonnes
copies ont su intégrer une réflexion sur les hypothèses du modèle HOS pour monter
248
ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
>>

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
ÉPREUVES SPÉCIFIQUES
annales officielles
que l’évolution des spécialisations pouvait être plus complexe dès lors qu’on tenait
compte des coûts de transport, de la qualité des facteurs, de la différenciation des
produits, de rendements d’échelle croissants avec la taille des marchés et la dimen-
sion cumulative des savoirs et savoir-faire etc.). La qualité des exemples choisis a fait
aussi la différence, certaines copies ont montré le rôle des dotations factorielles en
opposant des économies au XIXe (USA/ Royaume Uni). Le rôle de l’Etat dans la
construction des avantages a pu être souligné (cas du Japon, de la Corée, etc.), mais
certains ont su aussi montrer les limites d’une politique allant à l’encontre des dota-
tions factorielles (limites des politiques d’industries industrialisantes). La place des
FMN supposait aussi de faire le lien avec les dotations factorielles (nature plus éphé-
mère des avantages avec la division internationale des processus productifs ou renfor-
cement des écarts aves des effets d’agglomérations et des effets d’apprentissage
cumulatifs etc.).
Les bonnes copies ont été celles où sont précisément présentés les effets des
politiques industrielles sur l’évolution des spécialisations et le rôle des stratégies des
firmes dans le développement du commerce intra-branche c’est-à-dire entre pays ayant
des dotations factorielles proches (commerce franco-allemand par exemple).
APPRÉCIATIONS DES CORRECTEURS CONCERNANT LE SUJET 2
Concernant ce sujet, les correcteurs constatent également qu’il s’inscrit parfaitement
dans la logique du programme.
La plupart des correcteurs a déploré l’insuffisante définition de la notion de “pré-
lèvements obligatoires”. Trop de candidats en sont restés à des considérations très
générales sur l’impôt ou les “charges”. Peu de candidats distinguent clairement
Administrations Publiques et Etat et certains se contentent d’une évocation de
l’intervention de l’Etat en général, car ils ne font pas la distinction impôts – coti-
sations sociales. Le sujet a rarement été analysé avec finesse en intégrant, par
exemple, la structure ou les aspects relatifs des prélèvements obligatoires. Trop peu
de candidats ont été capables de chiffrer le taux de prélèvements obligatoires
aujourd’hui en France.
L’intérêt du sujet portait sur les interactions possibles avec le processus de croissance
économique. Dans de nombreuses copies il y avait des difficultés pour aller au-delà d’un
plan “oui mais” ou “non mais”. Les réponses étaient alors du type : “les prélèvements
obligatoires favorisent la croissance, mais…” Les plans, construits sur le modèle thèse
antithèse sont souvent laborieux, et, pour le fond la campagne électorale récente a
largement obscurci le débat.
Les connaissances sur les évolutions historiques ont été assez limitées. La période
privilégiée est située après 1945, voire même après 1974. Le sujet a été trop
rarement étudié en prenant appui sur les faits, notamment en comparant les niveaux
de prélèvements obligatoires (mal connus) et les niveaux de réussite économique
(comparaison pays scandinaves/Etats-Unis par exemple).
Sur le plan théorique, les candidats ont rarement distingué approche micro de
249
ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
>>
ESPRIT DE L’ÉPREUVE SUJET CORRIGÉ RAPPORT

ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
ESPRIT DE L’ÉPREUVE
ÉPREUVES SPÉCIFIQUES
annales officielles
SUJET CORRIGÉ RAPPORT
l’approche macro des effets des prélèvements obligatoires et des dépenses
publiques ou de la redistribution.
La relation entre les prélèvements obligatoires et les théories de la croissance endo-
gène a été très réductrice en faisant l’hypothèse implicite que cela conduisait à un
accroissement des dépenses publiques et donc à plus d’impôts. La référence à Keynes
s’est souvent limitée à la propension marginale à consommer des bas revenus. Peu de
copies ont intégré la relance keynésienne par l’effet du multiplicateur fiscal et le théo-
rème d’Haavelmö.
Quelques bonnes copies ont développé l’idée que les baisses d’impôts pour soutenir
la relance économique pouvaient rapprocher l’approche keynésienne (multiplicateur
fiscal) et l’approche libérale (courbe de Laffer etc.). Cela a conduit à des politiques
de réduction d’impôts (celles opérées à l’époque de Kennedy et Johnson ou plus tard
par Reagan ou Bush). Cependant l’optique pouvait être différente à long terme (Public
Choice et effet de cliquet de Peacock et Wiseman ou de l’autre la position de l’OFCE
sur la cohésion sociale dans une économie ouverte). Quelques copies ont montré que
les externalités pouvaient conduire à des incitations des agents économiques par des
avantages fiscaux ce qui pouvait amener une réorientation des dépenses publiques.
L’évolution de la structure des prélèvements obligatoires a été un moyen de dépasser
la simple opposition oui mais. Là encore la qualité des exemples a été essentielle pour
consolider l’argumentation.
On a constaté aussi des mauvaises interprétations du sujet :
Souvent en partant d’une définition floue des prélèvements obligatoires certains can-
didats ont surtout traité du rôle de l’Etat dans la vie économique sans références
explicites à la croissance. L’autre contresens a consisté à justifier l’existence ou les
excès des prélèvements obligatoires et la copie dérivait alors rapidement sur le débat
légitimité/efficacité de l’intervention de l’Etat.
La référence à l’actualité suppose aussi quelques efforts de distanciation des candi-
dats pour éviter la simple reprise des discours de campagne électorale présidentielle
sans réelle analyse (effet Johnny Halliday, etc.).
ANALYSE DU SUJET 1 ET BARÈME
La dotation en facteurs explique-t-elle l'évolution de la spécialisation internationale
des nations ?
Présentation du sujet
La question de la spécialisation internationale des nations est un grand classique
de l’analyse économique et intègre très largement une dimension historique et une
confrontation analyse économique/histoire. Il s’agit essentiellement de s’appuyer sur
les analyses des économistes pour voir en quoi la dotation factorielle rend compte de
l’évolution des structures de l’échange international et des spécialisations, et réfléchir
aux autres explications que l’on peut avancer.
La spécialisation internationale des nations est la répartition de la production
mondiale de biens et services entre pays. La division internationale du travail (DIT) est
250
ANALYSE ÉCONOMIQUE ET HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES
>>
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%