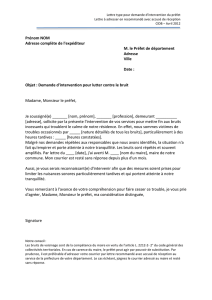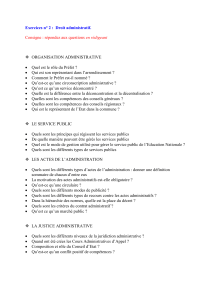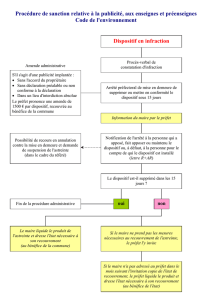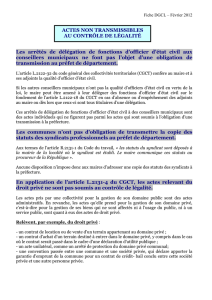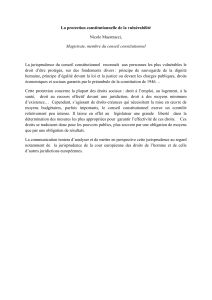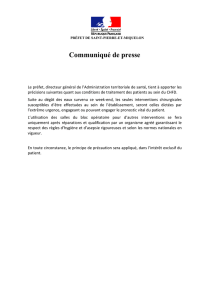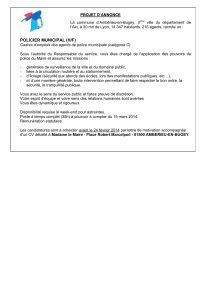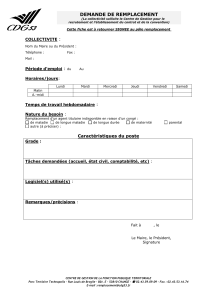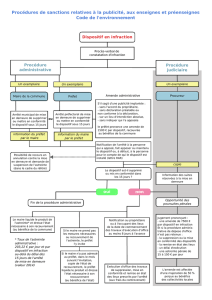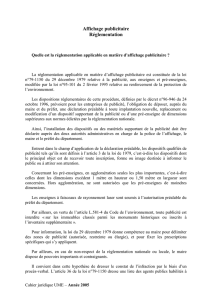Plaquette intro public - Aix*Marseille Université

Introduction
au droit public
Cours présenté par Guillaume Ciccolini
2012/2013
Aix-Marseille Université
Parcours administration - L1 - 2nd semestre
Guillaume Ciccolini
1

Chapitre introductif :
La place du droit public
I- Définition du droit
S’agissant de définir la notion de droit, la difficulté vient de ce que le terme est
polysémique. Ainsi, le terme a deux acceptions principales.
Au singulier, le terme droit désigne l’ensemble des normes obligatoires qui s’imposent
aux membres de la société. On parle alors du droit objectif. Exemple : le juge applique
le droit.
Au pluriel, le terme prend un autre sens puisqu’il désigne des prérogatives accordées
aux individus. Ces droits étant variables en fonction des individus concernés, on parle
de droits subjectifs. Exemple : j’ai le droit d’utiliser cette voiture puisque j’en suis
propriétaire.
II- Les caractéristiques de la règle de droit objectif
1- Une règle abstraite
La principale caractéristique de la règle de droit est d’être abstraite, c’est-à-dire qu’elle
s’applique de façon générale, et non pas à une personne nommément désignée. Les
normes sont faites pour s’appliquer à tous ou à une catégorie ouverte de personnes
(exemple : les locataires, les salariés, les consommateurs, etc.).
Une norme peut même ne concerner qu’une seule personne, mais sans qu’il soit fait
référence à sa personne. C’est sa qualité qui est visée. Ainsi, l’article 68 de la
Constitution traite de la responsabilité pénale du président de la République. Certes, il
n’existe qu’un seul président, cependant, la règle ne s’applique pas à François Hollande
en tant que tel, mais au président de la République qui se trouve aujourd’hui être
François Hollande.
Dès lors qu’une règle est faite pour s’appliquer à des personnes nommément
désignées, ce ne sont plus des règles de droit, mais des décisions.
2- Une règle obligatoire
Le caractère obligatoire de la règle de droit est fondamental car c’est ce qui la distingue
de la règle de morale. En effet, c’est précisément le caractère coercitif qui différencie
2

par exemple l’interdiction juridique de voler et la règle morale selon laquelle il faut
laisser sa place aux personnes âgées dans les transports en commun.
Le non respect de cette règle de morale entraînera tout au plus l’opprobre générale,
tandis que le fait de commettre un vol est susceptible d’entraîner une sanction pénale.
Ainsi, pour qu’une règle puisse être considérée comme une norme, au sens juridique
du terme, il faut qu’elle soit coercitive, c’est-à-dire que les tribunaux pourront imposer
son application.
III- La summa divisio
Le droit objectif comprend donc l’ensemble des normes juridiques. Cependant, ces
différentes normes peuvent être distinguées selon le domaine sur lequel elles portent.
Ainsi, on distingue tout d’abord deux grandes branches du droit : le droit privé et le
droit public. C’est ce que l’on appelle la summa divisio.
Le droit privé regroupe l’ensemble des règles régissant les rapports entre les personnes
de droit privé, c’est-à-dire les personnes physiques (les individus) et les personnes
morales (les sociétés, les associations, les fondations, etc.). Il arrive même que le droit
privé régisse les rapports entre des personnes de droit privé et l’administration dans de
rares hypothèses, notamment quand l’administration se comporte comme tout un
chacun.
Le droit public comprend l’ensemble des règles organisant l’Etat et ses
démembrements et régissant les rapports entre la puissance publique et les personnes
de droit privé. On distingue au sein de cette catégorie trois composantes :
- le droit constitutionnel, qui traite de l’organisation des pouvoirs et des relations entre
les différentes institutions de l’Etat ;
- le droit administratif qui comprend les règles dérogatoires au droit commun,
applicables à l’administration ;
- les finances publiques, c’est-à-dire les règles relatives aux ressources et aux dépenses
de l’Etat.
L’existence du droit administratif, dérogatoire du droit commun, s’explique par la
particularité de l’action de l’administration qui, afin poursuivre son but de satisfaction de
l’intérêt général, est conduite à exercer des «prérogatives de puissance publique».
Autrement dit, l’administration dispose de pouvoirs qu’elle est la seule à posséder. Elle
pourra, par exemple, procéder à une expropriation en vue de satisfaire l’intérêt général,
chose qu’un particulier ne pourra bien évidemment pas faire.
3

Ainsi, dès lors que l’administration dispose de pouvoirs particuliers en vue de satisfaire
un intérêt supérieur, puisque général, il apparaît normal de la soumettre à un droit qui
tient compte de cette particularité.
Par ailleurs, c’est également un juge particulier qui sera amené à juger l’administration
et à appliquer le droit administratif. C’est pourquoi l’on parle de deux ordres
juridictionnels : l’ordre judiciaire qui applique le droit privé et l’ordre administratif qui
applique le droit administratif.
4

Première partie :
L’administration
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
1
/
80
100%