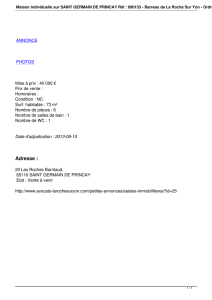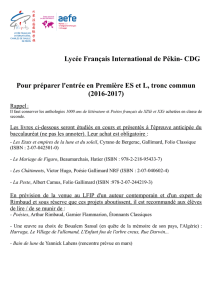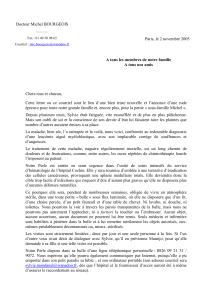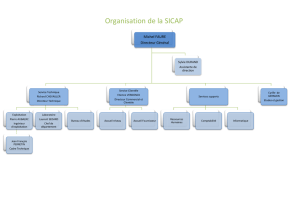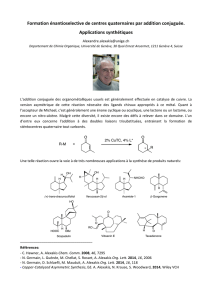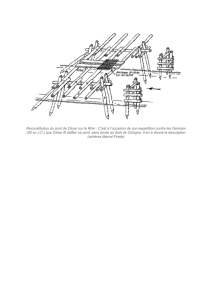Sylvie Germain, « La fabrique de l`imaginaire

1
Sylvie Germain, « La fabrique de l’imaginaire »
Auditorium 61, Recollettenlei 3, 9000 Gent
29/10/15
Biographie
Sylvie Germain est née en 1954 à Châteauroux. D'abord attirée par la peinture et les Beaux-Arts, elle
s’oriente vers la philosophie et suit les cours d'Emmanuel Lévinas à la Sorbonne. Son mémoire de
maîtrise porte sur la notion d’ascèse dans la mystique chrétienne et sa thèse de doctorat a pour thème
le visage (« Perspectives sur le visage, transgression, décréation, transfiguration »). En 1985, elle publie
son premier roman, Le Livre des nuits. De 1986 à 1993, elle vit à Prague. Durant cette période, elle écrit
Jours de colère qui obtient le prix Femina en 1989.
Son œuvre forte et singulière se compose d’une trentaine de livres, romans et essais, marqués par
l’aspiration à un au-delà du réel et par une quête du sens métaphysique des souffrances humaines. Il y
est question de la misère et du mal qui habitent l’univers mais, chaque fois, une illumination donne sens
aux malheurs et aux humiliations. Certains livres mettent l’accent sur la dimension proprement
religieuse de cette quête, comme L’Enfant méduse ; d’autres sont nourris de références bibliques, tel
Tobie des marais. Transfigurations et mythologie nouvelle mettent souvent l’histoire à contribution. Le
thème de l’effacement, de la disparition progressive des êtres, des choses et de la mémoire revient dans
plusieurs de ses récits, notamment dans son dernier roman, Hors Champ.
Source : Ecrire, écrire, pourquoi ? Sylvie Germain, Editions de la Bibliothèque publique d’information,
2010, p. 3.

2
Bibliographie sélective
Le Livre des nuits, Gallimard, 1984, Folio, 1987
Nuit-d’Ambre, Gallimard, 1986, Folio, 1989
Opéra muet, Maren Sell, 1989, Folio, 1991
Jours de colère, Gallimard, 1989, Folio, 1991 ; prix Femina 1989
L’Enfant méduse, Gallimard, 1990, Folio, 1993
La Pleurante des rues de Prague, Gallimard, 1992, Folio, 1994
Immensités, Gallimard, 1993, Folio, 1995
Patience et Songe de lumière : Vermeer, Flohic, 1993, 1996
Éclats de sel, Gallimard, 1996, Folio, 1997
Les Échos du silence, Desclée de Brouwer, 1996, réédition Albin Michel, 2006
Céphalophores, Gallimard, 1997
Tobie des marais, Gallimard, 1998, Folio, 2000
Etty Hillesum, Pygmalion, 1999
Cracovie à vol d’oiseau, éditions du Rocher, 2000
Chanson des mal-aimants, Gallimard, 2002, Folio, 2004
Les Personnages, Gallimard, 2004, Folio 2009
Ateliers de Lumière, Desclée de Brouwer, 2004
Magnus, Albin Michel, 2005, Folio, 2007, prix Goncourt des lycéens 2005
L’Inaperçu, Albin Michel, 2008, Livre de Poche, 2010
Hors Champ, Albin Michel, 2009
Patinir, Paysage avec Saint Christoph, Éditions Invenit, 2010
Quatre actes de présence, Desclée de Brouwer, 2011
Chemin de croix, Bayard Centurion, 2011
Le monde sans vous, Albin Michel, 2011, Prix Jean-Monnet de littérature européenne du
département de Charente
Rendez-vous nomades, Albin Michel, 2012
Petites scènes capitales, Albin Michel, 2013
Entretien
Sylvie Germain. Entretien avec Xavier Houssin
Francine Figuière : Merci à Sylvie Germain de venir nous parler de son travail et de son écriture qui,
souvent, interroge le sens de l’existence, le mal qui est dans le monde et dans l’homme, mais qui
cherche aussi à tracer des voies de la nuit vers la lumière. Xavier Houssin nous servira de guide dans
cette écriture poétique, foisonnante, singulière, où se mêlent tour à tour sacré et merveilleux.
[…]

3
Xavier Houssin : Peut-être pouvons-nous commencer par lire un extrait, dont je dirai après d’où il est
issu.
« Qui va là ? »
Et si telle était la question initiale qui abruptement se pose, – s’impose, à tout lecteur ouvrant un livre
et s’apprêtant à s’aventurer dans les méandres d’un texte ? Qui donc est dans ces pages, qui se tient
en amont de ce livre, qui va au fil des lignes, qui parle dans ces phrases ?
Qui va là ? L’auteur et ses personnages se trouvent interpellés. Mais l’interpellation a commencé bien
avant déjà : dès que l’auteur a convoqué ses personnages, ou plutôt, dès que les personnages, encore
informes, innomés, incertains, s’en sont venus solliciter l’auteur, quérir son attention et provoquer en
lui désir, curiosité, tourment. Car d’où provient au juste l’initiative : de l’auteur, ou des figures qu’il
met en forme, en situation, en scène ?
L’auteur est peut-être bien le premier à lancer cette interrogation : qui sont ceux-là, celles-là, qui
rôdent aux confins de ses songes, de sa mémoire, et qui soudain s’acheminent dans ses pensées en
soulevant sur leur passage un poudroiement de clair-obscur, de chuchotis et de soupirs, et arpentent
son imaginaire d’un pas toujours plus vif et impérieux ? D’où viennent-ils, qui les envoie, que veulent-
ils ? De quelle étoffe sont-ils faits, de quelle encre bruissent-ils, de quels corps sont-ils les ombres
projetées ?
À défaut de trouver la réponse, qui d’ailleurs lui importe peu tant prime en lui le désir de donner
texture, voix et mouvement à ces ombres diaphanes, l’auteur déplace la question, – en écrivant. En se
risquant dans l’inconnu, donc, en se livrant à l’imprévu. Et le lecteur éventuellement prend le relais de
la question. Et la redéplace à sa manière.
Qui va là ?
Face à toute œuvre, qu’elle soit littéraire, plastique ou musicale, tout comme à l’intérieur de toute
œuvre en train de se créer, se lève cette interrogation entre surprise et trouble.
Qui va là ?
Face à toute personne rencontrée, à tout visage, qu’il soit d’un proche ou d’un passant, d’un familier,
d’un étranger, se formule cette demande, entre étonnement et inquiétude.
Qui va là ?
Face à soi-même soudain frappé, au détour d’un instant, par la flagrance et par l’inévidence de sa
propre existence, d’un même élan, surgit en force cette question, entre stupeur et grande alarme.
Qui va là ?
Face à la mort, le questionnement monte à l’aigu et vibre à l’infini, entre mystère et effroi.
Ces phrases sont tirées de Céphalophore, un livre que vous avez publié en 1997 chez Gallimard dans la
collection L’un et l’autre dirigée par Jean-Bertrand Pontalis. Les saints céphalophores sont, je le rappelle,
sous votre contrôle, ces saints qui, à l’instar de Denis, se relèvent après avoir été décapités, prennent
leur tête dans leurs mains et se mettent en chemin. Ce livre me paraît être au mitan de votre œuvre.
Vous y tissez notamment une relation avec le poète autrichien Georg Trakl. Pouvez-vous nous parler de
ce livre, de qui l’a amené ou de ce qui vous y a conduit ?
Sylvie Germain : J’ai écrit trois livres dans la collection L’un et l’autre, une très belle collection, à
commencer par son titre. J’aime beaucoup qu’un directeur de collection me propose d’écrire pour lui.
S’il est très bon, il vous donne vraiment envie de jouer le jeu en vous accordant totale liberté dans un
cadre à la fois balisé et ouvert. En l’occurrence, le cadre était effectivement très ouvert, car on a

4
tellement d’autres ! Mon premier ouvrage pour cette collection a été La Pleurante des rues de Prague,
Céphalophore étant le deuxième. Il n’a pas du tout marché. Beaucoup de gens n’ont pas compris ce
qu’étaient les céphalophores : on m’a demandé pourquoi j’avais écrit sur les escargots ! Il y avait eu
confusion sur le vocabulaire… Le mot « céphalophore » n’est pas dans le dictionnaire, mais il existe, il
suffit d’aller au Louvre pour voir de très belles représentations de saints céphalophores. On trouve aussi
dans La Légende dorée de Jacques de Voragine des descriptions délirantes de saints ayant subi de
multiples martyres mais qui résistent à tout, qui chantent au milieu des flammes et que les bourreaux,
épuisés mais non résignés, décapitent pour en finir… mais le saint se relève, ramasse sa tête et part avec.
Et parfois, fait extraordinaire, la tête chante.
J’ai repris cette idée, et me suis appuyée sur des expressions du langage courant, souvent pleines de
sens, d’ironie et de poésie ; or, il y a plein d’expressions avec la tête : « perdre la tête », « avoir la tête
vide », « se mettre martel en tête », « avoir la tête ailleurs »… Et comme des hydres, les artistes portent
plein de têtes imaginaires. Cette métaphore me plaisait. Ainsi, dans ce texte, j’évoque aussi Orphée,
l’une des plus belles figures de la mythologie, l’image par excellence de l’artiste – et pas seulement du
poète, du chanteur ou du musicien. C’est une légende d’une grande profondeur dont la fin est d’une
beauté inouïe : Orphée est déchiqueté par les Ménades au point qu’il ne reste que sa tête, arrachée à
son corps démembré, et qui roule dans le fleuve où elle flotte au gré du courant. Cette tête à la dérive et
qui chante encore « Eurydice, Eurydice… » est une image douée d’une immense portée de sens. Ce livre
était une manière métaphorique de parler de la façon dont fonctionne notre imaginaire. Car c’est
toujours la fabrique de l’imaginaire qui m’intéresse, y compris dans les personnages. C’est toujours là
que j’essaie d’aller voir. Qui va là ? On ne sait pas…
Xavier Houssin : L’expression consacrée de « vocation de l’écrivain » correspond-elle à quelque chose
pour vous ? Au fond, […] d’où vous vient cette envie d’écrire ? De qui ou grâce à qui vient-elle ?
Sylvie Germain : C’est difficile à préciser. La réponse varie en fonction des écrivains. Je sais que certains
ont parfois eu très tôt la révélation de leur vocation en lisant certains auteurs qui les ont éblouis et le
désir d’écrire à leur tour les a alors saisis. Mais pour moi, c’est venu assez tardivement. Je me croyais
plutôt – j’ai souvent eu l’occasion de le raconter – une vocation du côté des arts plastiques. Bien que ne
faisant rien de sérieux en ce domaine, je rêvais de devenir peintre ou sculpteur, je fantasmais beaucoup
à ce sujet. Je dessinais, mais sans plus. M’en est au moins resté une passion pour la peinture… Jusqu’en
terminale, j’étais persuadée que je m’inscrirais aux beaux-arts après le bac. Mais, en cours de route, il y a
eu la découverte de la philosophie. Je n’étais pas spécialement brillante dans cette matière, mais un jour,
un sujet de dissertation m’a « mise à l’arrêt » ; il s’agissait d’une phrase célèbre tirée des Frères
Karamazov de Dostoïevski : « Si Dieu est mort, tout est-il permis ? », à traiter en quatre heures. Je n’ai
pas dû rendre une copie très flambante, mais ce n’est pas la question. Je me suis dit que si la philosophie
consistait à tâcher de répondre à des questions auxquelles il n’y a aucune réponse satisfaisante ou
suffisante possible, alors c’était une aventure formidable, sans fin ! C’est cette ténacité du
questionnement qui m’a séduite dans la philosophie. L’année suivante, je me suis donc inscrite à la
Sorbonne, sans mesurer ce qui m’attendait. Je suis revenue au b.a.-ba de la philosophie dont parlent très
bien Aristote et Platon : la philosophie commence par l’art de s’étonner. Cet étonnement, c’est déjà se
demander : Qui va là ? Qu’est-ce qui se passe là ? Quel sens passe par là ? Sens même y a-t-il ?… Donc, je

5
suis allée vers la philo. À l’université, on nous demande d’écrire beaucoup, de formuler notre pensée
« noir sur blanc » avec le plus de rigueur possible, et je crois que cela comblait mon besoin d’exploration
de ce « Qui va là ? », et mon besoin de pister du sens. J’étais très loin de la fiction, mais cela me procurait
une grande jubilation d’écriture. Après la soutenance de ma thèse, c’était fini, je n’avais plus de prétexte
pour écrire – je me les suis donc donnés ; après avoir écrit en marge de mes études des contes pour
enfants, un peu de (très mauvaise) poésie, et quelques petits textes, je suis passée à des nouvelles, puis
au roman. Et l’univers romanesque m’a été d’emblée un formidable territoire où poursuivre, autrement,
le questionnement mené jusque là par les chemins de la philosophie.
La fabrique de l’imaginaire brasse tout, les images, les souvenirs, les sensations, les expériences les plus
diverses, les résidus des connaissances acquises, les rêves, les peurs et les désirs, les idées… Mais dans la
fabrique de l’écriture, il arrive souvent que des questions restent en suspens et j’éprouve alors le besoin
de revenir les interroger, de fouiller, de creuser par un livre qui ne soit pas de la fiction et que, faute de
mot, on peut appeler un essai.
Xavier Houssin : Vous parliez tout à l’heure de peinture : vous avez une très large « palette » d’écriture.
En termes de genres, vous êtes à la fois romancière, essayiste, vous écrivez pour la jeunesse… […] Vous
avez aussi été biographe.
Sylvie Germain : Justement, je ne présentais pas ces livres comme des biographies. La démarche d’un
biographe demande un minimum de formation d’historien. Je ne peux pas me dire biographe et je
n’aimerais pas l’être. Dans une collection, on peut parfois vous demander d’écrire une biographie, mais
je n’ai jamais voulu le faire parce que je n’ai pas la compétence pour cela. Je l’ai fait pour Etty Hillesum
mais j’ai parlé alors de « bio-résonance ». Sa vie fut très brève – une vie volée, assassinée à Auschwitz à
l’âge de vingt-neuf ans. Je me suis appuyée essentiellement sur ses écrits. Ce qui m’intéresse, c’est le
cheminement intellectuel et spirituel de cette femme.
Un autre ouvrage auquel, je crois, vous faites allusion – et cela me fait plaisir parce que je n’ai jamais
l’occasion d’en parler, comme d’autres qui, tel Céphalophores, sont tombés aux oubliettes – est un petit
livre que j’ai écrit sur un poète et graveur tchèque, Bohuslav Reynek. Il est malheureusement très
méconnu en France, voire inconnu, ce qui est regrettable. Il y a quelques gravures de Reynek au musée
des Beaux-Arts de Grenoble, ville à laquelle il était lié par son mariage avec une Grenobloise, Suzanne
Renaud, qui était poète, et dont il avait découvert un recueil chez un bouquiniste à Prague. Séduit par la
poésie de cette femme, il lui a écrit pour lui proposer de traduire ses poèmes – il était traducteur du
français et de l’allemand –, et il a fini par aller à sa rencontre, et par l’épouser. Après une dizaine
d’années passées entre Grenoble et Petrkov, le village de Reynek en Moravie, le couple s’est installé
définitivement en Moravie. Mais la guerre est arrivée, puis, dans la foulée, le communisme. Revenir en
France a été dès lors impossible pour le couple, et leur vie à Petrkov a été très dure, tant sur le plan
matériel qu’intellectuel, et, pour Suzanne Renaud, privée de son pays, de sa famille française, ce fut très
éprouvant. Elle est morte dans les années soixante, lui en 1971, à l’âge de quatre-vingts ans, laissant une
œuvre empreinte d’une profonde spiritualité.
[…]
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%