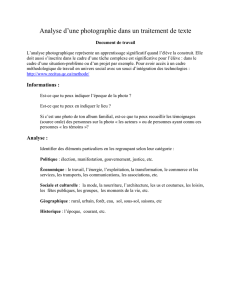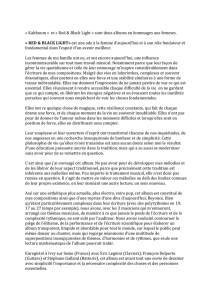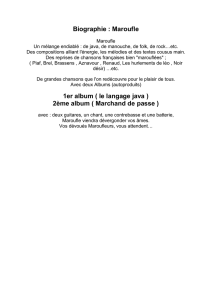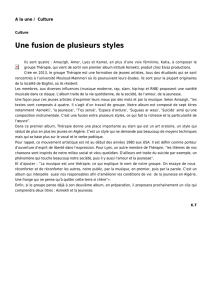la théâtralité en jeu dans quelques

1
De la page blanche à la scène vide :
La théâtralité en jeu dans quelques albums d’Ipomée
Euriell Gobbé-Mévellec
Laboratoire LLA-CREATIS
Université de Toulouse-Le Mirail
Ne peut-on pas comparer les pages blanches d’un livre à un plateau de théâtre désert ? Selon la disposition d’un
filet, la largeur d’un espace, la présence ou l’absence d’alinéa, une disposition « en pavé » ou « en drapeau »,
voici que les mots prennent sens, un autre sens. […] Puis l’image arrive, marquant le ton comme une comédienne
confirmée - la voici, elle aussi, qui crée la vie - une autre vie. Ne serait-elle pas un peu comme la voix du conteur
disparu ? Et les mots, les images ensemble qui nous murmurent à leur tour autre chose que les mots et les couleurs
séparés.1
Ces quelques mots de Nicole Maymat, qu’elle adressait au printemps 1994 à Marc
Soriano, posent les termes d’une comparaison entre l’album et la représentation théâtrale.
Quelle « face cachée » de l’album les emprunts au lexique théâtral éclairent-ils ? Il nous
semble qu’ils viennent souligner d’abord le caractère essentiel du visuel. Les pages blanches
de l’album, pages vierges attendant que l’on y dispose - et le terme a son importance - textes
et images, Nicole Maymat les compare à un plateau de théâtre désert, où l’on verra s’agencer,
selon une scénographie pensée dans ses moindres détails, les éléments du décor et les
comédiens. Bien plus qu’une simple « mise en page » de textes et d’images, l’association des
composantes visuelles et textuelles de l’album s’apparente plutôt à un travail de « mise en
scène », qui vise à dépasser les deux dimensions de l’image et casse la rigidité de la mise en
page traditionnelle du livre illustré. La mise en scène Ipomée incarne dans les pages de ses
albums l’univers référentiel de la représentation.
Mais une discussion avec Nicole Maymat nous a appris que lorsqu’elle parlait de la
nature « théâtrale » du travail des éditions Ipomée, elle souhaitait insister sur le caractère
collectif de cette entreprise, sur le travail de co-création qui la caractérise. La « mise en page »
ne renvoie qu’à un des maillons précis de la chaîne du livre ; la « mise en scène » des albums
évoque avec plus de justesse la tâche délicate de faire dialoguer textes et images ; une tâche
méticuleusement exécutée par tous, mobilisant les compétences de chacun. Notre première
interprétation ne nous semble pas invalidée par les précisions de Nicole Maymat, au contraire,
et il est précisément très intéressant de voir que technique et théorie du livre s’articulent aussi
bien dans cet usage de la métaphore théâtrale.
Ce que nous proposons ici, c’est de creuser cette analogie qui, le temps d’une lettre, a
rapproché deux univers artistiques très différents, en partant de l’hypothèse qu’elle est l’indice
d’une théâtralité latente dans les albums Ipomée, en quelque sorte la « partie émergée » d’un
dispositif théâtral qui informerait les albums, à différents niveaux. Quelques travaux déjà
réalisés sur les liens entre théâtre et album confirment par ailleurs la fécondité d’un tel
rapprochement, qu’une simple analogie dans le discours ne pouvait, à elle seule, suffire à
justifier2. Entrons maintenant dans le cœur de notre sujet et commençons par nous poser la
1 Nicole Maymat : Ipomée, Paris, L’Art à la page (Images Images), 2008, p. 110.
2 Voilà quelques titres que nous avons pu consulter sur ce sujet :
Isabelle Nières : « Le théâtre est un jeu d’enfant » in Jean Perrot (dir.) : Jeux graphiques dans l’album pour la
jeunesse, CRDP Académie de Créteil, Université Paris-Nord, 1991.

2
question, fort simple en apparence, plus complexe à résoudre lorsqu’on s’y penche d’un peu
plus près : De quoi parle-t-on quand on évoque la « théâtralité » d’un album ? Quels sont les
signes de la théâtralité que l’on peut y repérer ?
1. Passerelles génériques. Les auteurs complices de la transgression
Commençons notre exploration du jardin Ipomée avec prudence et précaution, en nous
arrêtant dans un premier temps sur les albums qui revendiquent explicitement leur lien, leur
filiation avec le théâtre. On pourrait dans ce cas parler de liens autorisés, dans la mesure où le
paratexte signale ce rapprochement. Nous avons repéré, à ce sujet, deux albums dans la
collection Ipomée, assez emblématiques des différentes façons dont les auteurs peuvent
envisager, depuis l’album, le rapport au théâtre. S’agit-il en effet pour eux de copier, de
s’approprier, de récupérer, de recycler ou de brouiller les frontières génériques ?
Pour le premier, il s’agit du Maître de la pluie ou le Voyage de Tch’e Song, de
Bénédicte Vilgrain et Laurent Berman3. Le texte a été écrit à l’origine pour être monté en
pièce de théâtre d’ombres : la trace de cette intention se remarque notamment dans
l’organisation en trois actes de l’album. Il s’inscrit à la fois dans la tradition du conte oriental
et des techniques théâtrales traditionnelles, conférant ainsi à l’album, en plus de sa valeur
narrative et artistique, une valeur documentaire. L’album se constitue en véhicule, en
médiateur d’un savoir, d’un art étranger à l’enfant par son époque et son espace de
rattachement, mais qui néanmoins résonne de façon familière par les complicités qu’il met en
avant entre le conte oriental et les formules ritualisées du conte occidental. Par ailleurs, il
existe une grande proximité entre le théâtre d’ombres et certaines techniques d’illustration,
comme la gravure, qui offrent une grande lisibilité et une grande expressivité à la figuration
de l’univers et des scènes du conte. Nous n’en dirons pas plus de cet album, que nous n’avons
malheureusement pas pu consulter autant que nous l’aurions souhaité.
Le second album, Le Lutin aux rubans, de Gilbert Léautier et Jacek Przybyszewski4,
offre un jeu de transgression des frontières génériques tout à fait caractéristique de
l’esthétique postmoderne. Il est précisé en effet à la fin de l’album que « ce récit existe chez
Actes Sud Papiers dans une collection de théâtre, et a été créé à Paris au théâtre "Le Guichet-
Montparnasse" ». Les dates de publication des deux ouvrages sont identiques, 1987, ce qui
nous invite à croire que la démarche de Léautier ne consistait pas à explorer un genre puis
l’autre, mais, à partir d’un même argument, à faire exister un même propos sur deux supports
différents, qui se répondent et se complètent.
Les deux ouvrages sont en effet assez différents dans leur traitement, tant du point de
vue du texte que de la mise en page, mais ce sur quoi nous voudrions nous arrêter ici, c’est
précisément sur ce qui les rassemble. Un passage de la pièce nous éclaire à ce propos. Le
personnage de l’écrivain nous y révèle qu’« il y a des moments qui sont à écrire ». La
rencontre d’un écrivain avec le lutin qui vit dans son encrier et traverse sa feuille blanche au
Marie Bernanoce : « Le théâtre-album : un genre en cours de constitution » in Hélène Gondrand et Jean-François
Massol (coord.) : Textes et images dans l’album et la bande dessinée pour enfants, Grenoble, CRDP (Les cahiers
de Lire écrire à l’école), 2007.
Marie Bernanoce : « L’album-théâtre: typologie et questions posées à sa lecture », in Christiane Connan-Pintado,
Florence Gaiotti et Bernadette Poulou (coord.) : L’Album contemporain pour la jeunesse: nouvelles formes,
nouveaux lecteurs ?, Presses Universitaires de Bordeaux (Modernités n° 28), 2008.
AEIOU, Revue de littérature pour la jeunesse, Épernay, Office Régional Culturel de Champagne-Ardenne,
n° 10, décembre 2007.
3 Bénédicte Vilgrain et Laurent Berman : Le Maître de la pluie ou le Voyage de Tch’e Song, Moulins, Ipomée,
1984.
4 Gilbert Léautier et Jacek Przybyszewski : Le Lutin aux rubans, Moulins, Ipomée, 1987.

3
galop fait partie de ces instants de magie qu’il convient de fixer, d’une manière ou d’une
autre, sur le papier. Mais comment s’y prendre lorsque le lutin en question ne peut s’arrêter de
courir, qu’il est pris en chasse par la gomme et le papier dès qu’il passe sur la feuille, et
surtout, qu’il a une mission urgente à accomplir ? Pour raconter cette rencontre, cela ne fait
aucun doute, « les mots nous trompent ». L’écrivain propose alors :
Photographions. Mais la photographie nous ment. Musique. Mais l’orchestre n’arrive que dans les films. Où est
l’instrument ? Il faut les yeux de l’autre.
Quels supports de la littérature mieux que l’album et le théâtre pouvaient prendre en
charge la narration d’un récit qui passe essentiellement par « les yeux de l’autre » ? Un récit,
donc, où la part de visuel fait échouer les lois de la rhétorique et de l’organisation discursive,
où il est demandé au lecteur de faire acte de « spectalecture », c'est-à-dire de se représenter
mentalement ce qu’il entend ou lit ? Le lutin, en effet, précise la liste des dramatis
personae…
… multiplie les apparences, se dédouble, grandit, rapetisse. Chacun le voit en fonction de son imagination.
Mythe sorti des contes de notre enfance ou d’une toile de Magritte, il est la part de poésie, de rêve et de tendresse
que chacun porte en soi.
Les indices visibles de la théâtralité
Nous reviendrons plus loin sur l’album de Léautier et de Przybyszewski mais nous
voudrions passer à présent à une seconde modalité de relation entre l’album et le théâtre. La
première était repérable sans même avoir besoin de questionner ce qui, dans l’album, relevait
de l’emprunt au théâtre puisqu’un tel emprunt était indiqué d’emblée. Dans d’autres albums
en revanche, on peut dire que la théâtralité est présente sous la forme d’indices disséminés
dans l’image et dans le texte, des indices que l’on associe directement au théâtre. Nous
proposons, à partir de l’échantillon d’albums sur lequel nous avons travaillé, de les regrouper
en trois catégories : celle de la récupération de traditions théâtrales, celle du dédoublement
acteur/personnage et enfin, celle de la figuration d’un espace théâtral.
Ces catégories sont loin d’être suffisantes pour englober tous les aspects de la
théâtralité, et il faudrait notamment ajouter à cette liste, pour un travail de plus grande
ampleur, une catégorie plus spécifiquement en lien avec les caractéristiques du texte théâtral -
dialogue, didascalies, oralité, … Néanmoins, ces trois catégories, bien représentées parmi les
albums Ipomée, nous semblent illustrer assez bien la diversité de significations que recouvrent
les termes de « théâtre » et de « théâtralité ». Le « théâtre » désigne en effet le texte
dramatique en tant que genre littéraire aussi bien que sa mise en scène, le lieu dans lequel
cette mise en scène se déroule et il se caractérise enfin par un ensemble de règles d’écriture et
de modèles de représentation qui varient selon les lieux et les époques. Quant à la
« théâtralité », elle renvoie tantôt à tout ce qui relève du spatial, du visuel, du spectaculaire,
conformément à l’étymologie du terme, puisque le theatron, c’est le lieu d’où l’on regarde,
tantôt à une énonciation spécifique, au dédoublement entre le personnage et l’acteur, à
l’artificialité de la représentation5.
a. La récupération de traditions théâtrales
Prenons pour illustrer cette première catégorie un album emblématique de l’emprunt à
l’histoire du théâtre. Il s’agit de Carnaval à Venise, de Véronique Della Valle, illustré par
5 Nous reprenons là les définitions que propose Patrice Pavis de la « théâtralité » in Patrice Pavis : Dictionnaire
du théâtre, Paris, Armand Colin, 2003, entrée « théâtralité », p. 359.

4
Laura Rosano6. Le théâtre est omniprésent dans cet album qui s’offre tout entier comme un
espace ludique et théâtral pour le déploiement de la fête. C’est la ville tout entière qui s’y
costume, en effet, et dont on voit se refléter les ruelles dans la robe d’un personnage-chat.
© Illustration de Laura Rosano, publiée dans
Carnaval à Venise, Paris, Ipomée-Albin Michel, 1993.
Les masques portés pendant le carnaval s’inspirant traditionnellement de ceux de la
commedia dell’arte, on ne s’étonnera nullement de rencontrer au coin d’une rue Brighella,
Scapino, Colombina, Lisetta, Pulcinella, Pantalone, Matamoros, Scaramuccia, Il Dottore, etc.
Ils sont tous là, les personnages de la Commedia dell’arte, prêts à jouer leur rôle. Chaque coin
de rue, chaque placette, chaque porche figuré dans l’album devient ainsi prétexte à une scène.
Les deux servantes commérant à leur fenêtre, Brighella furieux qui s’est fait tirer les
moustaches et cherche Scapin pour lui flanquer une bonne raclée, …
© Illustration de Laura Rosano, publiée dans
6 Véronique Della Valle et Laura Rosano : Carnaval à Venise, Paris, Ipomée-Albin Michel, 1993.

5
Carnaval à Venise, Paris, Ipomée-Albin Michel, 1993.
Les espaces de représentation se multiplient donc tout en s’incrustant dans le tissu de
la ville, créant, ici un castelet de marionnettes, là des tréteaux pour un théâtre d’ombres, là
encore, à l’angle d’un pont, l’occasion de déclamer un monologue, …
© Illustration de Laura Rosano, publiée dans
Carnaval à Venise, Paris, Ipomée-Albin Michel, 1993.
L’album multiplie ainsi les possibilités d’inventer de nouveaux récits, dans le pur
esprit de la commedia, qui réinvente de nouveaux scénarios à partir des caractères, des types
des personnages, et les images de Laura Rosano invitent le lecteur à manipuler l’album, à le
retourner, pour découvrir ces micro-scènes enchevêtrées dans l’architecture de la ville. Là
encore, la confusion haut/bas rend bien compte de l’esprit du carnaval, où les hiérarchies sont
abolies le temps de la fête, où le plus humble joue au puissant, et vice-versa. Où l’on peut sur
une page dessiner de la main gauche et de la droite sur une autre - nous renvoyons ici le
lecteur au clin d’œil graphique de l’illustratrice sur les pages de gardes.
Au thème du masque et du travestissement de l’identité, propres au carnaval,
répondent donc avec une parfaite cohérence les choix esthétiques de Laura Rosano, ceux du
collage, de la superposition, du feuilletage. Parfois même le jeu des masques conduit au
vertige tant il imbrique les niveaux de représentation : les personnages de la commedia
deviennent eux-mêmes les pièces d’un jeu d’échecs et le plateau noir et blanc du jeu figure en
même temps une scène de théâtre encadrée de rideaux de velours rouge, tandis que Venise et
ses ponts servent toujours de décor à cette farce en abyme.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%