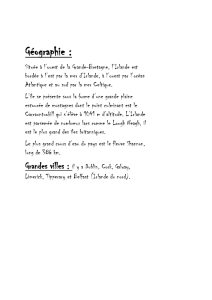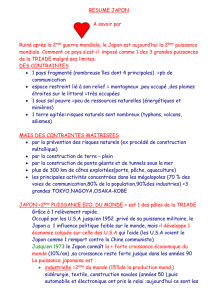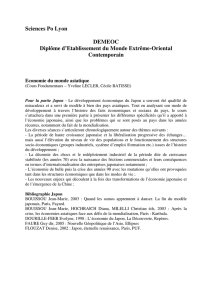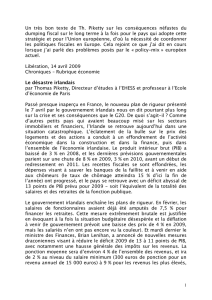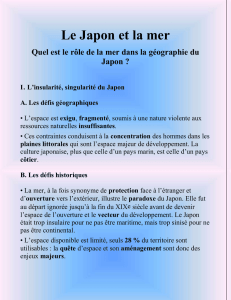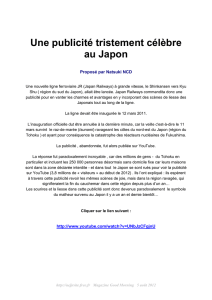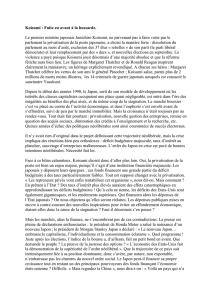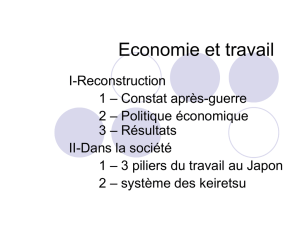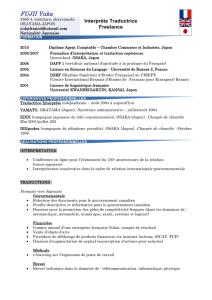EPREUVE DE SYNTHESE

CONCOURS IPAG
2011
EPREUVE DE SYNTHESE
Durée : 3 heures
Coefficient attribué à cette épreuve : 3
Il est demandé au candidat de faire la synthèse en 450 mots (avec une tolérance de plus ou moins
10%) de l’ensemble des documents. Le candidat doit mettre un signe après chaque groupe de
50 mots et indiquer, en fin de copie, le nombre total de mots.
La synthèse demandée ne saurait être un résumé successif des différents documents. Elle doit être
un texte entièrement rédigé, construit autour d’une problématique posée en introduction,
ordonné selon un plan clair et s’achevant par une conclusion. Il n’est pas nécessaire de faire
référence aux documents (“ le document 1 précise…, “ Untel s’oppose à… ”).
Au final, le lecteur de la synthèse doit pouvoir comprendre, sans avoir à se reporter aux documents,
les enjeux du débat posé par les différents documents.
Nous attirons l’attention du candidat sur :
• la nécessité absolue de poser une problématique d’ensemble permettant ensuite
d’ordonner de manière logique et nuancée les arguments ;
• l’importance des qualités d’orthographe et de rédaction.

- 2 -
Document 1 :
La fermeture de l'usine américaine à Limerick déprime le pays, frappé par une grave crise
immobilière.
« Vous voyez ces trois grandes grues ? Elles n'ont pas bougé depuis des mois ! », pointe du
doigt Diarmuid Scully depuis le parking d'un centre commercial en bordure de Limerick. « Ça
devait être le plus grand centre commercial de toute la province ! », soupire-t-il. « Et cette grande
tour de verre là-bas ? C'est une coquille vide, un hôtel qui ne sera probablement jamais ouvert.
Voilà les effets visibles de la crise. Et encore, c'était avant Dell ! »
Depuis le 8 janvier dernier, les habitants de Limerick, quatrième ville d'Irlande, sont sous le
choc. Dell, deuxième fabricant mondial d'ordinateurs, a annoncé la fermeture de son usine dans la
banlieue sud de la ville, provoquant la perte de 1 900 emplois. À cause de la crise, le groupe texan a
choisi de transférer sa production d'ordinateurs vers une nouvelle usine en Pologne. Un coup
terrible pour l'Irlande, qui souffre déjà d'une dure récession à cause d'un violent crash immobilier.
Installé sur l'île depuis 1990, Dell était devenu le premier exportateur d'Irlande et représentait l'un
des plus beaux symboles de la réussite économique du Tigre celtique de ces deux dernières
décennies.
« On se doutait que l'usine Dell allait disparaître un jour ou l'autre, explique Diarmuid Scully,
élu au conseil municipal de Limerick. Dell était le dernier à produire encore ici. » Tous les autres
grands constructeurs informatiques, Apple, HP, Wang et Digital, ont déjà fermé leurs centres de
production en Irlande pour aller chercher de la main-d'œuvre moins chère dans les pays de l'Est.
« Si l'usine avait fermé il y a deux ou trois ans, tout le monde aurait retrouvé rapidement du travail,
regrette l'élu local, mais aujourd'hui, le moment choisi est tout simplement catastrophique. » (…)
En plus des 1 900 licenciements chez Dell, environ 1 500 emplois sont directement menacés
chez des sous-traitants qui travaillaient presque exclusivement pour l'usine autour de Limerick,
auxquels il faut aussi ajouter 3 000 emplois qui seront affectés par la baisse d'activité dans la région.
Des chiffres colossaux pour les 90 000 habitants de Limerick.

- 3 -
Ce n'est pas une consolation pour les employés de Dell licenciés, mais la situation n'est guère
meilleure au niveau national, où le chômage a doublé en un an, passant de 4 % à 9,2 % en janvier.
« L'Irlande est frappée par deux crises simultanées, explique Alan Barrett, économiste à
l'institut de recherche ESRI à Dublin. La crise mondiale, qui touche tout le monde, et le crash
immobilier domestique qui va rendre la situation bien pire. »
Si, pendant les années 1990, la forte croissance irlandaise était provoquée par l'attractivité du
pays et l'arrivée de nombreux investisseurs étrangers, majoritairement américains, l'essor
économique de la dernière décennie était tiré par une bulle immobilière sans précédent. La
construction de logements représentait 15 % de l'économie et un emploi sur huit en 2006, poursuit
Alan Barrett. « Tout le monde s'est laissé prendre au mirage d'une hausse des prix de l'immobilier
qui paraissait ne jamais devoir s'arrêter », poursuit l'économiste. Une partie de la demande de
nouveaux logements avait été entraînée par l'arrivée dans le pays de dizaines de milliers d'ouvriers
venus de Pologne et d'Europe de l'Est pour travailler dans le secteur du bâtiment. (…)
Cyrille Vanlerberghe, Le Figaro, 10 février 2009
Document 2 :
Un pays pauvre et isolé
Dans les années 1950, l'Irlande du Sud était incontestablement une des nations les plus pauvres
d'Europe occidentale, ce qui entraînait une forte émigration vers la Grande-Bretagne ou les Etats-
Unis. Politiquement isolée en raison de sa neutralité dans la Seconde Guerre mondiale, méconnue
des touristes européens, la République d'Irlande faisait figure de pays ultra conservateur sur le plan
moral et culturel, sous le contrôle omniprésent d'un clergé catholique tout-puissant. (…)
Un réveil difficile
Fière de sa totale indépendance politique, ayant rompu ses derniers liens avec le Royaume-Uni
en 1949, la jeune République d'Irlande restait pourtant très dépendante de son puissant voisin en
matière économique. C'est lui qui déterminait la valeur de sa monnaie puisque la livre irlandaise
était alignée sur la livre sterling et qui contrôlait la quasi-totalité de son commerce extérieur.
Essentiellement agricole, le pays protégeait sa maigre industrie par de fortes barrières douanières.
Dans une Europe qui commençait à libéraliser ses échanges, cette politique protectionniste mise en
place dans les années 1930 ne semblait plus de mise.
C'est dans ce contexte, un an après la signature du traité de Rome, qu'un technocrate irlandais,
Ken Whiteker, publia en mai 1958 un rapport qui allait changer radicalement la politique
économique du pays en l'ouvrant sur le monde extérieur. Ce changement d'orientation fut facilité
par l'arrivée au pouvoir en 1959 d'un nouveau Premier ministre, Sean Lemass, de Valera ne jouant
plus guère qu'un rôle symbolique à la présidence de la République. Le lancement d'un premier
programme d'expansion économique (1959-1963), la libéralisation des échanges par l'abaissement
progressif des barrières douanières, l'appel aux capitaux étrangers et l'ouverture d'une zone franche
à l'aéroport de Shannon furent les premières réalisations concrètes de cette nouvelle politique. En
quelques années, l'industrie fit un bond en avant et l'émigration recula de façon spectaculaire. Après
un long sommeil, l'Irlande bucolique entrait dans la modernité.
Fort intéressé dès le départ par le Marché commun, le gouvernement de Dublin ne pouvait
cependant se permettre d'y adhérer sans le Royaume-Uni, l'économie irlandaise étant encore trop
dépendante de ce pays. Le double veto du général de Gaulle contre l'entrée de la Grande-Bretagne
dans la Communauté européenne en 1963 et 1967 retarda l'échéance et ce n'est qu'en 1972 que

- 4 -
l'Irlande put rallier le Marché commun, une adhésion massivement approuvée par référendum avec
81 % de « oui ».
Un premier « miracle économique » sans lendemain
L'entrée effective de la République d'Irlande dans la CEE le 1er janvier 1973 donna un nouveau
coup de fouet à l'économie grâce aux prix agricoles communautaires, bien supérieurs à ceux
imposés jusque-là par les importateurs britanniques, et grâce aux subventions pour le
développement des régions en retard au plan économique et social. Mais le premier choc pétrolier et
les difficultés de la livre sterling mirent un frein à la croissance et il fallut attendre les années 1977-
1978 pour que l'on assiste vraiment à un premier décollage de l'économie irlandaise.
Pendant deux ans, grâce notamment à l'arrivée massive de capitaux américains, l'Irlande du Sud
connut un « boom économique » sans précédent, son taux de croissance étant alors le plus élevé de
tous les pays de la CEE avec 5 % en 1977 et 7 % en 1978. « La République d'Irlande est en train de
vivre un miracle, voire une révolution, écrivait Le Monde du 11 novembre 1978. Pour la première
fois de sa tumultueuse histoire, l'Irlande du Sud est au bord de la prospérité. En trois ans, le
changement est frappant : les maisons neuves se pressent dans les campagnes, les établissements
industriels surgissent un peu partout, encadrant les chaumières de torchis qui furent pendant
longtemps le symbole de la misère de l'île verte »… En 1979, l'adhésion de la République d'Irlande
au système monétaire européen entraîna la rupture de sa monnaie avec la livre sterling, le Royaume-
Uni refusant d'entrer dans le SME. Face à son ancienne métropole, l'Irlande, désormais, jouait
carrément la carte européenne.
Mais ce premier « miracle économique » fut de courte durée. Le second choc pétrolier et
l'anarchique industrialisation du pays par des firmes étrangères qui disparaissaient après avoir
bénéficié des avantages consentis par le gouvernement de Dublin – exonérations fiscales,
subventions… – furent en grande partie responsables des déconvenues de l'économie irlandaise
dans les années 1980. Le pays connut alors deux dévaluations monétaires – avec l'accord du SME –,
une forte inflation qui sera ramenée de 20 % à 5 % entre 1982 et 1986 par une rigoureuse politique
d'austérité, un chômage impressionnant – jusqu'à 25 % de la population active, taux record de la
CEE – une reprise de l'émigration et même une diminution de son produit national brut au milieu
des années 1980. Malgré l'aide apportée par le Fonds européen de développement régional,
l'Irlande, à l'instar de la Grèce et du Portugal, restait dans le peloton de queue de la Communauté.
Jean Guiffan, http://www.clio.fr, 2003
Document 3 :
L'Europe va très probablement prêter entre 40 et 90 milliards d'euros à l'Irlande dans les
prochains jours. Argent que l'Europe va se procurer elle-même sur les marchés à un prix très
inférieur à celui auquel l'Irlande peut s'endetter directement. Cet argent permettra à l'Irlande de
financer moins cher sa dette publique, mais surtout il servira à éponger les pertes enregistrées par
les banques irlandaises.
Faut-il prêter cet argent ? Oui, pour deux raisons. D'une part les difficultés d'un membre de la
zone euro liées à sa dette publique ont des répercussions sur les autres membres les plus fragilisés
(Espagne, Portugal...), il est donc légitime d'éteindre l'incendie avant qu'il ne se propage. D'autre
part, et c'est dans le cas irlandais l'élément principal, une faillite du système bancaire irlandais aurait
des conséquences majeures sur les autres banques européennes, principalement britanniques,
allemandes et françaises. Sans parler des conséquences sociales, bien entendu, car même si l'Irlande
s'est enrichie depuis son accession à l'Union européenne, les inégalités sociales y sont toujours
particulièrement criantes....

- 5 -
Le soutien est donc nécessaire. Mais il faut en tirer plusieurs leçons qui doivent impérativement
être traduites dans les politiques publiques par la suite.
Si l'Irlande se retrouve dans cette situation (avec un déficit budgétaire de 32 % du PIB !) c'est
qu'elle a décidé de sauver intégralement ses banques, et donc ses riches (les pauvres ont peu d'avoirs
et sont plutôt débiteurs de la banque via leurs dettes). Des banques qui ont pris des engagements de
crédit excessifs, notamment sur l'immobilier ; engagements qui ont largement contribué à la
formation d'une bulle spéculative qui explose depuis plus d'un an. Du coup, les banques se
retrouvent avec des actifs immobiliers dépréciés sur les bras et personne ne veut les acheter. Pour
compenser ces pertes, les banques doivent trouver de nouvelles ressources. Mais personne n'est
vraiment enclin à leur prêter de l'argent car nul ne sait si demain les banques irlandaises seront
encore là ! C'est pourquoi le seul acteur qui prête aujourd'hui de l'argent à ces banques est la Banque
Centrale Européenne (BCE), et dans une moindre mesure la banque centrale irlandaise. Une
situation difficilement tenable pour la BCE, qui exige que tout le monde prenne sa part du fardeau.
Tout le monde, cela signifie tous ceux qui ont gagné lors de la période précédente.
Qui sont-ils ? Les Irlandais d'abord. Ils paient aujourd'hui le prix des excès d'hier d'une partie
de la population via des coupes sombres dans les dépenses publiques pour tout le monde. Les
entreprises internationales basées en Irlande, pour des raisons fiscales, ensuite. Elles bénéficient
depuis des années d'un taux d'imposition sur les bénéfices de 12,5 %, et même moins compte tenu
des différentes niches qui allègent encore un taux déjà faible.
Pour l'Etat irlandais, cette situation était gagnante : de grandes entreprises comme Google ou
Apple ont établi leur résidence fiscale européenne en Irlande. Ils y remontent l'ensemble des
bénéfices réalisés en vendant en Europe (en effet, quand vous achetez un iMac sur le site d'Apple,
vous recevez une facture irlandaise). Cela accroît considérablement la base taxable en Irlande, mais
l'assèche complètement dans le reste de l'Europe et notamment dans les pays où se situent la masse
des consommateurs comme la France et l'Allemagne. L'Etat irlandais peut donc ensuite financer ses
dépenses en taxant faiblement une assiette importante. (…) Il est donc parfaitement légitime de
conditionner l'aide à l'Irlande à une augmentation de son taux d'imposition sur les bénéfices des
entreprises. On comprend que les Irlandais soient très réticents, car cela touche le cœur de leur
stratégie de développement. Mais c'est une condition déterminante pour mobiliser la solidarité
européenne. L'Irlande ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Mais ceux qui doivent payer ne sont pas tous domiciliés en Irlande : ce sont aussi les banques
européennes, qui ont gagné beaucoup d'argent dans la phase croissante de la bulle, soit en prêtant
aux banques irlandaises qui elles-mêmes prêtaient aux ménages, soit en achetant directement des
banques irlandaises. Elles doivent aujourd'hui payer une partie des pots cassés.
Trois principales leçons à tirer de la crise
Les déséquilibres majeurs qui déstabilisent l'économie ne proviennent pas de la sphère publique
mais bien de la sphère privée : bulle spéculative sur les marchés, prises de risque inconsidérées des
banques et autres acteurs financiers, bulles immobilières, etc. Cela devrait définitivement signer la
fin du dogme néolibéral qui veut que le problème principal soit dans la sphère publique. (…)
Deuxièmement, en échange de la solidarité européenne, les Etats doivent accepter de modifier
les politiques non coopératives qui utilisent le bien commun qu'est l'Europe. Ces comportements
non coopératifs sont différents selon les Etats. Dans le cas de l'Irlande, il s'agit de la politique
fiscale. La solution est connue : il s'agit d'obliger les multinationales actives en Europe à payer les
impôts là où elles ont une activité économique. (…)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
1
/
42
100%