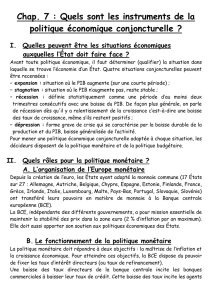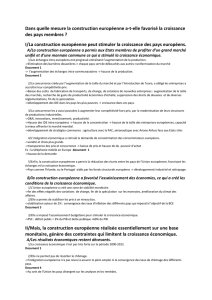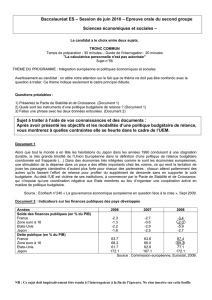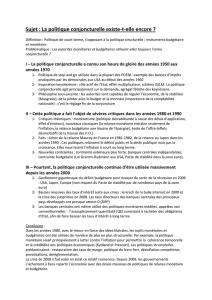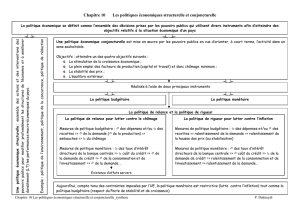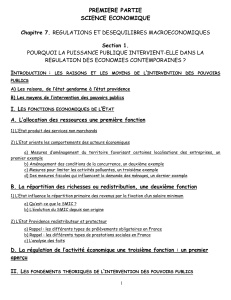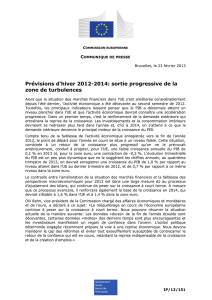DISSERTATION L BRAQUET

Dissertation. Comment les politiques conjoncturelles
européennes peuvent-elle soutenir la croissance dans la
zone euro?
Document 1. L’évolution des taux d’intérêt directeurs de la Banque centrale européenne (BCE)
et de la Réserve fédérale des Etats-Unis (FED)
Source : Banque de France.
Document 2. La dégradation des finances publiques dans la zone euro depuis 2008.
Soldes publics (en % du PIB) Dettes publiques (en % du
PIB)
2008 2009 2010 2008 2009 2010
Allemagne 0,1 -3,0 -5,5 66,3 73,4 76,5
Autriche -0,5 -3,5 -4,7 62,5 67,5 70,0
Belgique -1,3 -6,0 -4,8 89,6 96,2 101,0
Chypre 0,9 -6,0 -6,0 48,3 58,0 61,0
Espagne -4,2 -11,1 -9,8 39,8 53,2 66,0
Estonie -2,8 -1,7 -2,2 4,6 7,2 10,0
Finlande 4,2 -2,5 -3,6 34,1 43,8 48,0
France -3,3 -7,5 -8,2 67,6 78,1 83,0
Grèce -9,4 -15,4 -8,7 110,3 126,8 120,0
Irlande -7,3 -14,4 -11,6 44,3 66,5 78,0
Italie -2,7 -5,3 -5,0 106,3 116,0 117,0
Luxembourg 3,0 -0,7 -3,9 13,6 14,5 18,0
Malte -4,8 -3,8 -3,9 63,1 68,6 69,0
Pays-Bas 0,6 -5,4 -6,1 58,2 60,8 67,0
Portugal -2,9 -9,3 -8,3 65,3 76,1 86,0
Slovaquie -2,1 -7,9 -5,5 27,8 35,4 41,0
Slovénie -1,8 -5,8 -5,7 22,5 35,4 40,0
Source : Commission européenne.

Document 3.
Document 4. Vue d’ensemble sur la conjoncture économique française.
Face à l’aggravation de la crise des dettes souveraines depuis l’été 2011, la réponse des autorités
européennes a été double. D’une part, les États ont cherché à renforcer la soutenabilité de leurs
finances publiques : des plans additionnels de réduction des déficits ont été mis en place en Italie, en
Espagne et en France fin 2011, tandis que le sommet européen du 9 décembre 2011 a réaffirmé
l’engagement des pays de la zone euro en matière de discipline budgétaire. D’autre part, la Banque
Centrale Européenne a intensifié le recours aux mesures non conventionnelles, en mettant en œuvre
deux opérations exceptionnelles de refinancement illimité à échéance de 3 ans, en décembre 2011 et
en février 2012. Par ailleurs, l'accord du 24 février concernant la Grèce a permis la réduction d'au
moins 100 Md€ de la dette du pays. Les tensions financières dans la zone euro se sont par
conséquent apaisées depuis le début d’année 2012. Ainsi, les primes de risque sur les marchés
interbancaires se sont réduites, la volatilité des indices boursiers a fortement diminué et l’écart des
taux des obligations italiennes, espagnoles et françaises avec les obligations allemandes s’est
resserré. Pour autant, les conséquences de la crise survenue à l’été 2011 continueraient d’affecter les
économies européennes d’ici mi-2012. Dans certains pays, la détente observée en début d’année sur
les marchés des obligations souveraines européennes ne s’est, en effet, pas encore transmise aux
conditions de crédit, ce qui limiterait le redémarrage de l’investissement à l’horizon de juin 2012. De
même, les mesures de maîtrise des déficits publics pèseraient sur le revenu des ménages, déjà
fortement affecté par la dégradation du marché du travail et la hausse du prix du pétrole. La
consommation des ménages européens continuerait de reculer au premier semestre (-0,2 % par
trimestre). Dès lors, l’activité reculerait encore légèrement dans la zone euro au premier trimestre
2012 (-0,1 %) avant de se redresser faiblement au deuxième trimestre (+0,1 %). Fortes dispersions
L’évolution d’ensemble masquerait une accentuation des divergences au sein de la zone euro. En
Allemagne, l’activité rebondirait dès le premier trimestre (+0,2 % puis +0,4 % au deuxième trimestre
2012) car les moteurs de la croissance y sont préservés : la consommation des ménages, soutenue
par les revenus salariaux, progresserait sur un rythme modéré et l’investissement des entreprises
redémarrerait à l’horizon de mi-2012. La demande allemande soutiendrait les exportations espagnoles
et italiennes. Mais, dans ces pays, la demande interne resterait très affaiblie et le recul de l’activité se
poursuivrait sur l’ensemble du premier semestre. Source : INSEE, note de conjoncture, mars 2012.

Corrigé. Comment les politiques conjoncturelles
européennes peuvent-elle soutenir la croissance dans la
zone euro?
Introduction.
A l’heure actuelle, les Etats de la zone euro cherchent à concilier la réduction de la dette publique qui
a fortement augmenté sous l’effet de la crise, avec le soutien de la demande globale et de la
croissance du PIB, soit l’augmentation durable de la quantité de richesses produites par l’économie,
seul moyen de redressement efficace et durable des finances publiques. L’efficacité des politiques
monétaire et budgétaire et leur impact dans la réalisation des objectifs des pouvoirs publics
(croissance, plein emploi, stabilité des prix, équilibre du commerce extérieur) font l’objet de vifs débats
chez les économistes. Si, dans la zone euro, les contraintes institutionnelles rendent délicate la mise
en œuvre cohérente de la politique monétaire unique de la Banque centrale européenne (BCE) et des
politiques budgétaires des dix-sept Etats membres de l’Union économique et monétaire (UEM), ces
instruments demeurent indispensables pour lutter contre les crises économiques et éviter la
récession. De quelle manière les politiques monétaires et budgétaires de la zone euro peuvent-elles
stimuler l’activité économique et rapprocher le PIB effectif de son niveau potentiel ? Après avoir
analysé le rôle que pourrait jouer la politique conjoncturelle dans l’accélération de la croissance du
PIB, il s’agira de montrer que celles-ci peuvent se heurter à l’aggravation des déséquilibres
macroéconomiques et à d’importantes contraintes financières.
I. La mobilisation des politiques conjoncturelles peut contribuer à soutenir la croissance dans
la zone euro.
A. La politique monétaire expansionniste peut soutenir le crédit et la croissance.
La politique monétaire définie et mise en œuvre par la Banque centrale européenne (BCE) peut créer
les conditions d’une demande dynamique car la monnaie exerce une influence sur la production réelle
: la réduction du taux d’intérêt directeur incite normalement les banques commerciales à répercuter
cette décision sur leurs propres taux d’intérêt, ce qui favorise la consommation des ménages et
l’investissement productif. Au final, la politique monétaire de la BCE, par son impact sur les taux
d’intérêt, influence la demande dans l’économie, et peut là aussi contribuer à la croissance et au plein
emploi. La politique monétaire est décidée la Banque centrale (généralement indépendante du
pouvoir politique) dont la mission est de réguler la création monétaire. Les banques centrales gèrent
finement la quantité de monnaie en circulation dans l’économie (masse monétaire). Plus la quantité de
monnaie centrale est abondante, et plus les banques vont avoir la possibilité de créer beaucoup de
monnaie, et inversement, quand la banque centrale en restreint l’émission. La Banque centrale doit
fournir les liquidités nécessaires au bon fonctionnement et à la croissance de l’économie tout en
veillant à la stabilité de la monnaie. Le rôle des banques centrales est primordial afin de concilier le
financement des échanges sur les marchés avec la stabilité du pouvoir d’achat de la monnaie.
La récente crise financière a montré que la Banque centrale doit agir rapidement et fortement pour
empêcher une crise de confiance sur le marché monétaire et prévenir un effondrement du crédit
susceptible de paralyser l’économie : en cas de crise de liquidité, la banque centrale doit augmenter
ses prêts aux banques, dans des délais très brefs, sans discrimination ni limites de montant. C’est ce
qu’on appelle la fonction de prêteur en dernier ressort. Dans le document 1 on constate que les
banques centrales européennes et américaines ont rapidement diminué leurs taux d’intérêt directeurs
afin de soutenir le crédit à partir de 2007.
Sur le plan monétaire, la BCE est dotée d’une forte indépendance statutaire dans la zone euro et se
voit confier un objectif prioritaire : maintenir le taux d’inflation à des niveaux proches de 2% à moyen
terme, donc assurer la stabilité des prix. Lors de la création de l’euro, les choix des gouvernements de
la zone euro ont consisté à donner la priorité à la lutte contre l’inflation, la réduction du chômage ne
pouvant provenir d’une relance monétaire. La baisse des taux d’intérêt et l’expansion du crédit ne
stimulent pas l’activité économique (production réelle) mais ne font qu’augmenter le niveau général
des prix.

B. La politique budgétaire de relance peut stimuler la demande globale en période de crise
économique.
Toutes choses égales par ailleurs, pour un même niveau de productivité globale des facteurs et de
croissance potentielle, la politique conjoncturelle demeure un moyen privilégié d’exploiter aux mieux
les capacités de production et d’utiliser toute la force de travail disponible, en luttant contre la
composante « conjoncturelle ») du chômage (liée à une demande insuffisante). La politique
macroéconomique des Etats membres de la zone euro peut permettre de stimuler la consommation
des ménages, et l’investissement des entreprises. La politique conjoncturelle permet de rapprocher la
croissance du PIB effectif de son niveau potentiel. En effet, la croissance du PIB constatée peut être
inférieure à la croissance potentielle de l’économie : la politique budgétaire, en tolérant un déficit
public, peut alors réduire cet écart en stimulant la demande effective (anticipée par les entrepreneurs)
par des mesures d’augmentation des bas revenus dont la propension à consommer est forte, en
revalorisant les revenus de transfert, ou en mettant en œuvre une politique de grands travaux fondée
sur l’investissement public. La politique budgétaire consiste à utiliser le budget de l’Etat pour atteindre
certains objectifs choisis par le gouvernement afin de réguler l’activité, par une action sur les
dépenses publiques et les recettes fiscales, et donc sur la demande globale dans l’économie.
Dans le domaine budgétaire, les Etats ont néanmoins encadré la politique budgétaire par des règles
et une surveillance mutuelle. Dès 1997, le traité d’Amsterdam instaure le Pacte de stabilité et de
croissance (PSC) qui limite le déficit budgétaire des Etats à 3% du PIB et la dette publique à 60% du
PIB pour éviter les dérives traditionnelles de la relance budgétaire parmi lesquelles l’inflation, et le
gonflement de la dette publique,. Ce pacte a été réformé et assoupli en 2005 pour prendre en compte
des « facteurs pertinents » comme les efforts en matière d’innovation, l’aide au développement, etc.
Le Pacte de stabilité et de croissance inclut théoriquement des amendes financières en cas de
dépassement de la norme des 3% et suppose que les Etats membres rendent compte de leurs
politiques budgétaires aux institutions européennes et s’engagent sur un calendrier précis pour
respecter la discipline budgétaire.
L’économie de marché est périodiquement soumise à des crises qui justifient l’intervention de l’Etat
afin de se rapprocher d’une situation de plein emploi des ressources productives. L’Etat a alors une
fonction de stabilisation/régulation de l’activité économique. Mais la régulation conjoncturelle bute sur
d’importantes limites macroéconomiques.
II. L’efficacité des politiques conjoncturelles se heurte à d’importantes contraintes.
A. Les politiques conjoncturelles de relance peuvent se heurter à des déséquilibres
macroéconomiques : inflation et déficit commercial.
La Banque centrale doit fournir les liquidités nécessaires au bon fonctionnement et à la croissance de
l’économie, mais elle doit également veiller à la stabilité de la monnaie. Ainsi, une quantité de
monnaie trop abondante met à la disposition des agents économiques un pouvoir d’achat bien
supérieur à la quantité de biens et services disponibles, ce qui peut alors provoquer une hausse du
niveau général des prix (inflation).
Les politiques budgétaires de relance peuvent aussi provoquer une accélération de l’inflation en
stimulant la demande globale pour une offre globale constante. L’impact du budget sur l’inflation est
ambivalent : un soutien budgétaire peut dans un premier temps entraîner une hausse de la
demande et une hausse de la production et de l’emploi, mais celui-ci peut aussi provoquer des
hausses de salaires qui augmentent les coûts de production et incite les entreprises à relever leurs
prix. Au total, l’ampleur de l’inflation dépend de l’élasticité de l’offre, et des capacités de production
disponibles dans l’économie. Si la demande augmente plus vite que la production, l’inflation
s’accélère.
Par ailleurs, dans une économie ouverte, la relance budgétaire accroît les revenus distribués mais
une partie de ce surcroît de demande se tourne vers les biens et services étrangers et le déficit

commercial se creuse, et nécessite ensuite une politique de rigueur. C’est ce qu’on appelle la
« contrainte extérieure ».
B. La politique conjoncturelle dans la zone euro reste soumise à des contraintes financières.
Pour lutter contre la crise en 2008-2009, et ce que les économistes ont appelé la « Grande
récession » (voir document 3), les Etats membres de la zone euro ont mis en œuvre de vastes plans
de relance budgétaire même si ces mesures ont entraîné une hausse très importante des déficits et
des dettes publiques dans la plupart des pays et en particulier dans les pays développés. Pour éviter
le glissement dans la dépression, les gouvernements ont également dû mettre en place des plans de
sauvetage du système financier massifs. Les dettes privées ont en quelque sorte été transférées aux
Etats puisque la dépense publique s’est substituée à la dépense privée pour soutenir l’activité
économique (et la demande globale).
A ces politiques volontaires se sont ajoutés les effets mécaniques du ralentissement de la croissance
sur les finances publiques : les recettes fiscales ont baissé alors que certaines dépenses se sont
accrues (comme les allocations chômage). Dans le cas français, le déficit public a augmenté de 5
points de PIB entre 2007 et 2010 et le taux d’endettement public (dette publique/PIB) s’est accru de
20 points de PIB sur la même période. Le document 2 montre que la dette publique de la France
exprimée en pourcentage du PIB a fortement augmenté pour passer de 67,6% du PIB à 83% du PIB.
Dans certains pays européens comme la Grèce, l’Italie ou l’Espagne, cette augmentation a conduit à
une véritable crise des dettes publiques et la France, comme peu avant elle les Etats-Unis, a vu la
notation de sa dette abaissée au début de l’année 2012.
A l’heure actuelle les Etats empruntent des capitaux sur les marchés financiers qui surveillent les
politiques conjoncturelles mises en œuvre, ainsi que les capacités de remboursement de chaque Etat
et les risques de défaut de paiement qui pourraient survenir. Les politiques conjoncturelles se heurtent
désormais à la contrainte de la maîtrise de l’endettement public et posent désormais la question de
futures politiques de rigueur. La crise apparaît particulièrement aiguë dans la zone euro où la politique
monétaire est unique mais où les Etats ont conservé l’autonomie de leur politique budgétaire (même
si celle-ci est encadrée par des textes limitant les déficits publics).
Conclusion.
Si la question est controversée, l’efficacité relative de la politique conjoncturelle ne fait guère de doute,
au moins pour lutter contre les crises et éviter la dépression. Depuis 2008, la crise a poussé les Etats
de la zone euro à recourir à la politique conjoncturelle de relance pour soutenir l’activité économique,
et réduire le chômage de masse, au prix d’un endettement public en forte progression, dont le niveau
est désormais préoccupant. Dans une économie mondialisée, la politique de relance se heurte
toutefois à des contraintes importantes et se conçoit davantage dans un cadre européen et non plus
national. Elle doit également se conjuguer à une action sur l’offre productive pour relever le niveau de
la productivité globale des facteurs, seul gage de stimulation durable de la croissance économique à
plus long terme.
1
/
5
100%