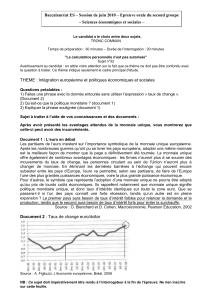Ces cinq dernières années, ECRICOME a proposé les sujets

APPRÉCIATIONS SUR L'ÉPREUVE ET BARÈMES
1
•
Généralités
Ces cinq dernières années, ECRICOME a proposé les sujets suivants
1993
1.
Les politiques monétaires et budgétaires dans les deux grandes crises du
xx
e
siècle.
2. Les conditions et les transformations du travail dans la croissance des
PDEM depuis le début du xix
e
siècle. (documents joints)
1994
1.
Pourquoi l'économie de marché ne peut-elle se passer de l'État?
2. La tendance à la régionalisation économique va-t-elle dans le sens du pro-
tectionnisme ou du libre-échange' (documents joints)
1995
1
À l'heure de la mondialisation de l'économie, l'intégration économique et
monétaire de l'Europe a-t-elle encore un sens?
2. Les syndicats de salariés dans les pays capitalistes développés constituent-
ils
un contre-pouvoir depuis la fin du xix
e
siècle? (documents joints)
1996
1.
Le phénomène de forte croissance apparu après la Seconde Guerre mon-
diale dans les pays développés à économie de marché doit-il être considé-
ré comme une parenthèse dans l'histoire économique?
2. L'échange international peut-il être toujours considéré comme un facteur
de rattrapage ? (documents joints)
1997
1.
Dans quelle mesure les expériences conduites au xx
e
siècle dans les pays
capitalistes développés (PCD) et la situation actuelle peuvent-elles justifier
l
a
po
litiqu
e du franc fort?
2. « Ce n'est pas parce que les firmes multinationales investissent en Afrique
que cette dernière est sous-développée, c'est au contraire parce qu'elles
n'y sont pas assez présentes ! » (Arghiri Emmanuel,
Technologie appropriée
ou
technologie sous-développée,
PUF-IRM, 1983). Cette citation d'Arghiri
Emmanuel vous paraît-elle rendre compte du rôle des firmes multinationales (FMN) dans l'histoire du développement? (documents joints)
Le programme précise que
« La démarche doit conduire les étudiants à nour-
rir et à mûrir une réflexion autonome à propos de phénomènes complexes. » (BO
du
20 juillet 1995). Ces sujets sont conformes au programme officiel et tiennent
compte de l'évolution de la pratique quotidienne en classe préparatoire ainsi
que de la réflexion continue suscitée par l'enseignement de notre discipline. Un
raisonnement argumenté pour justifier une analyse ou une prise de position per-
sonnelle est donc toujours très apprécié et, en aucun cas, la notation ne sanc-
tionne les opinions exprimées.
Il
•
Barèmes
Comme par le passé, les sujets proposés ont été examinés par une commis-
sion indépendante et sélectionnés par les directions des écoles.
Les barèmes conçus lors de la rédaction des sujets ont été définitivement
arrêtés après la lecture d'un échantillon de devoirs lors d'une ultime réunion de
coordination avec les correcteurs-pilotes et intègrent leurs observations et com-
pléments.
Lors de la correction, des connaissances et références répertoriées dans les
barèmes à un niveau donné ont été trouvées dans des devoirs que les qualités
de savoir-faire et d'analyse incitaient à classer à un autre niveau de notation. Le
correcteur s'est alors appuyé sur son expérience pour trancher, car un barème
établi pour harmoniser la correction n'est jamais applique mécaniquement
.
Barème sujet 1
Le sujet appelle un jugement critique sur les effets attendus et sur les résultats
effectifs de la politique de désinflation compétitive suivie en France depuis le milieu
de la décennie 1980. Pour aborder le débat, le candidat est invité à confronter
l'analyse économique aux diverses expériences historiques conduites dans les pays
capitalistes développés depuis le début de ce siècle. Il doit rendre compte des
dimensions économiques et sociales de la question, ainsi que des enjeux extérieurs,
notamment dans la perspective de l'Union économique et monétaire.
La question est directe et le candidat est invité à choisir son camp. Aucune
prise
de position ne saurait être suspectée a priori. Pour le correcteur, seule
compte la qualité de l'argumentation.

Les exigences en matière de savoir-faire et de « savoir-réfléchir » définies par
le
passé restent constantes. La démarche souhaitée est classique : après avoir
exposé le pour et le contre, le candidat se doit de trancher. Un candidat peut
légitimement réfuter brièvement les arguments opposés, alors qu'il développera
davantage son argumentaire, comme s'il était cri situation de négociation. Pour
obtenir la note maximale de chaque niveau, les exigences suivantes devront être
satisfaites.
Niveau 1: 0 à 7/20
A. Savoir faire :
Le devoir suit deux ou trois idées directrices : un plan est per-
ceptible. Les arguments utilisés pour les démontrer sont de valeur inégale,
mais il y a une argumentation. Les exemples, même s'ils sont peu variés, sont
tirés de l'histoire de plusieurs pays. L'expression écrite est correcte. Quelques
fautes d'orthographe et de syntaxe peuvent être tolérées à ce niveau.
B.
Analyse et références théoriques. Exemples historiques
Exemples d'arguments pouvant être avancés pour justifier la politique du franc
fort:
-
Une monnaie forte et stable, résultat d'une politique orthodoxe, permet une
croissance saine et durable. Pour le courant monétariste, l'inflation est par
essence d'origine monétaire et représente le « mal absolu ». L'adoption de la
politique du franc fort est comparable à une cure de désintoxication désa-
gréable, mais le prix à payer est une garantie pour l'avenir. Par exemple, la
dérive inflationniste des États-Unis dans les années 70 rend nécessaire le plan
de sauvetage du dollar amorcé par Jimmy Carter et poursuivi par Ronald
Reagan, Il cri va de même pour le Royaume-Uni de Mrs Thatcher.
- Sur le plan social, la monnaie forte évite aux salariés d'être victime
de l'illu-
sion
monétaire. Elle récompense l'épargnant en valorisant les encaisses
mon
étaires.
Une monnaie forte n'est pas incompatible avec de bonnes performances à
l'exportation, comme le montrent les résultats de la France au cours de ces
dernières années.
La France n'a pas le choix. La contrainte extérieure s'oppose à toute poli-
tique de relance menaçant la monnaie, des expériences récentes l'ont rappe-
l
é.
De plus, elle doit respecter les critères de convergence définis par le trai-
té de Maastricht.
Exemples d'arguments pouvant être avancés polir justifier la politique d'un franc
faible
Le prestige d'une monnaie forte flatte la fierté nationale mais a des
conséquences économiques et sociales néfastes, contribuant à établir un
équilibre durable de sous-emploi. La monnaie est active. L'inflation, si elle
est
modérée et maîtrisée, est préférable à une inflation (presque) nulle, car
elle stimule les emprunteurs (l'investisseur et le consommateur). Le dilemme
i
nflation/chômage est encore d'actualité (relation de Phillips).
-
La politique de désinflation compétitive actuelle s'apparente à la politique de
déflation de sinistre mémoire.
Niveau 2:
8 à 13/20
A. Savoir-faire :
Les idées directrices sont bien formulées et se répondent entre
elles.
Les arguments sont plus convaincants. Un débat apparaît nettement et
les exemples sont plus variés. Des transitions sont rédigées à la fin des prin-
cipales parties du devoir. L'expression écrite est bien maîtrisée, même si elle
est assez « plate », elle est toujours correcte.
B.
Analyse et références théoriques. Exemples historiques
Exemples d'arguments pouvant être avancés pour justifier la politique dit franc
fort
-
La politique du franc fort n'est pas néfaste. Les taux d'intérêt ne pénalisent
pas l'investissement car ils sont actuellement très bas et la marge brute d'au-
tofinancement des entreprises reste élevée depuis plusieurs années (elle est
encore de l'ordre de 120% en 1997).
- Le franc fort est un gage d'indépendance. Par exemple, il met les entreprises
françaises à l'abri des OPA « inamicales » et leur permet de se déployer à l'ex-
térieur par l'acquisition à faible coût d'actifs à l'étranger, comme en
témoigne le renforcement du capitalisme français et de son rayonnement
depuis la fin des années 1980. De plus, une monnaie forte protège le pays de
« l'inflation importée ». Par exemple, les répercussions des hausses du prix du
pétrole des années 70 ont provoqué une forte inflation en France, alors que
l'
Allemagne bénéficiait d'un DM fort pour paver ses importations obligées.
-
La politique du franc fort est bénéfique pour l'avenir. Elle oblige les entre-
prises à choisir une bonne spécialisation internationale, sur des produits à
forte intensité technologique qui échappent à la concurrence par les prix, et
à se placer sur le terrain de la concurrence
par l'innovation (c/ Raymond
Vernon) et par les services d'accompagnement
-
Avec le temps, une monnaie forte gagne progressivement l
a confiance des
marchés, sans l'appui de taux d'intérêt artificiellement élevés.
-
La solidarité européenne s'impose à la France. Après les derniers réajuste-
ments des années 1980, la France s'est convertie à l'orthodoxie pour main-
tenir le franc dans le SME. Aujourd'hui, elle partage une responsabilité par-
ticulière avec l'Allemagne dans l'achèvement de l'Union économique et
monétaire.
Exemples d'arguments pouvant être avancés pour justifier la politique d'un franc
fa
ible
Les investissements à l'étranger, facilités par un franc fort, correspondent à des
délocalisations d'activités qui pénalisent l'emploi sur le territoire national.
Une monnaie faible est une « monnaie d'attaque » efficace sur les marchés
extérieurs. Les exemples sont nombreux, comme la percée à l'exportation de
l'
Allemagne avant 1961 et du Japon avant le deuxième choc pétrolier- les

avancées commerciales actuelles de la Corée, des Économies dynamiques
d'Asie (EDA) et d'autres PED à monnaie faible, ainsi que les États-Unis
depuis 1992-1993.
- Le vieux dilemme
«dévaluation/déflation»
des années 1930 se présente
aujourd'hui sous la forme de l'alternative « dépréciation/désinflation ». Avec
l
a politique d'une monnaie forte, l'économie financière prévaut sur l'écono-
mie réelle, comme le montrent la politique monétaire suivie par les
Britanniques aux lendemains de la Première Guerre mondiale (fustigée par
Keynes) et en 1947, quand ils ont tenté de restaurer la convertibilité de la
livre à une parité irréaliste. L'exemple des politiques suivies par Winston
Churchill en 1925 ou par Pierre Laval en 1935 peut être rappelé. De même,
l
a politique de Mrs Thatcher a pénalisé l'appareil de production alors que se
développait l'économie financière : « la Cite contre Manchester», ou un
déclin économique, suivant l'analyse de Nicolas Kaldor. À l'opposé, le choix
de sacrifier la monnaie au plein emploi a été fructueux après la Seconde
Guerre mondiale (voir le débat entre René Pleven et Pierre Mendès-France)
et aujourd'hui, dès lors que les
fondamentaux
sont sains, le choix en faveur
de l'emploi s'impose à nouveau.
Niveau 3: 14/20 et plus
A. Savoir faire :
Le devoir suit une bonne progression, perceptible dans le plan
général et dans la démonstration des idées directrices. Les arguments et les
contre-arguments sont classés du plus banal au plus convaincant. Les
exemples historiques sont variés et judicieusement choisis. Les transitions
sont habiles et les conclusions sont claires et nuancées. L'expression écrite est
claire, précise, dense, voire élégante.
B.
Analyse
et références théoriqu
es.
Exemples historiques
Exempl
es d'arguments
pouvant être avancés
pou justifier la
politique du
franc
fort
-
La politique du franc fort a rompu avec l'enchaînement pernicieux des anti-
cipations inflationnistes des agents et avec le cercle vicieux de « l'infla-
tion/dévaluation », car la courbe en J ne fonctionne plus.
- L'analyse du «cercle vertueux » d'une monnaie forte est approfondie. Les
approvisionnements extérieurs sont bon marché, les coûts de production en
sont réduits d'autant, la compétitivité prix s'en trouve améliorée à terme et
les performances à l'exportation en sont facilitées. Les exemples allemand
(
depuis la première réévaluation du DM en 1961) et japonais (depuis la fin
des années 1970) montrent les avantages d'une monnaie forte.
-
Le protectionnisme monétaire, représenté par une monnaie faible, n'est pas
nécessaire car nos importations progressent peu.
- Le franc fort ne pénalise pas l'investissement. Si les entreprises investissent
peu, c'est à cause de la faiblesse de la demande effective. Seule une relance
concertée pourrait stimuler la demande effective, mais sa réalisation reste
illusoire, comme le montre l'échec de l'Initiative de croissance européenne
(ICE) de Jacques Delors, alors président de la Commission.
-
L'autonomie de la politique monétaire est impossible pour un État membre
de l'Union européenne (triangle d'incompatibilité de Robert Mundell :
autonomie de la politique monétaire, système de change fixe (ou encadré) et
libération des changes).
-
La politique du franc fort doit augmenter le poids de notre monnaie dans la
définition de l'euro et le poids de la France dans le directoire du futur
Système européen de banques centrales. La France sera moins soumise à la
«dictature» de la Bundesbank.
Exemples d'arguments pou vaut être avancés pour justifier la politique d'un franc
faible
-
Il
est légitime de riposter par une politique de franc faible aux partenaires
déloyaux quand ils mettent en oe
uvre une politique de « dévaluation compé-
titive » dans les années 30 et quand ils adoptent aujourd'hui une politique de
« dépréciation compétitive » de leur monnaie comme, au début de la décen-
nie 1990, les États-Unis, le Royaume-Uni ou l'Italie.
-
L'abandon de la politique du franc fort permettrait de faire baisser encore
davantage les taux d'intérêt et de stimuler l'investissement et la consomma-
tion à crédit.
-
La France dispose actuellement d'une certaine marge de manoeuvre. Les
conditions de réussite d'une relance par la monnaie sont réunies car la
contrainte extérieure est en grande partie surmontée. L'appareil de produc-
tion est en surcapacité : les entreprises pourraient répondre facilement à une
augmentation de la demande en utilisant leurs équipements et leurs effectifs
de
main-d'œuvre actuels. La balance des paiements est excédentaire.
L'inflation est devenue un "
mal imaginaire", (selon la formule de Jean-Paul
Fitoussi
est
maîtrisé
e grâce
à la politique de déréglementation et de
concurrence.
Barème sujet 2
La question posée en référence à la citation d'Emmanuel, théoricien tiers-
mondiste, implique une réponse nuancée et une mise en perspective de l'évolu-
tion des appréciations portée sur le rôle des firmes multinationales (FMN) dans
l'histoire du développement.
Le champ du sujet est vaste. Il ne s'agit pas de répondre en se référant seu-
le
ment à l'Afrique mais de prendre en compte le développement des pays,
industrialisés ou non, sans écarter le rôle des FMN dans les ex-pays socialistes en
transition. Si la citation d'Emmanuel suppose une attention particulière aux
pays en développement (PED), l'expression «histoire du développement» et le
document n°1
i
ndiquent explicitement l'étendue de la question

Pour répondre, le candidat doit donc tenir compte de toutes les dimension
s
du sujet (dimensions historique et spatiale) et de tous les aspects (économiques
,
politiques et sociaux). Il est invité à prendre une position personnelle, tout en
gardant une distance critique à l'égard des changements d'attitude constatés
.
Aucune réponse ne saurait a priori être rejetée. Pour le correcteur, seule la
richesse et l'articulation de l'argumentation doivent compter.
L'utilisation des documents statistiques, pour étayer l'argumentation, sera
valorisée. Les exigences en matière de savoir-faire et de « savoir-réfléchir », défi-
nies par le passé, sont maintenues.
Niveau 1: 0 à 7/20
A.
Savoir-faire:
Le devoir suit deux ou trois idées directrices : un plan est percep-
tible.
Les arguments utilisés pour les démontrer sont de valeur inégale, mais il y
a une argumentation. Les exemples, même s'ils sont peu variés, sont tirés de
l'histoire de plusieurs pays. L'expression écrite est correcte. Quelques fautes
d'orthographe et de syntaxe peuvent être tolérées à ce niveau.
B.
Analyse et références théoriques. Exemples historiques
Pour atteindre la note maximale de ce niveau, on peut s'attendre à ce que le can-
didat explicite clairement les enjeux de la question posée. Longtemps, les FMN
ont été suspectes aux veux de nombreux observateurs. Elles ont été accusées de
participer au « pillage du tiers-monde », de conforter l'ancienne DIT, de parti-
ciper à l'exploitation de la « périphérie » par le « centre », de déstabiliser politi-
quement et socialement des pays d'accueil, de les polluer... En un mot, d'être
l
es vecteurs de l'impérialisme (américain ou occidental). Or, aujourd'hui, l'im-
plantation des FMN est de plus en plus sollicitée, y compris par les États «ex»
ou encore socialistes. Qu'est-ce qui justifie ce changement d'attitude ?
À cc niveau d'analyse, un rapide bilan des différentes stratégies de développe-
ment semble nécessaire et les candidats devront montrer qu'ils connaissent les
théories de base de l'échange international. Ils devraient évoquer brièvement
l'i
mpact des investissements directs à l'étranger (IDE) et des stratégies de délo-
calisation.
Une référence aux documents est attendue pour dresser un bref
constat de l'évolution des IDE, de leur rôle à la fois dans l'émergence de cer-
tains PED et dans la marginalisation de beaucoup d'autres.
Niveau 2:8 à 13/20
A. Savoir faire :
Les idées directrices sont bien formulées et se répondent entre
elles. Les arguments sont plus convaincants. Un débat apparaît nettement et les
exemples sont plus variés.
Des transitions sont rédigées à la fin des principales parties du devoir.
L'expression écrite est bien maîtrisée
;
même si elle est assez « plate » elle est tou-
j
ours correcte.
B.
Analyse et références théoriques. Exemples historiques
Dans cette plage de notation, on s'attendra à une vision plus large du sujet
et à des références théoriques et historiques acquises notamment par l'étude
du programme de la première année de prépa. Ainsi, la question de la trans-
mission de la croissance ou de son blocage doit-elle être largement abordée.
Une analyse plus fine des stratégies de développement et des avantages et
inconvénients de l'action des FMN doit être menée. Par exemple, on peut
montrer que la plupart des entreprises publiques des pays du Sud n'ont pas
réussi à créer
Lui
environnement industriel propice au développement, pour
cause de stratégie erronée, de gabegie ou de prévarication. On peut s'inter-
roger sur le rôle des FMN dans le développement des « Dragons », on peut
se demander si les FMN sont les seules coupables de l'exploitation en vou-
lant
maximiser leur profit, si les autorités locales (à l'Est comme au Sud)
n'ont pas une part de responsabilité. Enfin, les effets attendus pour les pays
d'accueil doivent être étudiés sur plusieurs plans : en terne d'emploi, de
revenu, de consommation, de balance des paiements, de structure de mar-
ché, de transferts de technologie.
L'analyse s'appuie sur des références théoriques plus riches, comme par
exemple sur la réflexion de W.W. Rostow, de W.J. Baumol, de A. Geschekron,
de R Nurske, de W.A. Lewis, de R. Vernon, ou sur l'analyse de l'impérialis-
me (J. Hobson, Lénine, R Hilferding), de la détérioration des termes de
l'échange (R. Prebisch), de l'échange inégal (S. Amin, A. Emmanuel), etc.
L'histoire du développement est réellement prise en compte. Le candidat qui
mettra en parallèle le développement des FMN et de l'IDE avec le dévelop-
pement de l'économie du monde capitaliste et sa hiérarchisation sera valori-
sé.
Le discours pourra être enrichi par un rappel du passage de la firme
« internationale » à la firme « multinationale » depuis le XIX
e
siècle et par des
exemples historiques, comme ceux de Colt, Bayer, Fîves-Lille, Michelin,
Singer, Kodak, Nestlé. L'étude de l'essor des grandes compagnies pétrolières
au XX
e
siècle, du rôle des FMN américaines dans la transmission de la crois-
sance en Europe après 1945 et du rôle des FM
N sud-coréennc. indiennes
ou brésiliennes dans les années 1960-1980 sera bienvenue.
Niveau 3: 14/20 et plus
A. Savoir-faire :
Le devoir suit une bonne progression, perceptible dans le plan
général et dans la démonstration des idées directrices. Les arguments et les
contre-arguments sont classés du plus banal au plus convaincant. Les
exemples historiques sont variés et judicieusement choisis. Les transitions
sont habiles et les conclusions sont claires et nuancées. L'expression écrite est
claire, précise, dense, voire élégante.
B.
Analyse et références théoriques. Exemples historiques
À ce niveau d'exigence, on pourra trouver une explication de la position
d'Emmanuel. Par exemple, un développement rapide ne peut s'obtenir uni-
quement par des méthodes extensives ou par des « technologies appropriées »
(pour reprendre le titre de la publication de cet auteur). Des gains de pro-

ductivité sont nécessaires pour permettre le rattrapage des pays sous-déve-
l
oppés et ceux-ci ne peuvent s'obtenir qu'avec des technologies modernes.
Le recours aux FMN peut donc constituer un raccourci utile, à condition
que les pouvoirs publics du pays d'accueil disposent d'une capacité de
contrôle et de négociation et que les investissements soient judicieusement
choisis.
D'où un impact plus favorable pour les pays capitalistes développés
ou pour les pays non développés qui sont en situation d'imposer leurs règles
aux FMN. Toute tentative cohérente d'explication de ce qui paraît être une
attitude paradoxale de la part d'Emmanuel sera valorisée.
Ainsi peut-on montrer qu'à condition de respecter certaines règles, les FMN
peuvent contribuer au développement, ce qui explique la mise en oeuvre des
politiques et tentatives pour contrôler les investissements (exemple : le Trade
Related Investment
Measures [ou TRIM] dans le cadre du GATT).
L'analyse de Dunning (référence dans le document 1) sur les avantages
recherchés par les FMN qui cherchent à développer leurs IDE, confrontée à
une analyse des avantages recherchés par les pays d'accueil, peut aboutir à
une interrogation sur les conditions qui font que l'implantation des filiales
des FMN peut être un jeu à somme positive.
La question des FMN, vecteurs de différents modes de production et de
consommation capitaliste doit aussi être plus largement envisagée et doit
i
ntégrer les dimensions sociales et politiques. Ainsi, C.A. Michalct relie-t-il
l
es différentes phases de la « multinationalisation » des entreprises à l'intégra-
tion progressive des différents marchés et à la constitution d'un
Capitalisme
mondial.
Le point de vue d'A. Lipietz concernant le développement d'un
fordisme périphérique
(
Miracles et mirages, 1985)
peut aussi servir de réfé-
rence à l'analyse, tout comme celui de W. Andreff sur la constitution d'une
économie-monde duale.
III•Commentaires
Pour cette première session du nouveau régime du concours, l'épreuve valo-
rise
une formation économique reçue par tous les candidats depuis leur ini-
tiation aux sciences économiques et sociales en classe de seconde. Ils disposent
donc d'un arsenal conceptuel plus solide que par le passé et des références his-
toriques variées peuvent être trouvées dans le passé récent des PCD. Ils sont
désormais plus aptes à mettre en oeuvre des qualités et des démarches en appa-
rence antinomiques : l'aptitude à l'abstraction et le sens de la réalité historique,
la sérénité d'une réflexion lucide et la prise de risque d'un engagement person-
nel. En exigeant la maîtrise de l'analyse économique et des connaissances histo-
riques basiques, cette épreuve peut limiter le risque du « savoir éclaté » si sou-
vent déploré chez les jeunes bacheliers.
Des sujets ouverts, voire polémiques, sont proposés pour permettre à de
jeunes personnalités de prendre position, de trancher dans un dilemme et d'ar-
gumenter solidement dans le sens qu'ils ont choisi.
Commentaires sujet 1
En ce qui concerne la méthode, de nombreux correcteurs soulignent la ten-
dance à adopter une approche journalistique du sujet. Plusieurs candidats ont
voulu « accrocher » l'attention du correcteur en rappelant les déclarations récentes
de personnalités politiques qui justifient (ou condamnent) la politique du franc
fort.
D'autres évoquent dès les premières lignes la thèse du
Débat interdit
de
Je
an-
Paul Fitoussi contre l'ancrage du franc sur la monnaie allemande. Cette manière
d'attirer l'attention du correcteur sur l'actualité de la question n'est-elle pas un
procédé un peu trop scolaire? Une référence à la presse est-elle la meilleure maniè-
re de prendre du recul et de donner à la question sa dimension historique ? Les
arguments d'un « essayiste » ne méritent-ils pas d'être pris en compte dans le corps
de la démonstration ? Voilà des questions posées aux futurs candidats.
Sur le fond, les correcteurs se félicitent que de nombreux candidats aient effec-
tivement confronté l'analyse économique à la brutalité des faits. Par exemple, ils ont
rappelé que le spectre de l'hyperinflation des années
1922-1923
permet de com-
prendre le choix de la politique de stabilité monétaire suivie en Allemagne après la
Seconde Guerre mondiale et le choix d'une monnaie fréquemment réévaluée
depuis
1961 ;
que le Royaume-Uni connaît des velléités récurrentes de redorer le
blason de la livre, depuis Wilson Churchill qui voulait que la livre « regarde le dol-
lar en face » dès
1925,
qu'en France l'arrivée sur la scène politique « d'hommes pro-
videntiels», comme Raymond Poincaré, incarnant l'orthodoxie et inspirant
confiance aux marchés financiers fut parfois efficace en elle-même et que leur cré-
dit leur permit de faire l'économie de politiques trop restrictives.
Certaines faiblesses sont souvent soulignées. Des candidats souhaitent enco-
re aujourd'hui une baisse des taux d'intérêt cri France et oublient qu'ils sont
parmi les plus bas du monde (après ceux du Japon). Faut-il irriguer en période
d'inondation? Ils ne voient pas toujours que des taux bas permettent de rédui-
re la charge du service de la dette publique, puisque l'État se finance à moindre
coût et il s'en suit une meilleure maîtrise du déficit budgétaire
Les conséquences du chômage ne sont pas toujours analysées, mesurées par
le coût direct pour les comptes de la nation (les indemnités), par le coût indi-
rect (la non-participation à l'effort productif) et par le coût social (la ., fracture
sociale »). Certains candidats omettent d'indiquer que la baisse du taux de chan-
ge améliore la compétitivité prix mais que la grande élasticité des importations
rend d'autant plus pressante la contrainte extérieure.
Finalement, trop de candidats sont timorés dès qu'ils sont mis en demeure
de porter un jugement et de prendre une position personnelle dans le débat.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%