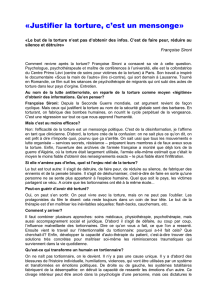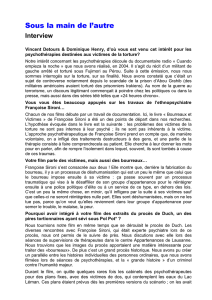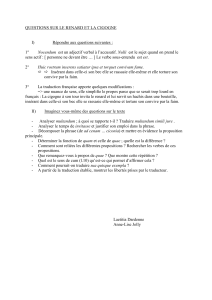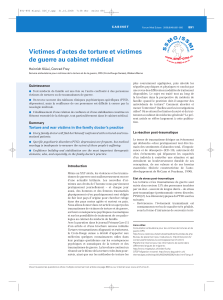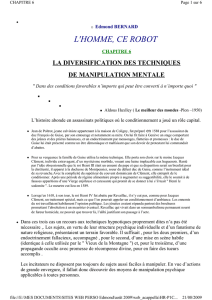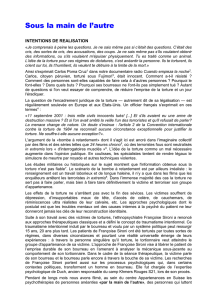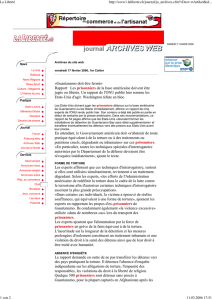Vous avez dit justice

avec le soutien financier de l’Union européenne
Photographie de couverture : © Fethi Belaid / AFP - Conception graphique : © coralie.pouget@acatfrance.fr
ACAT-France en collaboration avec Liberté et équité et l’OCTT
JUIN 2012
Vous avez dit justice ?
ETUDE DU PHENOMENE TORTIONNAIRE EN TUNISIE


ACAT-France, en collaboration avec Liberté et équité et l’Organisation contre la torture en Tunisie
JUIN 2012
Vous avez dit justice ?
ETUDE DU PHENOMENE TORTIONNAIRE EN TUNISIE

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Le contenu de ce document relève de la seule
responsabilité de l’ACAT-France et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union européenne.

3ETUDE DU PHENOMENE TORTIONAIRE . TUNISIE
Resume
Avec la fuite de l’ex-président Ben Ali le 14 janvier 2011, la chape de silence recouvrant le phénomène tortion-
naire s’est enfin brisée. Le peuple tunisien dresse progressivement le bilan de 23 ans d’autoritarisme et exprime
aujourd’hui une ferme exigence de justice et une profonde détermination à ne plus laisser des exactions se
reproduire sans rien dire. Depuis plus d’un an et demi, l’éradication de la torture et la lutte contre l’impunité sont
ainsi au cœur des débats politiques et citoyens en Tunisie. Pourtant, une révolution et une élection démocratique
plus tard, la volonté populaire n’a toujours pas eu raison des pratiques tortionnaires et de l’impunité héritées de
l’ancien régime.
La politique de prévention de la torture et de lutte contre l’impunité menée par les autorités tunisiennes depuis la
révolution présente un bilan en demi-teinte.
Le nombre des récits de tortures et de mauvais traitements collectés et la diversité des profils des victimes
amènent à constater que l’utilisation de la violence par les forces de sécurité demeure très répandue. La torture
est certes moins systématique qu’à l’époque du régime de Ben Ali mais elle continue d’être exercée, essentielle-
ment à des fins punitives et aussi, dans certains cas, dans le but d’extorquer des aveux. Selon les militants asso-
ciatifs, les acteurs politiques et les représentants de l’administration rencontrés pendant la mission d’enquête,
les raisons de la persistance du phénomène tortionnaire sont de deux ordres : la force de l’habitude et l’impunité
généralisée.
La force de l’habitude
Dans le cadre des manifestations, les forces de l’ordre usent souvent d’un recours excessif à la force. À de
nombreuses reprises depuis la révolution, les agents de police et notamment les agents des forces d’intervention
– anciennes brigades de l’ordre public - ont dispersé les protestataires à coups de matraques et de gaz lacry-
mogènes et ont parfois procédé à des arrestations musclées, elles aussi accompagnées de tortures. Ces actes
sont manifestement planifiés et ordonnés, du moins à un certain niveau. En représailles à ces manifestations,
les policiers se sont livré, dans les jours et semaines qui ont suivi, à des arrestations et à des mesures punitives
d’une extrême violence.
Les journalistes, les blogueurs et les vidéastes amateurs sont aussi devenus les « bêtes noires » des agents des
forces de sécurité et sont, à ce titre, particulièrement susceptibles d’être agressés au cours des manifestations.
Les personnes suspectées d’avoir commis un crime de droit commun continuent, elles aussi, d’être des victimes
privilégiées de la torture et des mauvais traitements infligés par des policiers qui voient dans la violence un
moyen rapide et efficace d’établir la culpabilité d’un suspect. La persistance du recours à la torture dans le cadre
des enquêtes policières s’explique par un écueil fondamental dans les formations théorique et surtout pratique
des policiers. Ces derniers apprennent qu’une enquête peut être plus vite bouclée en extorquant des aveux qu’en
récoltant des preuves matérielles parfois introuvables. Ce type de pratique est d’ailleurs implicitement encouragé
par les juges qui utilisent volontiers les aveux ainsi soutirés.
L’ACAT-France a par ailleurs recueilli plusieurs témoignages concernant des personnes qui ont été torturées
pour la simple raison qu’elles avaient eu un désaccord avec un agent de la force publique ou un de ses proches.
Enfin, la libération des prisonniers politiques après la révolution et le changement de direction au sein de l’admi-
nistration pénitentiaire n’ont pas non plus suffi à enrayer totalement le recours à la torture et aux mauvais trai-
tements au sein des centres de détention. Il s’agit là d’une habitude bien ancrée consistant pour les gardiens à
recourir à la violence à l’encontre des détenus à des fins essentiellement punitives.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
1
/
66
100%