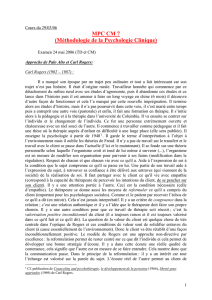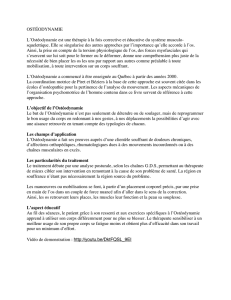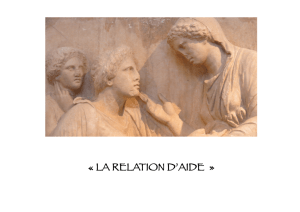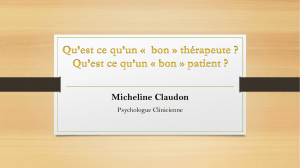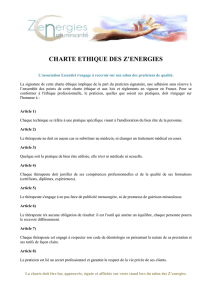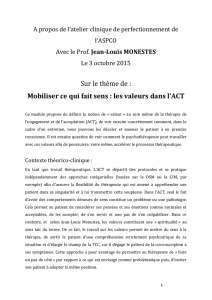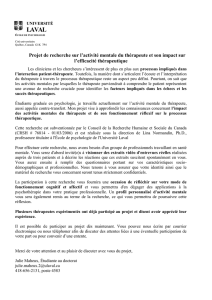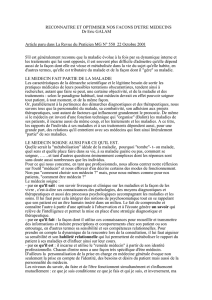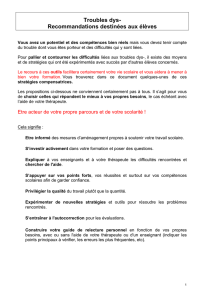Entrer dans le monde de Carl Rogers

TRAVAIL THEORIQUE DE FORMATION EN PSYCHOTHERAPIE
Entrer dans le monde de
Carl Rogers
De personne à personne
Septembre 2008
Ce texte est le fruit d’une première réflexion sur la psychothérapie en Approche Centrée sur la Personne. Il me
paraît important de souligner qu’hormis les apports dont j’ai pu bénéficier dans des contextes informels ainsi
qu’en situation d’entretiens ponctuels de soutien psychologique, ce travail présente la grande faiblesse de ne
pas s’inscrire dans l’expérience concrète d’une pratique psychothérapeutique.

Boris Dunand – septembre 2008
2
Prière de citer la paternité en cas d’usage. (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/ch/)
« I wish that for just one time, you could stand inside my shoes » - Bob Dylan
Impressions personnelles
Ce qui m’aura le plus frappé durant mes premières lectures, c’est sans doute la façon dont s’enracine
l’apparente simplicité de la pensée de Carl Rogers dans une vision fine et complexe de l’individu,
reposant sur une réalité concrète, solide de faits et d’observations exigeantes, et parcourue d’un bon
sens qui pourrait presque paraître naïf mais ne l’est définitivement pas. Découvertes successives d’une
profondeur insoupçonnée sous le premier visage si simple de son approche. « Ecouter,
chaleureusement, accepter ». Oui mais… Pourquoi ? Comment ? Pour aller où ? Seulement !? Pour
quels motifs ? Et qu’obtient-t-on avec ça ? Et comment se fait-il que nous obtenions ceci ? A toutes
ces questions, on trouve des réponses, précises, riches, subtiles, des réponses qui ne tiennent pas aux
structures aériennes et volatiles d’une pure pensée mais aux constats d’une théorie qui s’est construite
dans la pratique et dans la durée de celle-ci. Par ailleurs, le caractère ouvert de son système permet de
s’y sentir libre et d’entrevoir la possibilité d’y creuser un jour des pistes personnelles, des façons
singulières de se l’approprier, ce qui laisse – dans un cadre défini et éthique – la créativité de chacun
entendre une promesse d’épanouissement et qui sait, pour mon compte, de devenir un jour un « fully
functioning therapist »1
Pour Carl Rogers, l’être naît avec un potentiel qui ne demande qu’à fleurir sur le terreau du monde.
Encore faut-il que ce terreau lui soit favorable, c’est-à-dire qu’il réponde suffisamment à ses besoins
pour qu’il puisse s’actualiser – s’auto-actualiser, une tendance que Rogers conçoit commune à
l’ensemble des êtres humains. Le petit se trouve catapulté dans un environnement, une famille, une
culture, une école, etc. Absences et présences, carences et richesses, toutes les caractéristiques de cet
entourage seront le terreau dont il devra s’accommoder et/ou profiter. Déjà son corps s’anime et fait
l’expérience de l’existence, déjà il est pris par les besoins fondamentaux d’attention, de contact, de
chaleur, d’estime et d’amour, et bientôt il commencera le hasardeux et grave commerce de son être
pour obtenir ces choses qui lui sont vitales. Chaque fois que son « expérience organismique » –
comme appelle Rogers le vécu subjectif de l’être – lui suscite un besoin, une expression, un
sentiment, un comportement qui ne trouve pas la faveur ou simplement la réponse adéquate de son
environnement, chaque fois s’imprime en lui les bases d’un apprentissage. Petit à petit, il comprend
qu’il y a un lien entre sa façon d’agir et les réactions provoquées par celle-ci autour de lui. Il cherche
l’amour et l’entente, le bien-être et la paix, le plaisir et la joie, et parfois il constate que certains de ces
agissements lui rapportent exactement le contraire : discorde et rejet, mésentente et frustration, douleur
et haine. Alors il va peu à peu se plier aux « jeux » dans lequel il est pris. C’est le début de
l’incongruence : déformer la conscience du vécu intérieur pour l’adapter aux exigences extérieures et
s’assurer les sentiments positifs d’autrui, devenus ainsi conditionnels. C’est au prix d’une guerre
intestine que l’être obtient une paix toute factice avec son entourage ! Il ne peut plus accepter la réalité
de son intimité parce qu’elle menace de lui faire perdre l’amour et l’estime de ses proches et moins
proches. Sentiments, besoins, émotions, désirs, ceux devenus prohibés à force d’éducation et de
mésaventures relationnelles, mais qui se trament cependant toujours dans sa chair, ne sont plus
entendus par sa conscience. Il s’en coupe et s’en défend, refoulant tout ce qui met en danger son « être
au monde » et supportant tant bien que mal les tensions qu’il commence à souffrir. (C’est quand il ne
supporte plus qu’il cherche de l’aide, à condition que le mal soit assez grand pour fournir l’énergie
nécessaire au courage d’affronter les réalités intérieures). Non moins totalité psycho-physique pour
!?
L’individu. Naissance et potentiel. Environnement et caractéristiques. Auto-actualisation. Apprentissage et
éducation. Incongruence – dysfonctionnement, tension, malaise, problème. Relation d’aide. Processus
thérapeutique. Congruence – harmonie conscience et expérience, créativité, responsabilité. Vie pleine – un flux
de changements et d’adaptations.
1 Référence au terme de « Fully Functionning person » que Rogers utilise pour désigner la personne qui a retrouvé une fluidité congruente
non défensive dans son rapport à la complexité de l’expérience humaine.

Boris Dunand – septembre 2008
3
Prière de citer la paternité en cas d’usage. (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/ch/)
autant, il devient difficile pour lui de se communiquer ses propres sentiments et donc de les
communiquer à autrui, difficile d’avoir conscience de ce qu’il ressent exactement, de partager son
vécu et donc d’entrer en relation de façon authentique, satisfaisante. Ainsi, ses expériences subjectives
de l’ici-maintenant, qui servent à la construction de son « moi » dans l’acceptation rogerienne, sont
filtrées en fonction de leurs effets positifs ou négatifs : celles qui servent correctement au dessein
d’acceptation sociale sont emmagasinées dans le registre conscient, tandis que les autres, desservant ce
même dessein, sont passées sous silence, déformées, niées, amputées… Son « moi réel » ne lui est
plus accessible, comme caché sous les couches successives de mensonges qu’il se fait à lui-même
inconsciemment, pour préserver l’équilibre de son monde. Son « cadre de référence interne » a laissé
passer et incorporé tant de valeurs et de références étrangères en s’y conformant qu’il en est comme
pollué et qu’il n’a plus la capacité d’évaluer correctement l’adéquation de ses choix de vie en regard
de ses besoins propres. Son potentiel d’être fondamentalement social, rationnel et constructif – tel que
Rogers pense chacun d’entre nous1 – se trouve ainsi bridé, empêché, contraint. L’individu
dysfonctionne et ses frustrations le poussent à s’engager dans des comportements destructeurs,
morbides, non-« naturels »2
« La perte de liberté expérientielle ». C’est sous cette formule que Rogers résume ce que je viens de
décrire. L’individu ne peut plus faire librement l’expérience de sa réalité organico-psychique, et donc
conséquemment affective, intellectuelle, sociale… La personne est devenue un personnage et elle joue
le rôle qui lui a permis d’être acceptée dans un environnement qui n’a pas su, pas pu l’accepter,
l’estimer et l’aimer telle qu’elle se donnait. Elle se défend d’être elle-même, parce qu’être soi-même
rime avec rejet, jugements négatifs, humiliation, bref : danger… Toute une bonne série de raisons
d’avoir élaboré ces stratégies de défense et de protection.
, toujours selon Rogers. (On trouve ici une distinction capitale vis-à-vis de
la pensée freudienne, qui considère que les pulsions morbides, thanatos, de mort sont à l’œuvre au
cœur de l’être humain de façon spontanée et dès l’origine de sa venue au monde.)
Avant de revenir, dans la deuxième partie de ce travail, à l’évolution du rapport de l’individu à son
« moi idéal », décrivons brièvement celui-ci. Il s’agit du soi que le sujet voudrait atteindre, une image
idéale de ce à quoi il voudrait ressembler et ce vers quoi il tend donc. En état d’incongruence, le sujet
souffre de la trop grande distance qui le sépare de ce moi idéal et parfait, d’autant plus que ses
comportements inadaptés lui rendent l’approche plus difficile.
3
1 Je pense pour ma part qu’on ne peut être social, rationnel et constructif qu’en étant asocial (besoin de solitude, distance, retraite), irrationnel
(rêve, poésie, imagination, etc.) et destructeur ((se) construire suppose (se) déconstruire, désapprendre, se distinguer des habitus, opérer des
séparations, des coupures, des ruptures avec les héritages culturels, familiaux, etc.).
2 Il me semble important de se méfier du concept de l’ « homme naturel » : le concept de « nature humaine » ne tient pas, il y a de la nature
dans la culture, de même qu’il y a de la culture dans la nature (cf. Morin Edgar, Le paradigme perdu : la nature humaine, Editions du Seuil,
1973).
3 D’où l’importance fondamentale et première d’instaurer un climat de sécurité dans la relation thérapeutique.
N’est-ce d’ailleurs pas ce qu’il s’agit de
comprendre : que la personne a de « bonnes raisons » d’être devenue ce personnage ?! En effet, cette
notion me semble centrale, en ce que la tâche du thérapeute est précisément de comprendre de
l’intérieur les motifs qui structurent la personnalité composée, de sentir et saisir les mailles de sens qui
permettent à l’individu de tenir tel qu’il est, d’entrer dans ce monde singulier de significations qui lui
ont permis de survire dans l’environnement qui fut le sien. Or, partir du principe que la personne a de
« bonnes raisons » de se manifester comme elle se manifeste me semble une bonne prémisse à cette
mission.
Mais alors…
Que peut faire la thérapeute ? A quelles conditions ? Comment ?
…exploration des outils rogeriens :

Boris Dunand – septembre 2008
4
Prière de citer la paternité en cas d’usage. (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/ch/)
Indications, contre-indications. Tests ? Diagnostique ? Objectifs thérapeutiques. Outils - Exploration de soi -
Attitude thérapeutique. Facilitation ? Effets ? Processus thérapeutique - 7 stades et constantes. Effets et
résultats. Pourquoi et comment ? Vie pleine !?
Après avoir présenté ci-dessus la façon dont j’ai intégré les notions rogeriennes concernant l’individu
et son fonctionnement, j’aimerais passer à ce que j’ai enregistré du processus thérapeutique et de ses
effets sur le client. Voyons déjà le problème des indications et contre-indications. Un tableau
permettra d’y voir plus clair.
INDICATIONS
Le client présente…
CONTRE-INDICATIONS
Le client présente…
1. Trouble psy à base d’incongruence
2. Conscience de soi et capacité de relation à soi
3. Perception minime au moins de son incongruence
et désir de changement
4. Capacité à percevoir et accepter l’aide (à évaluer
au premier entretien)
5. Sentiment que diminution de l’incongruence est un
premier pas vers le mieux-être
Troubles plus indiqués :
- Phobie
- Dépression
- Angoisse
…plus que les troubles obsessionnels
…et plus que de graves troubles de personnalité
qui néce
ssitent une plus grande durée de
traitement pour une compensation
- Personnalité hyper-
narcissique (risque d’être
renforcée)
-
Sujet contraint et sans motivation ni besoin
(encore que la contrainte puisse être un levier de
rencontre)
- Sujet avec attente excess
ive de conseils et
directives (idem)
Troubles peu indiqués :
- Toxicodépendance
- Schizophrénie
Troubles hystériques et PTSD
FACTEURS IMPORTANTS
Diagnostique ? Non !
Relation de confiance ? Oui ! (Climat de sécurité, empathie, congruence, acceptation)
Aussi :
capacité d’auto-exploration
intensité du désir de confrontation des contradictions internes
L’incongruence, concept central chez Rogers, se retrouve au centre des indications pour une thérapie
ACP. Signe (minimal ?) de cohérence ! Je me hasarderai à comprendre que si phobie, dépression et
angoisse sont plus indiquées que les autres troubles, c’est que ces symptômes sont – a priori – moins
susceptibles de contrecarrer les tentatives d’exploration de soi – un autre thème très important de la
thérapie rogerienne, élaboré plus bas. En avançant cela, je pense d’avantage aux troubles
obsessionnels, troubles de la personnalité et schyzophrénie qu’à la toxicodépendance (est-elle
d’ailleurs un « trouble » en soi ?) ; je ne connais pas les motifs de contre-indications pour celle-ci. Non
Ok si constitue une pré-
thérapie, thérapie de soutien
ou avec cadre plus structuré
qu’usuellement

Boris Dunand – septembre 2008
5
Prière de citer la paternité en cas d’usage. (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/ch/)
plus pour les troubles hystériques. Pour les PTSD, j’imagine que des outils spécifiques sont
nécessaires, quoique l’exploration de l’événement traumatisant afin d’en collecter les pièces
mnésiques fragmentées et de les réunir en un souvenir cohérent, intégrable à la mémoire
autobiographique, fasse partie des démarches idoines1
Comme nous le verrons ci-dessous, l’instauration d’un climat et d’une relation de confiance est
nécessaire. C’est même le cœur du travail du thérapeute, qui devra tout faire pour que l’individu se
sente assez en sécurité pour explorer ces parties de soi refoulées parce que menaçantes, et qui ne
peuvent donc éclore au plein jour que dans une atmosphère de grande confiance, ce que l’acceptation
inconditionnelle du thérapeute tend à créer. En explorant son vécu, le client peut commencer à le
comprendre pour finir par l’accepter, puis le vivre : « Je suis venu pour résoudre des problèmes, et je
me mets à simplement faire l’expérience de moi-même. »
, ce en quoi l’approche rogerienne me semble
favorable (?).
Le diagnostique servira exceptionnellement à l’échange d’informations professionnelles, mais
l’approche rogerienne évite de réduire l’individu à n’importe quelle étiquette. (Autres applications ?)
2
Le psychothérapeute cherche ainsi à créer un climat relationnel caractérisé par un certain nombre de
vertus, toutes destinées à faciliter le passage, chez le client, du pôle de dysfonctionnement à celui de
plein fonctionnement, par le biais de l’exploration de soi. On pourrait peut-être imager ceci ainsi : le
thérapeute ouvre et crée un « univers parallèle » dans lequel le monde du client devient totalement
Objectifs thérapeutiques, outils
Si je devais résumer (en faisant fi de l’absurdité de la chose) à une seule tâche le métier du
psychothérapeute rogerien, je choisirais la nécessité dans laquelle il se trouve de devoir tenter de
comprendre son client au plus près de sa réalité singulière, en reflétant les détails de son cadre de
référence avec la plus grande exactitude possible. (Ce qui suppose un désir réel, une curiosité
authentique envers l’être humain, dans son irréductible différence et étrangeté). J’ajouterais ensuite,
accepter. (Même si, en fait, « se mettre en quête pour comprendre vraiment » présuppose le désir et la
résolution de tout accepter, de même qu’accepter nécessite la compréhension ; une acceptation qui ne
comprend pas n’est pas une acceptation, c’est une tolérance). Puis, communiquer cette acceptation.
Surtout, faire en sorte qu’elle soit perçue ! Tout maître de son art que soit le thérapeute, c’est pour les
nuages qu’il reflète et reformule ce qu’il comprend du patient si celui-ci ne perçoit rien de la nature de
sa présence. Parmi ses outils, l’empathie sert précisément à faire sentir cette qualité de présence, la
congruence lui donne son caractère réel, honnête et sécurisant. (On devine ce que ceci suppose de
travail préalable chez le thérapeute sur sa propre personne, qui doit être assez sûre pour tenir sa propre
position, sans recouvrir l’autre avec ses propres structures et significations, et cependant être capable
d’entrer dans le territoire de cet autre sans s’y perdre lui-même.) Concernant l’exploration de soi chez
le client, je m’explique les effets facilitateurs et éclairants de la reformulation et du reflet comme suit :
lorsque le client reçoit le miroitement que lui propose le thérapeute, il peut soudainement voir ce qu’il
pensait ou ressentait, porté devant lui, extérieur à lui, et la chose qui jusque là n’avait pu lui être
accessible que contenue dans le magma fourmillant de son monde intérieur, apparaît maintenant
comme une bille désafférentée de toutes les connexions qui l’entouraient dans sa subjectivité, ainsi
nette et distincte de toute influence perceptive, de toute résonnance intérieure, comme épurée,
élaguée ; et, suis-je tenté d’avancer, simultanément : amplifiée dans sa signification par à la fois la
pureté de son « son » et les « bruits » qu’y aura insufflé la personnalité du thérapeute. On peut dire
ainsi que, non seulement, il n’avait jamais vu cet objet intérieur aussi clairement, distinctement et
précisément, mais en plus – pour peu que le thérapeute sache ajouter à son reflet la substance de sa
propre compréhension sans le dénaturer (c’est, me semble-t-il, tout l’enjeu) – l’intensité de l’objet
reflété se trouve comme doublée par l’écho qui se produit dans les cavités sensibles du thérapeute.
1 Cf. Mémoire autobiographique et self, modèle de Conway, Singer, Tagini (2004)
2 Le développement de la personne, CR, page 60
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%