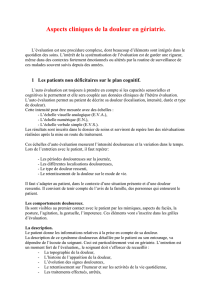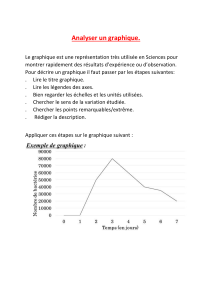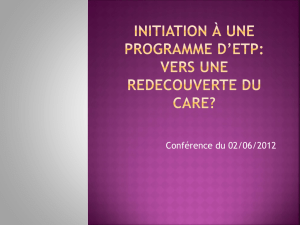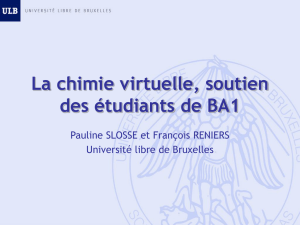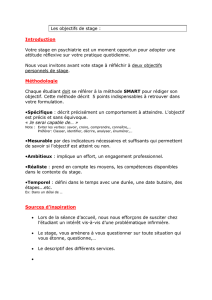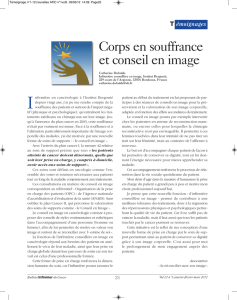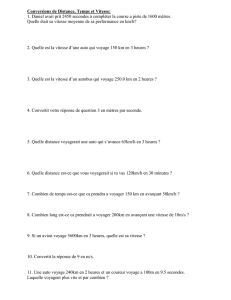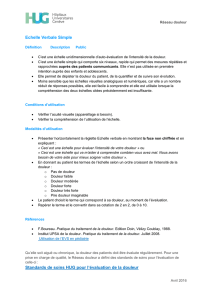mémoire Dutier M2 05 Anonymisé

Année 2004 – 2005 Université Descartes Paris 5 –
Laboratoire d’éthique médicale
Mémoire de Master 2 « Recherche en éthique »
sous la direction de Christian HERVE
La place des échelles d’auto évaluation
de la douleur dans la relation soignant /
soigné

I. Introduction
1. Evolution du concept et de la prise en charge de la douleur
2. Législation et politique de santé publique sur la prise en charge de la
douleur
II. Problématique et hypothèses
1. Problématique : quelle et la place des outils d’auto évaluation dans la
relation soignant / soigné ?
2. Hypothèses
III. Matériels et méthodes
1. Méthodologie employée pour répondre à la première hypothèse : il
existe une difficulté d’appropriation des outils d’auto évaluation par les
patients
2. Méthodologie employée pour répondre à la deuxième hypothèse : Les
outils d’évaluation n’occupent qu’une place réduite dans la prise en
compte globale du patient douloureux
3. Méthodologie employée pour répondre à la troisième hypothèse : Les
professionnels accordent un crédit variable à l’auto évaluation
IV. Résultats
1. Difficultés d’appropriation des outils d’auto évaluation identifiés durant
notre observation
a. Préambule
b. Difficultés d’appropriation du Schéma Corporel
c. Difficultés d’appropriation des échelles unidimensionnelles
d. Difficultés d’appropriation des Grilles multidimensionnelles

B. Résultats obtenus au cours des entretiens sur la place
des outils d’évaluation dans la prise en compte globale du
patient
a. La place des outils d’évaluation dans la prise en charge de la composante
psychologique
b. Les outils d’auto évaluation sont-ils adaptés aux spécificités sociales et
culturelles des patients ?
c. L’ambivalence des outils d’évaluation dans la prise en compte globale du
patient
3. Résultat sur le crédit accordé à l’auto évaluation par les soignants
a. L’impératif éthique du respect de l’auto évaluation
b. Eléments problématiques du non-respect de la parole du
patient
c. Les différences de pratique dans l’évaluation de la douleur
entre les Centres anti-douleur et les autres unités de soins.
V. Revue de la littérature
1. Revue de la littérature sur l’efficacité globale de la prise en charge de la
douleur en France
2. Revue de la littérature sur les difficultés d’appropriation et les
avantages des outils d’évaluation
3. Revue de la littérature la prise en charge globale de la douleur et la
relation soignant / soigné
4. Eléments nouveaux dégagés durant notre étude
VI. Discussion
1. Les enjeux posés par les difficultés d’appropriation des outils d’auto
évaluation

3. Le crédit accordé à l’auto évaluation : réflexion éthique sur la relation
soignant / soigné
a. L’écoute de la plainte subjective du patient et le respect de sa
parole
b. Spécificité et nécessité des centres anti-douleur en milieu
hospitalier
c. Dans quelle mesure l’utilisation des outils d’auto évaluation
constitue-t-elle un problème éthique ?
VII. Conclusion
VIII. Annexes
a. Bibliographie
b. Dossier douleur utilisé au centre de cancérologie Gustave
Roussi
c. Compte rendu des l’observations non participatives effectuées
à l’IGR en consultation ambulatoire et en hospitalisation
d. Questionnaire utilisé pour les entretiens semi-directifs
e. Rédaction des entretiens semi-directifs adressés aux infirmiers
et infirmières spécialisés dans l’évaluation de la douleur
exerçant dans un centre anti-douleur de l’AP-HP

I. Introduction
1. Evolution du concept et de la prise en charge de la
douleur
La prise en compte de la douleur du patient est un impératif récent. Ce qui ne signifie pas pour
autant que le développement des pharmacologies antalgiques soit une invention moderne.
Mais fort est de constater que l’invention des antalgiques ou la connaissance des techniques
d’anesthésie ne correspondent pas un usage médical systématique. Comment expliquer ce
décalage ? Comment expliquer, qu’au 19ème siècle, par exemple, l’on préfère s’abstenir de
prescrire des analgésiques ou que l’on refuse une anesthésie lors d’opérations douloureuses
comme les amygdales ou les végétations ? Mais plus récemment encore, comment expliquer
la réprobation vigoureuse de la pratique de la péridurale, en invoquant l’adage sacré du « tu
enfanteras dans la douleur » et qu’à la fin des années 90, la France n’était qu’au 40ème rang
mondial pour l’emploi de la morphine à visée médicale, notamment dans les douleurs
d’origine cancéreuses de stade terminal ?
L’argument d’une évolution de notre tolérance à la douleur au cours de l’histoire n’explique
pas tout. Un savoir médical n’est jamais coupé de son contexte historique, culturel ou
symbolique. Si la prise en compte de la douleur n’a pas constitué, jusqu’à la moitié du 20ème
siècle, une priorité pour les médecins, c’est que la douleur, quelque soit son intensité, est
considérée comme un processus naturel indi
ssociablement chargé d’un certain nombre de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
1
/
128
100%