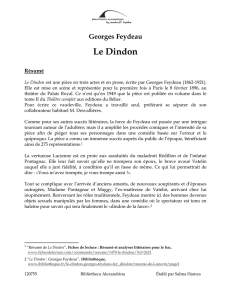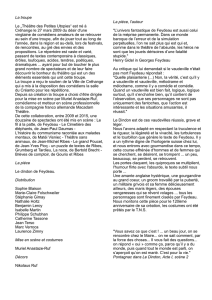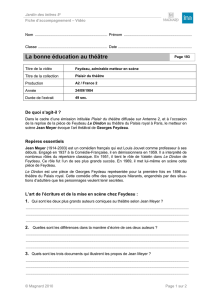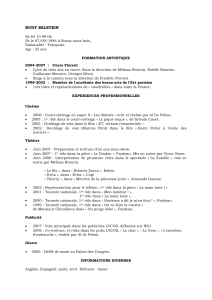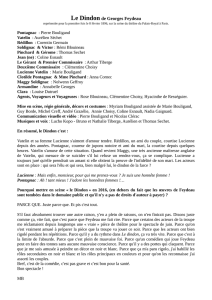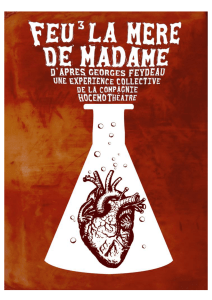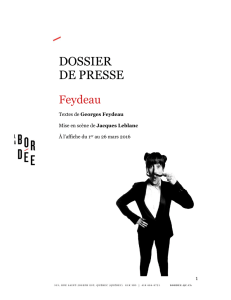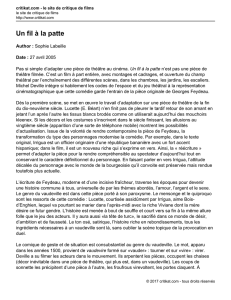l`énigme feydeau - Maison des arts Desjardins Drummondville



Passion
et créativité,
source de l’excellence!
Le Groupe S.M. International Inc. est fier de
soutenir les arts de la scène, reflet de la diversité,
de la vivacité et de l’excellence de notre société.
Actif depuis près de 40 ans, Le Groupe S.M. International Inc. est reconnu
comme une des plus grandes firmes de génie-conseil au Canada. Fondé
sur une culture d’entreprise qui a pour visée de préserver le patrimoine,
conserver la quiétude des communautés et veiller sur l’environnement,
SMi s’emploie à réaliser des projets au diapason des réalités d’aujourd’hui
et de demain.
De la science • aux solutions • aux réalisations
Le Groupe S.M. International Inc.,
partenaire du Théâtre du Nouveau Monde!
groupesm.com

DOUBLE PAGE : Rémy Girard. Photo : Jean-François Gratton
une présentation du Groupe S.M. International inc.
Distribution
Carl béCharD / aDrien bletton / normanD Carrière /
Jean-Pierre ChartranD / Violette ChauVeau /
Guillaume Cyr / alexanDre Daneau / rémy GirarD / roGer la rue /
marie-Pier labreCque / Véronique le FlaGuais /
Catherine le Gresley / Danièle Panneton / sébastien rené /
linDa sorGini / alain ZouVi
l’équiPe De Création
assistance à la mise en scène et régie Geneviève Lagacé décor Jean Bard
costumes Suzanne Harel éclairages Claude Accolas musique originale Yves Morin
accessoires Normand Blais maquillages Jacques-Lee Pelletier
De Georges Feydeau Mise en scène Normand Chouinard
Du 17 janvier au 11 février 2012
58 | 59

ARGUMENT
Pontagnac attaque : après avoir suivi Lucienne Vatelin –qu’il
ne connaît pas – dans la rue, il réussit à s’introduire chez elle
pour lui déclarer son impétueux désir amoureux. Il y a quand
même des limites et Lucienne appelle son mari, qui accourt.
Mais voici que Vatelin, le mari, plutôt que de flanquer
l’importun à la porte, l’accueille cordialement : Pontagnac
est un ami. Et lorsque Vatelin comprend la situation, il traite
l’histoire avec une bienveillance amusée. Pontagnac a beau
raconter que son épouse, malade, est en cure loin de Paris,
il doit néanmoins ravaler son orgueil. Lucienne en profite pour
annoncer qu’elle ne tromperait son mari que si lui, d’abord,
la trompait. Pontagnac, évidemment, enregistre l’information.
Arrive alors un ami des Vatelin, Rédillon, épris de Lucienne –
lui aussi ! – mais depuis longtemps, tant et si bien que
Lucienne lui a promis que si elle trompait son mari, ce serait
avec lui. En attendant cet heureux moment, Rédillon ne cache
pas à Lucienne que la « bête » en lui prend le dessus et qu’il
multiplie les aventures. Surprise : arrive madame Pontagnac,
pétante de santé, qui voulait rencontrer ce fameux Vatelin que
son mari lui disait continuellement visiter. En fait, madame
Pontagnac soupçonnait son mari d’adultère chronique et
voulait en avoir le cœur net. Or se prenant immédiatement
d’amitié pour Lucienne, elle lui confie que si elle obtient la
preuve de l’infidélité de Pontagnac, elle lui rend la pareille,
le dindon
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%