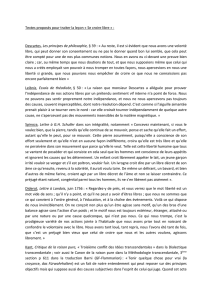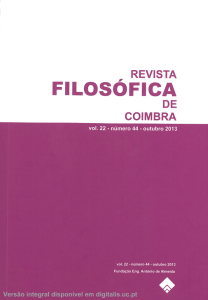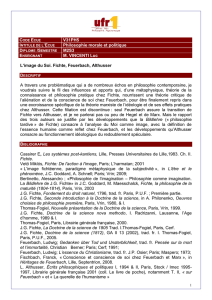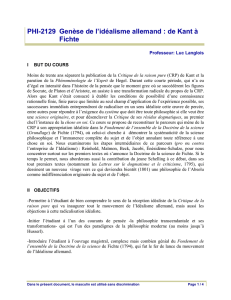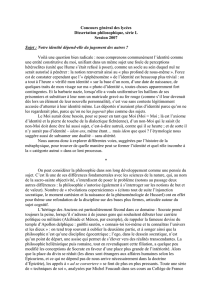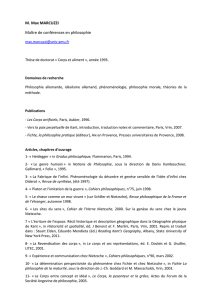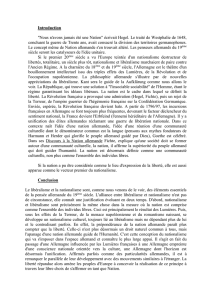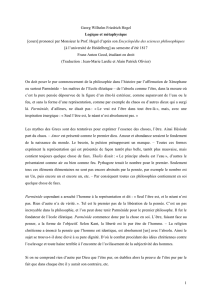Des guerres napoléoniennes à l`éducation. Fichte et

DES GUERRES NAPOLÉONIENNES À
L’ÉDUCATION : ÉDUCATION NATIONALE
(FICHTE) OU ÉDUCATION HUMAINE
(PESTALOZZI) ?
JEAN-MARC LAMARRE1
Les guerres de la Révolution française et de
l’Empire (1792-1815) sont des guerres d’un genre
nouveau qui inaugurent une ère de déchaînement
de la violence. Mais ces guerres ont également
suscité en Europe un appel à l’éducation, comme
en témoignent tout particulièrement les Discours à
la nation allemande (1808) de Fichte après la dé-
faite de la Prusse en 1806 puis, au moment de la
chute de Napoléon et de la réunion du Congrès de
Vienne, À l’innocence, à la gravité et à la noblesse
d’âme de mon époque et de ma patrie (1815) de Pes-
talozzi. Nous voudrions montrer que, dans ce
contexte de guerres et de construction des États -
nations européens, le débat entre Fichte et Pesta-
lozzi permet de nous interroger sur les rapports
entre la guerre, l’éducation et l’État-nation et de
poser le problème de la nature de l’éducation dans
la modernité : éducation nationale ou éducation
humaine ?
Pour Fichte et Pestalozzi, l’individualisme
égoïste est la cause principale du désastre sur le
continent européen et il n’y a de salut possible,
après les ravages des guerres napoléoniennes, que
par l’éducation, une éducation capable de surmon-
ter l’égoïsme. Mais alors que pour le philosophe le
remède est dans l’éducation de la nation alle-
mande (la formation d’un Moi national allemand
et la subordination du Moi individuel au Moi na-
tional), pour le pédagogue il est dans l’éducation
de l’individu à l’humanité à travers le face à face
de la relation entre les personnes. Nous commen-
cerons par nous interroger sur la conception fich-
téenne de l’éducation nationale allemande puis
nous examinerons la conception pestalozzienne de
l’éducation humaine de l’individu. La thèse que
nous voudrions défendre est qu’il n’y a pas à opter
entre éducation nationale et éducation humaine,
mais qu’il faut plutôt sortir de ce dilemme.
1 Maître de conférences honoraire en sciences de l’éducation,
Université de Nantes, CREN
L’ÉDUCATION DE LA NATION ALLEMANDE
(FICHTE)
Les Discours à la nation allemande (Reden an
die deutsche Nation) sont, selon nous, le texte phi-
losophique paradigmatique de la conception mo-
derne de la formation de la nation par l’éducation
plutôt que par le jeu des intérêts économiques ou
par la construction de l’État. Mais ce texte a été
instrumentalisé par le nationalisme allemand2.
Fichte a-t-il une part de responsabilité dans la ca-
tastrophe européenne de la première guerre mon-
diale ? Ses Discours sont-ils une source du panger-
manisme ? Nous montrerons que les Discours à la
nation allemande développent une conception uni-
versaliste, et non pas nationaliste, de la nation al-
lemande, mais qu’ils posent cependant, pour nous
aujourd’hui, deux problèmes, d’une part celui
d’une conception de l’éducation comme produc-
tion de l’homme nouveau, d’autre part celui d’une
conception messianique de la nation allemande et
de sa mission éducative. Les Discours ne sont pas
purement spéculatifs mais philosophico-histo-
riques, et nous commencerons par resituer cette
œuvre dans son contexte.
Le moment 1806
En 18063, la guerre reprend sur le continent
européen avec une violence jamais vue. Le 14 oc-
tobre, Napoléon écrase et met en déroute la presti-
gieuse armée prussienne aux deux batailles d’Iéna
et d’Auerstaedt. Le 27 octobre, il entre dans Ber-
lin. Le pays est alors presqu’entièrement occupé
par les troupes françaises, mais ces années d’humi-
liation sont aussi celles où se prépare le renouveau,
grâce à l’action des réformateurs (Stein, Harden-
berg, W. von Humboldt, Scharnhorst, Gneisenau)
qui modernisent la Prusse dans les limites d’une
modernisation conservatrice dans le cadre de la
monarchie. Le moment 1806 est celui où la
conscience nationale allemande prend forme
contre l’impérialisme français. Ainsi pendant
l’hiver 1807-1808, Fichte prononce chaque di-
manche dans le grand amphithéâtre de l’académie
de Berlin ses Discours à la nation allemande.
2 En 1915, l’État-Major allemand fit imprimer, pour les soldats,
des centaines de milliers d’exemplaires des Discours à la nation
allemande. Cf. Balibar, 132.
3 Après la défaite de l’Autriche et de la Russie à la bataille
d’Austerlitz (2 décembre 1805), le Saint Empire romain
germanique est dissout par Napoléon le 6 août 1806. Rappelons
qu’à cette époque l’Allemagne n’est pas un État, mais une
mosaïque d’États.
Ce texte est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Vous devez citer le nom de
l’auteur – Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France.

2
Schleiermacher n’est pas en reste, qui s’en prend à
la domination française dans ses sermons de
l’église de la Trinité à Berlin. Au moment de la re-
traite de Russie, la Prusse se soulève contre les
Français : ce sont les Befreiungskriege (les guerres
de libération de 1813-1815).
Revenons à l’année 1806 et à la bataille d’Iéna
qui tourne au désastre pour les Prussiens. Le jour
où Napoléon entre triomphalement dans Iéna,
Hegel – admirateur de l’Empereur, comme
Goethe – écrit à son ami Niethammer cette
phrase devenue célèbre : « J’ai vu l’Empereur –
cette âme du monde – sortir de la ville pour aller
en reconnaissance ; c’est effectivement une sensa-
tion merveilleuse de voir un pareil individu qui,
concentré ici sur un point, assis sur un cheval,
s’étend sur le monde et le domine. » (Hegel, 114-
115). Pour d’autres (dont Fichte), Iéna est un
traumatisme et une humiliation4. L’officier prus-
sien Carl von Clausewitz (il combattit à Iéna) est,
lui aussi, profondément humilié. De l’expérience
des guerres contre Napoléon5, il tirera les idées
maîtresses de sa théorie de la guerre6. Clausewitz
comprend que les guerres de la Révolution et de
l’Empire sont des guerres d’un genre nouveau. Il
en dégage trois caractéristiques : la mobilisation
du peuple, la montée aux extrêmes, la supériorité
de la guerre défensive. Les guerres princières du
XVIIIe siècle sont des guerres limitées faites par
des armées de mercenaires ou de soldats de mé-
tiers commandées par une caste aristocratique
d’officiers. Les nouvelles guerres – les guerres mo-
dernes – sont des guerres qui, par la levée en
masse ou la conscription, mobilisent le peuple7. La
Révolution française révèle la puissance de “la na-
tion en armes” : « une force dont personne n’avait
eu l’idée fit son apparition en 1793. La guerre
était soudain devenue l’affaire du peuple et d’un
peuple de trente millions d’habitants qui se consi-
déraient tous comme citoyens de l’État. » (Clause-
witz, 687). Napoléon inaugure la forme absolue de
4 Kleist, dix jours après la défaite prussienne, exprime son désarroi
dans une lettre à sa demi-sœur Ulrike : « Quelle terrible époque !
[…] Ce serait affreux si ce tyran sanguinaire arrivait à fonder son
empire. […] Nous sommes les peuples jugulés par les Romains. »
(Kleist, 314-315).
5 Clausewitz contribue sous les ordres de Scharnhorst à la réforme
qui transforme l’armée prussienne en armée nationale ; il est
chargé en 1810-1811 de l’instruction militaire du Kronprinz ; en
mai 1812, rejetant l’alliance imposée à la Prusse par la France, il
se met au service de la Russie avant de réintégrer l’armée
prussienne pendant les Cent Jours.
6 Commencé en 1818, De la guerre (Vom Kriege) sera publié à titre
posthume en 1832.
7 Les guerres napoléoniennes annoncent l’ère de la mobilisation
totale au XXe siècle.
la guerre (la montée aux extrêmes) : « l’on pour-
rait douter de la réalité de notre notion de son es-
sence absolue si nous n’avions pas vu de nos jours
la guerre réelle dans sa perfection absolue. Après
la courte introduction de la Révolution française,
l’impitoyable Bonaparte l’a vite poussée jusqu’à ce
point. » (Clausewitz, 672). Mais Napoléon échoue
en Espagne et en Russie et Clausewitz y voit la
supériorité de la guerre populaire défensive sur la
guerre éclair.
La guerre – la guerre défensive de libération
nationale – est pour Clausewitz une régénération
de la nation, en l’occurrence de la nation alle-
mande. « La plus belle de toutes les guerres » est
« celle qu’un peuple mène sur son propre territoire
pour sa liberté et son indépendance », écrit-il à
Fichte dans une lettre du 11 janvier 1809 (Fichte,
1981, 201). Selon Carl Schmitt, dans son article
Clausewitz, penseur politique (1967), il se noue
dans le moment 1806 une alliance entre l’ethos mi-
litaire (représenté par Clausewitz) et l’idéalisme
philosophique (représenté par Fichte) : « avec la
petite élite influente des réformateurs prussiens
apparut pour la première fois dans le Berlin des
années 1807-1812 cet exemple hors du commun
d’une alliance nouvelle entre l’armée et la philoso-
phie. » (Schmitt, 97) Fichte fut le philosophe de
l’hostilité envers Napoléon (hostilité au sens de la
désignation de l’hostis, de l’ennemi) et Clausewitz
le théoricien de la guerre contre Napoléon. Fichte
a donné une nouvelle légitimité, une légitimité
moderne, nationale et révolutionnaire, en opposi-
tion avec la vieille légitimité monarchique, à l’hos-
tilité allemande envers Napoléon.
Nous ferons trois remarques au sujet de ce rap-
port possible entre Fichte, penseur de l’éducation
nationale moderne et Clausewitz, penseur de la
guerre moderne. Premièrement, Fichte s’adresse
aux Allemands en patriote plutôt qu’en nationa-
liste et, s’il appelle au sursaut, il n’appelle pas à la
guerre – « la lutte armée est terminée » (Fichte,
1992, 337) - mais à l’éducation. Fichte n’appelle
pas directement à la guerre, toutefois il est le phi-
losophe qui légitime la guerre de libération natio-
nale allemande contre l’impérialisme français.
Deuxièmement, nous pouvons nous interroger sur
les rapports entre la guerre, l’éducation et les
États-nations européens. À travers leur conflit
avec l’impérialisme napoléonien, les peuples euro-
péens se constituent en États-nations et, au même
moment, les projets de systèmes éducatifs se mul-
tiplient et commencent à être mis en œuvre. Ne

3
peut-on pas considérer que la guerre qui mobilise
le peuple contre l’ennemi et l’éducation nationale
qui l’éduque dans un esprit patriotique (une autre
forme de mobilisation par l’État) sont les deux
voies (peut-être indissociables) par lesquelles les
nations modernes se construisent8 ? Troisième-
ment, on peut dire que la tragédie européenne se
noue à ce moment-là, même s’il n’y a pas de conti-
nuité entre les Befreiungskriege et les guerres me-
nées par l’impérialisme allemand. En effet, la
guerre allemande de 1813-1815 est une guerre de
libération nationale contre l’impérialisme napoléo-
nien, mais aussi en un sens une guerre contre le
pays de la Révolution de 1789 et, si la France, avec
Napoléon, est devenue impérialiste, elle reste en-
core la nation porteuse de la modernité antiféo-
dale. « D’où les faiblesses idéologiques particuliè-
rement graves des protagonistes de la résistance
antinapoléonienne, y compris du dernier Fichte ;
des faiblesses qui ont su profiter au chauvinisme et
à l’impérialisme allemands jusqu’à Hitler » (Lo-
surdo, 172).
Le salut par l’éducation de la nation
Venons-en aux Discours à la nation allemande.
Fichte voit dans l’éducation de la nation l’unique
moyen de salut, à condition que cette éducation
soit radicalement transformée9. Or une éducation
nouvelle est désormais possible grâce aux décou-
vertes pédagogiques de Pestalozzi (que Fichte
compte au nombre des Allemands). Fichte
ébauche ce projet d’une éducation nouvelle et na-
tionale – fondée sur la Méthode pestalozzienne –
dans le deuxième Dialogue patriotique (1807) puis
il le développe dans les Discours à la nation alle-
mande, après avoir exposé sa philosophie de l’his-
toire dans des conférences prononcées à Berlin en
1804-1805 et publiées en 1806 sous le titre Le
Caractère de l’époque actuelle. Dans cette œuvre, il
expose de façon déductive le système des cinq
grandes époques de l’histoire humaine, puis, en
s’appuyant sur l’expérience empirique, il situe son
propre temps dans la troisième époque, « l’époque
de l’indifférence absolue à l’égard de toute vérité
et de l’absence de toute attache et de tout fil
8 Fichte dit dans le second Dialogue patriotique qu’« une éducation
telle que Pestalozzi et moi la concevons » permettrait à l’État en
cas de guerre d’avoir « une nation à placer sous les armes »
qu’aucune puissance humaine ne pourrait vaincre. (Fichte, 1981,
138).
9 « En un mot: c’est une complète transformation de ce qu’a été
jusqu’à maintenant l’éducation que je propose comme l’unique
moyen de préserver l’existence de la nation allemande », écrit
Fichte (Fichte, 1992, 65).
conducteur », « l’époque de la liberté vide »
(Fichte, 1990, 28 et 37). C’est cette situation spi-
rituelle d’individualisme égoïste généralisé qui a
rendu possible, selon les Discours à la nation alle-
mande, le despotisme de Napoléon, la faillite des
élites allemandes et l’effondrement de la nation.
Mais la guerre et la défaite ont créé les conditions
d’un changement radical : la détresse du temps
présent, où les Allemands ne sont plus rien, est le
moment historique de la possibilité de passer à
une époque nouvelle. En effet, le Premier discours
fait le constat que l’époque actuelle est désormais
révolue en Allemagne puisque l’égoïsme (ne se
donner pas d’autre but que soi-même), parvenu à
son stade ultime de développement, s’est autodé-
truit en privant d’indépendance l’individu asservi à
une puissance étrangère. Une époque se termine,
une autre peut commencer et, dans ce temps de
transition hésitant entre la fin et le commence-
ment, il appartient aux Allemands, de réfléchir, de
se décider et d’agir, le passage d’une époque à la
suivante ne s’effectuant que par l’action libre des
hommes. C’est dans ce contexte d’un possible
tournant de l’histoire en Allemagne que Fichte
lance son appel au salut par l’éducation.
Sous cette expression d’éducation nouvelle,
Fichte entend « une transformation complète de
l’espèce humaine » (Fichte, 1992, 242), une trans-
formation de l’homme dans ce qu’il a de plus pro-
fond (tarir l’égoïsme pour lui substituer l’amour
désintéressé du bien), c’est-à-dire de rien de
moins que de ce qu’on pourrait appeler une « ré-
volution culturelle » qui passe par la séparation de
la nouvelle génération d’avec la société corrom-
pue10. De cette « révolution » par l’éducation,
Fichte attend la solution du problème politique,
l’édification de l’État rationnel 11. L’éducation an-
térieure (autrement dit celle de la génération de
Fichte) a échoué car elle n’était qu’une éducation
partielle et superficielle, destinée seulement à une
petite minorité. La nouvelle éducation aura pour
tâche, non pas de « former quelque chose en
10 « Cette séparation des enfants constitue même, pour la
réalisation de notre plan, une des conditions absolument
indispensables et dont on ne saurait faire abstraction. […] s’il faut
entreprendre une transformation complète de l’humanité, il est
nécessaire qu’elle soit entièrement arrachée à elle-même et qu’une
rupture tranchante intervienne dans ce qu’était le cours habituel
de sa vie. » (ibid., 251-252).
11 « L’État rationnel ne se laisse pas édifier par des dispositions
artificielles et à partir de n’importe quel matériau disponible, mais
il faut commencer par former et par éduquer la nation en vue de
cet État. Seule la nation qui aura d’abord, par une mise en œuvre
effective, résolu le problème de l’éducation de l’homme parfait
pourra ensuite résoudre celui de l’Etat parfait » (Fichte,
1992,178).

4
l’homme », mais de « former l’homme lui-même »
(ibid., 67-68) ; elle devra être « une véritable édu-
cation nationale allemande » (ibid., 69), générali-
sée sur tout le territoire où s’étend la langue alle-
mande à la totalité des Allemands, sans distinction
de sexe ni de classe. Fichte, comme le montre A.
Renaut dans sa présentation des Discours à la na-
tion allemande, élabore un concept de nation qui se
distingue aussi bien de la conception substantia-
liste et ethniciste de certains romantiques que de
la conception volontariste et contractualiste de
l’Aufklärung : le concept de la nation fondée sur
l’éducabilité (cf. Fichte, 1992, 42). « Donnez une
telle éducation [une éducation nationale] aux ci-
toyens, et vous obtiendrez aussitôt une nation »,
écrit Fichte dans les Dialogues patriotiques (Fichte,
1981, 137). Toutefois cette conception de l’éduca-
tion ne se substitue pas, dans la pensée de Fichte,
à la conception transcendantale de l’éducation
comme intersubjectivité12. L’éducation nouvelle
nationale est plutôt de l’ordre d’une solution pro-
visoire pour sortir de l’éducation traditionnelle et
de l’époque individualiste de l’histoire. Mais elle
est démiurgique et messianique ; le pangerma-
nisme et le nazisme ont pu s’engouffrer dans cette
faille.
La production de l’homme nouveau
L’éducation nationale, telle que Fichte la
conçoit, est démiurgique, tant dans les moyens
employés (le contrôle éducatif total) que dans le
résultat attendu (extirper l’égoïsme et produire un
homme nouveau). « Toute éducation vise à pro-
duire un être stable, sûr et persistant dans ses
choix, qui n’est plus en devenir, mais est et ne peut
être autre que ce qu’il est. » (Fichte, 1992, 75).
Cette volonté de neutralisation du devenir et de
l’altérité pervertit la praxis éducative en une fabri-
cation. L’éducation nouvelle, en effet, ne peut at-
teindre son but qu’en organisant un contrôle total
de l’élève au moyen de la maîtrise de l’espace et du
temps de sorte que « l’élève, dès le début, soit sans
interruption et entièrement soumis à l’influence
de cette éducation, et qu’il soit totalement séparé
du vulgaire et préservé de tout contact avec lui »
(ibid., 88). Fichte préconise la constitution de
12 On peut distinguer deux moments dans la philosophie
fichtéenne de l’éducation. Fichte conçoit d’abord de l’éducation
dans le cadre d’une déduction transcendantale de
l’intersubjectivité comme condition de possibilité de la conscience
de soi, puis il traite de l’éducation en tant qu’éducation nationale
sur un mode philosophico-historique. Cf., sur l’éducation selon
Fichte, Vincenti, voir aussi Lamarre 2002 et 2012a.
communautés éducatives vivant en autarcie et
dans lesquelles l’individu serait subordonné au
tout13. Soustraits par l’État à leurs familles dès leur
plus jeune âge, les enfants seraient ainsi séparés de
la société corrompue et de la génération adulte
difficilement rééducable. « Les élèves qui rece-
vront cette éducation nouvelle, bien qu’à l’écart de
la communauté des adultes, vivront pourtant,
entre eux, en communauté, et ainsi formeront-ils
comme une république isolée, existant pour elle-
même, possédant sa constitution rigoureusement
déterminée, fondée dans la nature des choses, et
intégralement exigée par la raison. » (ibid., 91).
L’obéissance aux lois et la subordination de l’indi-
vidu à la collectivité, permettraient, selon le philo-
sophe, l’éradication de l’individualisme égoïste. Ce
modèle d’éducation relève, selon nous, de ce
qu’Hannah Arendt appelle, dans La crise de l’édu-
cation (1958), « l’illusion provenant du pathos de
la nouveauté » (Arendt, 229) : « vouloir fonder un
nouveau monde avec ceux qui sont nouveaux par
naissance et par nature » (ibid., 227), vouloir « for-
mer une génération nouvelle pour un monde nou-
veau » (ibid., 228). Les Discours à la nation alle-
mande nous révèlent en fin de compte un lien
trouble entre cette éducation et la guerre, entre la
violence destructrice de la guerre moderne et la
violence constructrice de l’éducation nationale dé-
miurgique : comme si la guerre, en détruisant le
vieux monde et le vieil homme, donnait l’occasion
de la création, par l’éducation, de l’homme nou-
veau et du monde nouveau. L’éducation nouvelle
comme production d’un homme nouveau aurait-
elle pour condition la destruction du monde an-
cien ?
L’éducation nationale entre
cosmopolitisme et messianisme
Les Discours à la nation allemande ne marquent
pas une rupture avec les idéaux universalistes de la
Révolution française, ils « sont dirigés tout autant
contre la réaction allemande que contre le despo-
tisme français » (Gueroult, 235) ; ils ne dérivent
pas vers le particularisme et le nationalisme belli-
queux, mais ils sont anti-impérialistes. La concep-
13 Cette subordination de l’individu à la collectivité manifeste,
selon Louis Dumont, « la présence chez l’égalitaire Fichte d’une
forme de pensée proprement hiérarchique dont il serait difficile
de trouver l’équivalent chez les révolutionnaires français. »
(Dumont, 122) Fichte est resté fidèle aux idéaux de la Révolution
française, mais « ce que […] Fichte ajoute à l’universalisme
individualiste de la Révolution, c’est précisément ce sens de la
hiérarchie » (ibid., 127) et de la nation comme « individu
collectif ».

5
tion fichtéenne de la nation et de l’éducation na-
tionale est universaliste : « le progrès qui, désor-
mais, se trouve pour l’éternité à l’ordre du jour est
d’éduquer la nation à l’humanité. » (Fichte,
1992,179). La formation du Moi national n’est
qu’un objectif intermédiaire ; c’est l’autonomie du
sujet moral qui est la finalité de la nouvelle éduca-
tion. Le patriotisme fichtéen a une dimension
cosmopolitique. Dans les Dialogues patriotiques,
Fichte distingue d’une part le vrai patriotisme, le
patriotisme à visée universaliste et d’autre part le
patriotisme égoïste, le patriotisme particulariste et
« ennemi du reste de l’humanité » (Fichte, 1981,
99). S’il rejette « un patriotisme particulariste et
purement prussien » (ibid., 115), il défend en re-
vanche un patriotisme allemand cosmopolitique
parce qu’il n’y a pas, selon lui, de contradiction
entre le vrai patriotisme et le cosmopolitisme et
parce que le patriotisme allemand est le seul à
pouvoir réaliser le cosmopolitisme14. Pour Fichte,
l’éducation de l’homme nouveau ne peut pas être
immédiatement une éducation cosmopolitique,
une éducation humaine ; elle doit d’abord être na-
tionale et se réaliser dans le peuple qui est en
avance sur les autres pour se transmettre ensuite à
l’humanité tout entière. « Le cosmopolitisme est
la volonté dominante que le but de l’existence du
genre humain soit effectivement atteint dans le
genre humain. Le patriotisme est la volonté que ce
but soit atteint avant tout dans la Nation dont
nous sommes nous-mêmes les membres et que ce
résultat s’étende à partir d’elle au genre humain
tout entier.» (Ibid., 94)15. La nation allemande est
en droit ouverte à tous ceux qui croient en la liber-
té. Fichte vide la germanité (Deutschheit) de tout
traditionnalisme et particularisme. Mais que si-
gnifie « allemand » ? La germanité n’est ni biolo-
gique ni territoriale, elle est linguistique ; c’est à
propos de la langue, que Fichte, dans le Quatrième
Discours, éclaire la signification d’ « allemand ».
Pour être efficace, l’éducation doit être un proces-
sus continu et de longue durée ; or, au-delà de la
durée moyenne du processus éducatif dans l’insti-
tution éducative, il y a la longue durée du rapport
14 Napoléon ayant trahi les idéaux de la Révolution française, la
France a failli à sa mission et c’est désormais à l’Allemagne de
reprendre le flambeau.
15 Fichte ajoute toutefois que ses « idées sur le patriotisme
supposaient bien entendu que l’État soit profondément en paix »
(Fichte, 1981, 114) ; et il fait une « distinction entre époque
calme et époque de guerre » (ibid., 115). Dans une situation où la
Prusse est le seul État allemand à défendre son indépendance, il
est juste, selon Fichte, de différer pour l’heure la réalisation des
buts lointains cosmopolitiques et de se contenter de souhaiter la
victoire de la Prusse.
à la langue. La langue allemande a ceci de caracté-
ristique qu’elle est la langue de ceux qui ont
conservé sans interruption leur propre langue,
alors que les autres peuples issus de la même ori-
gine (par exemple les Francs) se sont déplacés et
ont adopté une langue étrangère (néolatine).
Deutsch : « il s’agit simplement du fait que l’on
continue de parler cette langue sans interruption,
étant entendu que les hommes sont bien plutôt
formés par la langue que la langue ne l’est par les
hommes » (Fichte, 1992, 121). L’Allemand est ce-
lui qui est chez-soi, qui est le même ; l’Étranger
(Ausländer) est celui qui, en adoptant une langue
étrangère, est devenu étranger à soi, est tombé
dans l’aliénation. L’exceptionnalité du rapport des
Allemands à leur langue fait du peuple allemand
un peuple exceptionnel voué à une mission éduca-
tive universelle16. La continuité fait de la langue
allemande une langue vivante, philosophique, qui
assure une appréhension profonde des réalités su-
prasensibles et qui, par conséquent, est capable
d’éduquer. « L’enjeu de la réflexion sur les langues
apparaît sous un nouvel éclairage, écrit M. Cré-
pon : c’est de la possibilité même d’une éducation
au sens d’une formation qu’il s’agit. » (Crépon,
262) Plutôt que de nationalisme, on peut parler, à
propos des Discours à la nation allemande, de
« messianisme germanique ». Mais cette idée de la
langue allemande comme langue pure d’influences
étrangères est un mythe. L’identité nationale alle-
mande selon Fichte est une identité-mêmeté, une
identité qui ne se laisse pas altérer par l’étranger.
Depuis la Révolution française, la conscience
nationale ne se limite plus à l’amour de la patrie ;
s’ajoute désormais le sentiment de jouer un rôle ir-
remplaçable sur la scène de l’histoire. Ce fut le cas
avec la Révolution française ; Fichte revendique
pour les Allemands le rôle d’un nouveau peuple
élu. En ce sens, il a contribué à nourrir la rivalité
messianique qui amènera les États européens à
s’entredétruire en 1914.
16 Ces Allemands sont « les Allemands tels qu’ils devraient être
plutôt que les Allemands tels qu’ils sont. Mieux encore : les
Allemands de l’avenir, empiriquement mêlés dans le présent, dans
le transitoire de la crise, avec les Allemands du passé. » (Balibar,
155)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%