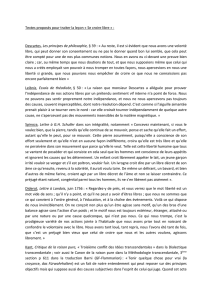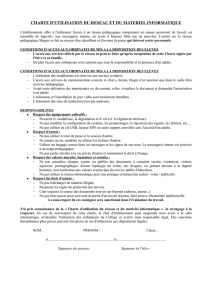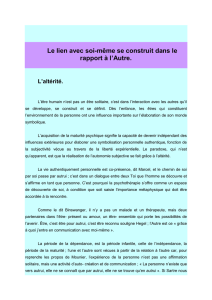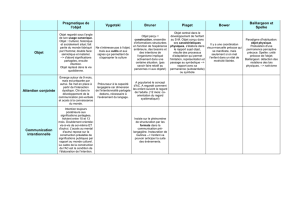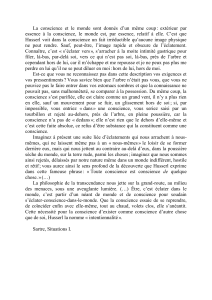Concours général des lycées Dissertation philosophique

Concours général des lycées
Dissertation philosophique, série L
Session 2007
Sujet : Notre identité dépend-elle du jugement des autres ?
Voilà une question bien radicale : nous comprenons communément l’identité comme
une entité constitutive du moi, unifiant dans un même sujet une foule de perceptions
hétéroclites (unité que Hume s’était refusé à poser), comme un socle au sein duquel nul ne
serait autorisé à pénétrer : la notion renverrait ainsi au « plus profond de nous-même ». Force
est de constater cependant que l’« épiphénomène » de l’identité est beaucoup plus trivial : on
a tout à l’heure « vérifié mon identité » sur la base d’un nom, d’une date de naissance, de
quelques traits de mon visage sur ma « photo d’identité », toutes choses apparemment fort
contingentes. Et la barbarie nazie, lorsqu’elle a voulu uniformiser les haillons de ses
prisonniers et substituer à leur nom un matricule gravé au fer rouge (comme s’il leur devenait
dès lors un élément de leur nouvelle personnalité), s’est vue sans conteste légitimement
accusée d’attenter à leur identité même. Les déportés n’auraient plus d’identité parce qu’on ne
les regarderait plus, parce qu’on ne les jugerait plus comme des sujets.
Le Moi aurait donc besoin, pour se poser en tant que Moi (Moi = Moi ; là est l’axiome
d’identité et la pierre de touche de la dialectique fichtéenne), d’un non-Moi qui le saisit (le
non-Moi doit donc être lui aussi sujet, c’est-à-dire autrui), contre qui il se heurte ; et de sorte il
n’y aurait pas d’identité – idem ens, même étant… mais idem que quoi ? l’étymologie nous
suggère aussi de subsumer une dualité – sans altérité.
Nous aurons donc à explorer différentes voies, suggérées par l’histoire de la
métaphysique, pour trouver de quelle manière peut se former l’identité et quel rôle incombe à
la « catégorie autrui » dans ce lent processus.
*
On peut considérer la philosophie dans son long développement comme une pensée du
sujet. C’est là une de ses différences fondamentales avec les sciences de la nature, qui, au nom
de la sacro-sainte objectivité, s’interdisent de poser le problème (notons au passage deux
autres différences : la philosophie s’autorise également à s’interroger sur les notions de but et
de valeur). Nombre de « révolutions coperniciennes » (citons tout de suite l’injonction
socratique, le moment cartésien et la naissance de la phénoménologie de Husserl) ont en effet
pour thème une refondation de la discipline sur des bases plus fermes, articulée autour du
sujet cognitif.
L’héritage des Anciens est particulièrement fécond dans ce domaine : Socrate prend
toujours la peine, lorsqu’il s’adresse à de jeunes gens qui souhaitent débuter leur carrière
politique ou militaire (Alcibiade et Ménon, par exemple), de rappeler la fameuse devise du
temple d’Apollon delphique : gnôthi sautón, « connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers
et les dieux » : on tend trop souvent à oublier la deuxième partie, et à songer ainsi que la
philosophie n’est qu’une discipline égocentrique ; l’ego, dans le dessein socratique, n’est
qu’un point de départ, une assise qui permet de s’élever vers des réalités transcendantes. La
philosophie hellénistique puis romaine, tout en revendiquant cette filiation, a quelque peu
modifié les conceptions de Socrate en faveur d’une place plus grande de l’intériorité. Alors
que la place du divin se réduit (les dieux sont étrangers aux affaires humaines selon les
Épicuriens, et ce qui ne dépend pas de nous arrive nécessairement dans la doctrine
d’Épictète), les appels à « ad se convertere » se font de plus en plus pressants. Toute une série
de « techniques de soi », analysées par Michel Foucault dans ses cours au Collège de France

sur l’Herméneutique du sujet (1981-1982), sont élaborées, qui visent à atteindre la vérité
profonde du Moi, à se rendre hermétique aux assauts du monde extérieur ; la plus illustre
d’entre elles, popularisée par les Stoïciens, est sans doute la præmeditatio malorum,
« anticipation du pire », immunisation aux troubles qui pourraient survenir par la faute
d’autrui.
Nous pouvons donc parler avec Pierre Hadot d’une « citadelle intérieure » du moi
antique. « In te redi », nous dit Augustin, « in interiore homine habitat veritas ». Mais ce re-
fuge montre vite ses limites : en même temps qu’il nous pousse à accepter et à ne pas craindre
la mort, Lucrèce nous défend de s’attarder sur la chair d’un défunt (mais pourquoi nous
émeut-elle donc, si la mort n’est rien pour nous ?), et Horace laisse clairement, en disciple peu
rigoureux de l’épicurisme, transparaître sa peur de la mort (en Odes, I, III, par exemple). Bien
que je me sache identique à autrui, et promis au même sort funeste, il faut cependant m’en
détacher. Le solipsisme est un état insupportable ; les éloges de la solitude que dressent un
Pétrarque dans le De Vita solitaria ou un Chateaubriand ne reflettent pas la juste réalité de
cette condition : tant Pétrarque que Chateaubriand trouvent un exutoire dans la religion,
l’union mystique, ou dans la création artistique. Si penser m’appartient, il y a toujours quelque
chose – « quelque chose qui me dépasse » ajoute Sloterdijk – qui m’étonne (Théétète) et me
fait sortir de mon long sommeil dogmatique.
*
Nous sommes donc conduits à rechercher dans autrui (ou dans Dieu) une échappatoire,
et ainsi nous entrons dans un des trois stades de la dialectique qualitative de Søren
Kierkegaard ; les stades esthétique et éthique, qui sont ceux de l’altérité intramondaine,
renvoient d’ailleurs à deux sortes de jugements.
Dans cette longue et parfois pénible odyssée (qu’on songe aux difficultés de
communication du jeune Jean-Paul Sartre avec les autres enfants de son âge, au jardin du
Luxembourg), d’aucuns se dressent sur notre route, qui deviennent nos amis. L’ami est
proprement celui qui formule un jugement sur moi (généralement positif, pour les besoins de
la communication ; mais certaines relations pathologiques font qu’on s’attache même à ceux
qui nous déprécient) ; nous qualifions notre conversation de « constructive » en tant qu’elle
nous apporte quelque chose, qu’elle nous informe sur ce que nous sommes, qu’elle adopte ce
point de vue objectif dont nous parlions tout à l’heure ; la valeur épistémologique d’un tel
examen apparaît donc supérieure : elle échappe notamment à l’obstacle du refoulement, de la
mauvaise foi. La figure de l’ami, telle qu’elle est présentée par Aristote (Éthique à
Nicomaque, IX-X) et par Cicéron (De Amicitia) peut donc être qualifiée de transcendantale.
Elle doit être intégrée à la « conversion à soi ».
La synthèse est opérée par Husserl, dans ses Méditations cartésiennes, qui concluent
ses recherches tout en introduisant à son œuvre. « Après avoir perdu le monde avec l’épochê
phénoménologique, nous devons le regagner dans l’automéditation transcendantale ». Et ce
sans oublier une de ses propriétés essentielles : le monde de Husserl est intersubjectif. Aussi
nous faut-il, pour le saisir dans sa complexité, dans sa pluralité de faces, poser à côté de l’ego
transcendantal, un alter ego transcendantal. Dès cet instant le monde change de visage et nous
nous transformons avec lui. Étudions cette relation réciproque.
Engagé dans des rapports pratiques avec le monde intersubjectif, je ne saurais ignorer
la présence et la liberté de l’autre. Son visage surgit pour me le rappeler ; il a, chez Lévinas,
« une signification d’emblée éthique » (Éthique et infini). Il est si prégnant que j’en viens à
me rendre, volontairement, spontanément, responsable de lui et même responsable de sa
responsabilité. Il génère une prise de conscience de notre condition commune : Lévinas note
qu’il est très difficile pour un soldat de tuer l’ennemi qu’il a regardé dans les yeux ; d’où notre

lâche refus de regarder nos fautes, de regarder en face la vérité. Le regard de l’autre est mon
juge . Il est condition de l’établissement de la moralité. Sartre est parvenu à des conclusions
similaires de manière parallèle. Lorsque je commets une action réprouvée par les règles de la
morale, je ne ressens pas de culpabilité particulière tant que je ne découvre pas que j’ai été
observé. Alors je rougis et me couvre de honte, non pas de mon action, mais de ce moi qui a
failli, qui a été vu comme immoral. La crainte du regard de l’autre est crainte d’être vu tel que
je suis, non tel que je me montre. De même certaines modes vestimentaires marginales,
certaines attitudes alimentaires pathologiques peuvent s’expliquer par un décalage voulu entre
mon moi « profond » (le terme est sans doute quelque peu abusif) et mon moi « social ».
L’identification d’une de ces deux instances à l’« identité » doit être rejetée pour échapper à
l’équivocité de notre introduction.
Nous nous sommes attachés jusqu’à présent aux relations entre moi et un autre. Mais
nous devons également envisager l’influence de la communauté – « tout organique » au sens
de G. E. Moore (Principia Ethica), c’est-à-dire irréductible à la somme de ses parties – : la
sociologie a ici beaucoup à nous apporter. En marge de notre identité individuelle, il y a
assurément « notre identité », en comprenant le nous comme un collectif : on parle ainsi
d’« identité nationale », de sentiment de classe, de « solidarité féminine »… Un faisceau de
symboles, de référentiels (le drapeau, le quartier, l’histoire, les idoles auxquelles nous nous
« identifions »…) sont autant d’élément qui nous définissent supra-individuellement, mais qui
ne sont pas sans influence au point de vue individuel, sur notre manière même de penser –
contrairement à l’opinion courante, la logique est peut-être ce qui diffère le plus d’un
continent, d’une nation, d’une langue (autre facteur identifiant très fort : on pourra se référer à
la qualification de « bárbaroi » attribuée aux non-hellénophones, à la politique de
l’irrédentisme pendant le Risorgimento, et aux liens qui rapprochent la France des pays de la
Francophonie) à l’autre –. Cette dimension ne peut raisonnablement pas être occultée. Dans sa
morale minimaliste « par provision », Descartes s’imposait d’ailleurs d’être fidèle « aux lois
et aux coutumes » de son pays. Ceux qui refusent de se soumettre à cet ordre établi se voient
par la suite marginalisés, montrés du doigt (et parfois, revendiquent en réaction leur identité
de « rebelles », de contempteurs de la pensée unique).
*
Si le monde extérieur, intersubjectif et social a donc une influence très nette sur la
construction de notre identité, il faut en revanche se garder d’établir une distinction, illégitime
en vertu de la notion même d’iden-tité, entre une identité idiosyncrasique et une autre identité
« ek-statique » qui serait seule en communication avec l’extérieur. Il nous faut étudier les
rapports difficiles de ces deux dimensions, en prenant garde aux écueils vers lesquels chacune
d’elle nous entraîne : l’une au solipsisme et à la surdite aux jugements des autres, l’autre au
déterminisme social et à la dissolution de la personnalité. Ainsi nous parviendrons à
comprendre le rôle précis du non-Moi, et des jugement d’autrui en particulier, dans la
définition de l’identité. Tel est, dans une réflexion plus large sur la liberté, un des problèmes
majeurs qu’étudie Fichte dans sa Doctrine de la science (1795-1813).
Le Moi de Fichte (qui refuse la démarche radicale de Descartes) commence par se
poser lui-même (Tathandlung). « L’acte de poser et ce qui est posé ne font qu’un », ainsi le
Moi établit originellement l’identité Moi = Moi. Il se pose, dans son élan, infini, puisqu’il n’a
encore rien découvert qui s’oppose à lui. C’est seulement une fois confronté au monde
extérieur qui lui résiste, que ce choc (Anstoß) lui révèle sa finitude. Nous avons là, en quelque
sorte, une détermination quantitative de l’identité. Cette définition est donc une dé-finition.
Par analogie avec la démarche de Fichte, nous comprendrons comment les jugements
d’autrui peuvent déterminer qualitativement l’identité. Posons de la même manière l’autre,

comme un Moi (sujet linguistique, qui énonce un jugement) qui n’est pas moi. Son jugement
est pour moi un Anstoß : il limite les jugements que j’avais formulés dans ma « Tathandlung
qualitative » (s’il nous est permis de recourir à une telle expression !) et que j’avais accueillis
avec une confiance aveugle, faute de toute autre instance critique. Je saisis alors ma
connaissance de soi en tant que limitée et j’« accueille » dans une synthèse le jugement de
l’autre. Le Moi posé primitivement, n’a pas disparu au bout de l’expérience ; il a su intégrer et
la présence et le jugement de l’autre dans une dialectique qui conserve l’identité Moi = Moi.
*
La citadelle intérieure des Anciens a donc fait place à une monade ouverte sur les
autres monades. Cette nouvelle conception du sujet est humaniste en ce qu’elle aspire à
reconnaître l’autre, dans sa présence d’abord, dans son alter-égoïté et surtout dans l’efficience
de ses jugements.
Loin d’être le dernier refuge du Moi et le reliquaire d’une vérité intérieure, l’identité
est devenue un repère du Moi et une tension vers la vérité : elle est parvenue à persévérer dans
la durée (sa permanence étant une de ses caractéristiques intrinsèques) et à accueillir le monde
désormais conçu comme habité d’une multitude de sujets en intéraction.
Notre identité n’est donc plus dorénavant une réalité indépendante de ce qui n’est pas
elle, une essence sub specie æterni ; elle est au contraire pérenne en ce qu’elle est capable de
changer avec nous (de faire en sorte toujours que Moi = Moi), d’intégrer nos déterminations
et nos réactions successives.
Ainsi nous pouvons dire avec Dieter Henrich, commentant La Destination de
l’homme, que « nous sommes dépendants d’une réalité que nous sommes néanmoins nous-
mêmes ».
Arthur Laisis
Lycée du Parc – Lyon 6e
3e accessit
1
/
4
100%
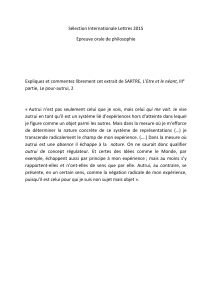
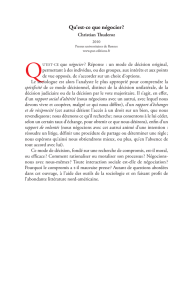
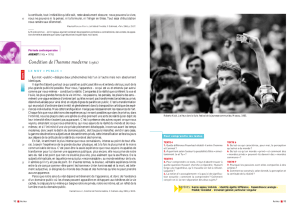
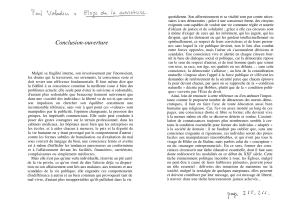
![Inscription de la séquence dans les programmes[1] de l](http://s1.studylibfr.com/store/data/007119161_1-080fc5b72510279fdade3b1afa55e3c0-300x300.png)