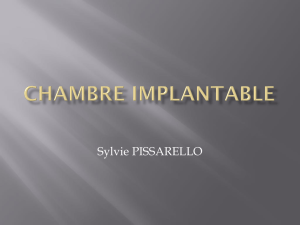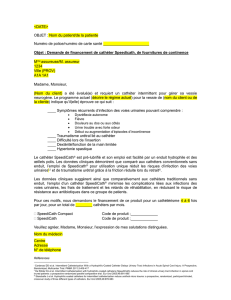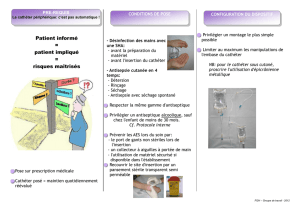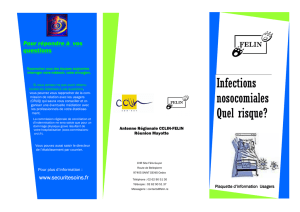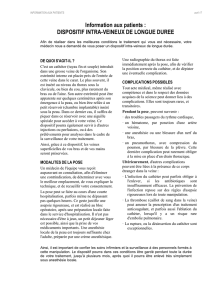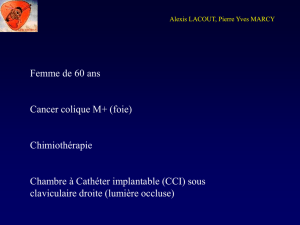Utilisation des cathéters intraveineux en oncologie

45
Correspondances en médecine - n° 1, vol. III - janvier/février/mars 2002
DOSSIER
La prise en charge quotidienne des patients
cancéreux s’est considérablement modifiée au
cours de ces dernières années, en raison du
développement de techniques nouvelles per-
mettant, dans de nombreux cas, de réduire la
durée de l’hospitalisation. Un nombre croissant
de patients, ne dépendant plus d’un lieu unique
de traitement, évoluent désormais dans un
réseau de soins. Ce changement des pratiques,
s’il réduit le temps d’exposition au risque d’in-
fection hospitalière, peut rendre plus com-
plexes la surveillance et la prévention des com-
plications liées à l’utilisation des cathéters
veineux centraux.
M
ISEENPLACE DU CATHÉTER
Les risques de veinite et de nécrose liés à la
toxicité des drogues cytotoxiques sur les parois
veineuses et la longueur des traitements sont
autant d’inconvénients qui font poser l’indica-
tion d’une voie veineuse centrale, celle-ci assu-
rant au patient confort et sécu-
rité. La mise en place se fait
sous anesthésie locale, au
bloc opératoire, par un méde-
cin anesthésiste ou un chirur-
gien entraîné, dans les conditions habituelles
d’asepsie chirurgicale. Un contrôle scopique
est nécessaire pour vérifier le positionnement
correct du cathéter dans la veine. L’abord est
jugulaire interne ou sous-clavier, et l’extrémité
interne du cathéter est positionnée dans la
veine cave supérieure. L’extrémité extérieure
peut être de deux types :
!les chambres implantables ou “port-a-cath”
(PAC) : composées d’une chambre métallique
ou plastique sous-cutanée radio-opaque, pla-
cée en thoracique supérieur et reliée à un
cathéter en silicone ou en polyuréthane. Ce
type de cathéter présente plusieurs avantages :
il ne nécessite pas de pansement, le patient est
libre de ses mouvements et peut se doucher ;
!les cathéters tunnellisés : de type Hickman-
Broviac. L’extrémité externe à la peau com-
prend un système de fixation sous la forme d’un
manchon en Dacron®. Ils sont constitués d’une
gomme siliconée radio-opaque.
P
RÉVENTION PRIMAIRE DES COMPLICATIONS
SUR CATHÉTERS
Entretien et utilisation du cathéter
(1, 2)
Lors de la mise en place d’une perfusion sur site
implantable, des règles d’asepsie doivent être
adoptées : l’infirmière doit se protéger à l’aide
d’un calot, d’un masque et de gants stériles.
L’aiguille de Huber coudée est mise en place
par une piqûre franche à travers la peau préala-
blement désinfectée avec un antiseptique der-
mique. L’ensemble du dispositif est maintenu
grâce à des compresses stériles, des
Stéristrips®puis un pansement.
La chambre implantable doit
être héparinée toutes les 6 à 8
semaines en cas de non-utili-
sation, le cathéter tunnellisé
tous les mois. Une réfection
du pansement est nécessaire tous les 8 à 10
jours en cas de cathéter tunnellisé.
P
RINCIPALES COMPLICATIONS DES VOIES
VEINEUSES CENTRALES
Infections sur cathéter
Facteurs de risque
La prolongation de la survie des malades d’onco-
hématologie se fait souvent au prix d’une dimi-
nution de leurs défenses immunitaires. Cette
immunodépression associe, pour un même
malade et de façon variable dans le temps, diffé-
rents éléments qui sont autant de facteurs de
risque d’infection nosocomiale. Les uns, liés à la
Utilisation des cathéters
intraveineux en oncologie :
prévention et traitement
des complications
"
"
M. Pailler*
* Hôpital Avicenne,
125, route de Stalingrad, 93000 Bobigny.
En cas de non-utilisation, une
chambre implantable doit être hépa-
rinée toutes les 6 à 8 semaines.

nature du cancer, sont fonction du type de la
tumeur et de son stade évolutif. Les autres, liés
aux conséquences des traitements, sont la ran-
çon du développement des chimiothérapies, des
immunosuppresseurs et de l’usage extensif des
cathéters veineux. Dans tous les cas, l’existence
d’une dénutrition sévère constitue un facteur de
risque supplémentaire.
L’existence d’une voie veineuse centrale multi-
plie par 40 à 100 le risque de survenue d’une
bactériémie chez les malades immunocompé-
tents (3), et par 4 seulement chez les apla-
siques (4). Le risque infectieux varie largement
en fonction du terrain, de l’environnement hos-
pitalier, du type de matériel utilisé, du site ana-
tomique d’insertion de la voie veineuse cen-
trale, de sa durée d’implantation, de ses
modalités d’utilisation. La colonisation se fait,
en général, à partir de la flore cutanée du
malade ou, accidentellement, à partir de la flore
des mains du personnel lors des
soins. La colonisation de la por-
tion intravasculaire du cathéter
à partir d’un foyer infectieux à
distance semble peu fréquente
en oncologie. La dernière décen-
nie a vu la régression des infections à bacilles à
Gram négatif sur cathéter et le développement
rapide des staphylocoques à coagulase néga-
tive, qui constituent désormais les
germes les
plus fréquemment isolés (5). Il s’agit
en règle de
Staphylococcus epidermidis, beaucoup plus
rarement de Staphylococcus saprophyticus,
Staphylococcus hominis, Staphylo-coccus hae-
molyticus (6). Une autre dominante est l’ac-
croissement de l’incidence et de la sévérité des
infections sur cathéter à Staphylococ-cus
aureus, Pseudomonas aeruginosa et à Candida
sp, ainsi que l’émergence d’authentiques septi-
cémies à germes opportunistes tels que
Corynebacterium, Bacillus sp (5).
On distingue deux types d’infections sur cathé-
ters (7) :
–infection locale profonde isolée : évoquée
devant des signes inflammatoires (douleur, cha-
leur, rougeur, parfois du pus) en regard de la loge
d’insertion de la chambre implantable ou sur le
trajet sous-cutané du cathéter. Ce type d’infec-
tion impose le retrait immédiat de la voie vei-
neuse centrale et sa mise en culture ainsi que la
mise en route d’une antibiothérapie par voie
générale probabiliste active sur les staphylo-
coques sensibles à la méthicilline, voire adaptée
au germe isolé ;
–infection liée au cathéter : suspectée devant
de la fièvre avec ou sans frissons parfois asso-
ciée à des signes de choc, en particulier dans
les heures qui suivent la manipulation du
cathéter. Le diagnostic sera confirmé par les
hémocultures quantitatives comparatives pré-
levées en même temps sur le site et en péri-
phérie. La suspicion d’une infection liée au
cathéter impose l’ablation de celui-ci devant
quatre situations :
–signes de choc et absence d’autre infection
évidente ;
–infection locale profonde associée ;
–thrombophlébite septique ;
–voie veineuse non ou plus indispensable.
En même temps, une antibiothérapie probabiliste
visant les staphylocoques sensibles à la méthicil-
line sera débutée. En dehors de ces quatre situa-
tions d’urgence, la voie veineuse peut être mainte-
nue en place sous couverture antibiotique, et une
réévaluation de la situation cli-
nique et bactériologique est
nécessaire à la 48eheure.
L’ablation de la voie veineuse
doit être envisagée en l’ab-
sence d’amélioration clinique
ou de persistance d’hémocultures positives à la 48e
heure, en cas d’isolement de Staphylococcus
aureus, de Pseudomonas aeruginosa, d’Acineto-
bacter sp, de Stenotrophomonas sp, de Bacillus sp,
d’une levure, d’une mycobactérie ou d’une infec-
tion polymicrobienne. Elle est recommandée en cas
d’isolement de certains bacilles Gram négatif viru-
lents comme Klebsiella sp, Entero-bacter sp,
Serratia sp.
En présence d’une infection sur cathéter non
compliquée à staphylocoque coagulase négative
ou à bacilles Gram négatif non virulents, l’infec-
tion peut être traitée cathéter en place. Le traite-
ment antibiotique pourra être administré par voie
systémique ou localement selon la méthode du
verrou antibiotique. Cette méthode consiste à
laisser en place 12 heures par jour la lumière
interne du cathéter infecté avec une forte concen-
tration (100 à 1 000 fois la CMI) d’un antibiotique
adapté au germe. Ce verrouillage est renouvelé
tous les jours pendant 10 à 15 jours (8).
L’efficacité de ce traitement sera contrôlée par
des hémocultures sur cathéter aux 3
e
et 4
e
jours
ainsi que 48 heures après la fin des verrous.
Thrombose sur cathéter
(9)
L’apparition d’une douleur et d’un œdème cer-
vical, scapulaire ou de l’avant-bras doit faire
46
Correspondances en médecine - n° 1, vol. III - janvier/février/mars 2002
dossier
Deux types d’infections sur cathéters :
–locale profonde isolée : retrait
immédiat de la voie veineuse cen-
trale ;
– liée au cathéter : ablation à discuter

47
Correspondances en médecine - n° 1, vol. III - janvier/février/mars 2002
DOSSIER
suspecter une thrombose dans les veines du
membre supérieur où est implanté le cathéter.
L’écho-doppler veineux permet d’en faire le dia-
gnostic, de préciser le siège et l’étendue de la
thrombose. Le traitement repose sur la mise en
place d’une anticoagulation à
doses efficaces par héparines
de bas poids moléculaire
(HBPM). L’ablation du cathé-
ter sera envisagée en l’ab-
sence d’amélioration, voire en
cas d’extension de la thrombose sous HBPM ou
devant un cathéter non fonctionnel. En l’ab-
sence de consensus concernant la durée de
l’anticoagulation, on peut considérer que, si le
contrôle de l’écho-doppler montre une perméa-
bilité des veines du membre supérieur après six
semaines de traitement, l’anticoagulant peut
être interrompu.
Obstruction du cathéter
Elle se manifeste par l’absence de reflux sanguin
et par des difficultés à injecter une solution.
L’opacification du cathéter permet de distinguer
plusieurs étiologies : une mauvaise position du
cathéter, un caillot sanguin formé dans la lumière
ou à l’extrémité inférieure du cathéter, ou des
dépôts de fibrine. Les thromboses formées dans
la lumière ou à l’extrémité du cathéter peuvent
être, dans la majorité des cas, traitées par des
injections d’urokinase (2 500 à 5 000 UI/ml)
laissé en place 30 min à 2 heures) (1).
Extravasation
Elle correspond au passage dans les tissus
sous-cutanés des drogues cytotoxiques. Elle
peut être la conséquence d’une malposition de
l’aiguille de Huber, parfois d’une désadaptation
de la chambre et du cathéter ou d’une fissura-
tion de ce dernier. Il s’agit d’un accident grave.
La prise en charge immédiate nécessite l’arrêt
de la perfusion et l’aspiration de 5 à 10 ml dans
le cathéter afin d’éliminer le maximum de pro-
duit. À l’aide d’une aiguille sous-cutanée, on
aspire autour du cathéter le produit infiltré sous
la peau. On délimitera la zone infiltrée au
crayon pour le suivi. Le patient est adressé en
milieu spécialisé, où une ablation du cathéter
sera envisagée. Cette ablation est nécessaire
en cas de nécrose cutanée secondaire complète
d’une greffe de peau. Les cytotoxiques en cause
sont les anthracyclines, la mitoxantrone, les
alcaloïdes de pervenche, l’actinomycine D et les
sels de platine.
C
ONCLUSION
Il est indispensable que, en plus des progrès
thérapeutiques, les patients puissent bénéfi-
cier des progrès techniques leur offrant une
meilleure qualité de vie. La
mise en place des dispositifs
intraveineux centraux parti-
cipe à cette amélioration de la
qualité de vie. Même si le taux
global de complications est
rare (0,23 pour 1 000 jours d’utilisation pour
Bow) (10), le respect des règles d’asepsie et
d’entretien des cathéters ainsi que la connais-
sance des complications liées à leur usage
devraient en permettre une plus large utilisa-
tion en ambulatoire. "
BIBLIOGRAPHIE
1. Alexander HR. Vascular access and specialized tech-
niques of drug delivery. In : Cancer : principles and prac-
tice of oncology. 725-34. Lippincott-Rave Publishers 1997.
2. Strumm S, Mc Dermed J, Korn A, Joseph C. Improved
methods for venous access : the port-a-cath, a totally
implanted catheter system. J Clin Oncol 1986 ; 4 : 596.
3. Maki DG. Infections due to infusion therapy. In :
Bennett JV, Brachman PS. (eds). Hospital infections. 561-
80, Little Brown and Co, Boston 1986.
4. Pizzo PA. Diagnosis and management of infectious
disease problems in the child with malignant disease. In :
Rubin RH, Young LS (eds). Clinical approach to infection
in the compromised host. 439-66, 2nd edition Plenum
Medical, New York, 1988.
5. Nitenberg G, Antoun S, Escudier B, Leclerq B.
Complications liées aux abords vasculaires centraux.
In : Cordonnier C, Nitenberg G (eds). Les infections
graves en onco-hématologie. 53-73, Masson Paris 1990.
6. Herbrecht R, Liu KL, Fuhrer Y. Les infections à staphy-
locoques à coagulase négative en hématologie. Méd Mal
Infect. 103-8 ; Hors série mars : 1990.
7. Standards, options et recommandations pour la pré-
vention, le diagnostic et le traitement des infections liées
aux voies veineuses en cancérologie. In : Standards,
options et recommandations : infection et cancer. 63-116 ;
John Libbey Eurotext Eds, 1999.
8. Messing B, Thuillier F, Alain S, Peitra-Cohen S.
Traitement par verrou local d’antibiotique des infections
bactériennes liées aux cathéters centraux en nutrition
parentérale. Nutr Clin Metabol 1991 ; 5 : 105-12.
9. Morere JF, Boaziz C, Israel L. Implantable infusion
system and thoracic venous thrombosis. Eur J Cancer
Oncol 1987 ; 19 (31) : 1543.
10. Bow EJ, Kilpatrick MG, Clinch J. Totally implantable
venous accessport systems for patients receiving chemo-
therapy for solid tissue malignancies : a randomized
controlled clinical trial examining the safety costs and
impact of quality of life. J Clin Oncol 1999 ; 17 : 1267-73.
Le risque majeur : l’extravasation.
Arrêt immédiat de la perfusion, aspi-
ration, envoi du patient en milieu spé-
cialisé.
1
/
3
100%