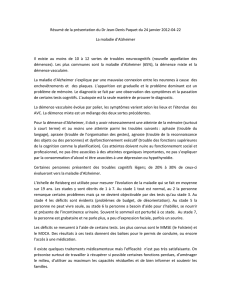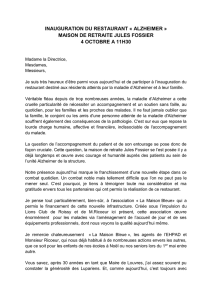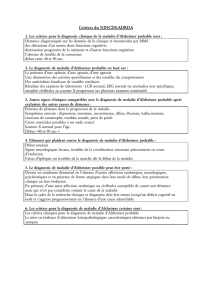Nouveau concept de la maladie d`Alzheimer

thématique à taper
Revue FRancophone des LaboRatoiRes - FévRieR 2012 - 439 bis // 7
54es JOURNÉES DE BIOLOGIE CLINIQUE NECKER – INSTITUT PASTEUR
Nouveau concept de la maladie d’Alzheimer :
apport des biomarqueurs
Bruno Duboisa,*, L…………….Cruz De Souzaa, O…………….Uspenskayaa, F………….Lamarib, M………..Sarazina
a Institut de la mémoire et de maladie d’Alzheimer
Pavillon Lhermitte
Hôpital de la Salpêtrière
b Département de biochimie
Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (AP-HP)
47, bd de l’Hôpital
75651 Paris cedex 13
* Correspondance
Nous avons appris, et nous l’enseignons toujours, que le
diagnostic clinique de la maladie d’Alzheimer ne pouvait
être que « probable » et qu’il ne pouvait être certié que
sur la base d’une preuve histologique, le plus souvent
post-mortem. Cette précaution, sanctuarisée dans les
critères du NINCDS-ADRDA de 1984 [1], est justiée par
la difculté du diagnostic lorsqu’il ne repose que sur des
arguments cliniques. D’ailleurs, la performance des cri-
tères NINCDS-ADRDA est médiocre (avec une spécicité
autour de 70 %) quand elle est confrontée à l’examen
post-mortem [2]. Dans ce contexte, la découverte de
biomarqueurs à la n des années 90 peut être considérée
comme une véritable révolution : les examens complé-
mentaires de neuro-imagerie et de biologie n’étaient plus
indiqués pour éliminer des étiologies alternatives mais
pour apporter des arguments positifs en faveur de la
maladie d’Alzheimer. En effet, pour la première fois dans
une affection neuro-dégénérative, la mesure du volume
d’une structure cible et bien délimitée, en l’occurrence
l’hippocampe, fournit un argument déterminant pour le
diagnostic de MA. Il en est de même des modications du
liquide céphalo-rachidien avec la diminution de la concen-
tration du peptide Aβ 1-42 associée à une augmentation
de celle des protéines tau totales ou phosphorylées ; de
l’hypo-perfusion SPECT ou mieux de l’hypo-métabolisme
TEP des régions pariéto-temporales ; et plus récemment
du marquage in vivo des lésions cérébrales elles-mêmes
par le radioligand amyloïde.
Ces signatures biologiques de la maladie, encore en
cours de validation, peuvent être considérées comme le
reet, accessible du vivant du patient, de la pathologie
Alzheimer sous-jacente. Dans ces conditions, le concept
de la maladie d’Alzheimer change radicalement : l’entité
clinico-pathologique devient une entité clinico-biologique.
Les principes qui prévalaient dans les critères NINCDS-
ADRDA (incertitude d’un diagnostic clinique qui ne peut
être que probable et envisagé qu’au stade tardif de
démence) deviennent obsolètes. Si les biomarqueurs
sont des témoins de la pathologie Alzheimer, le diagnostic
peut donc être établi in vivo grâce à eux. De plus, toute
référence au seuil de démence devient inutile puisque le
biomarqueur identie la maladie quel que soit son stade
de sévérité. Cette approche, radicalement nouvelle, est à
l’origine de nouveaux critères qu’un groupe international
d’experts a proposés en 2007 [3]. Le principe général de
ces critères repose sur le concept d’entité clinico-biolo-
gique. Dans les formes typiques de la maladie, le phéno-
type clinique retenu est celui d’un syndrome amnésique
hippocampique, considéré comme caractéristique de la
maladie d’Alzheimer. Ce syndrome est déni, en situation
de test, par une diminution importante de la performance
en rappel libre (comme dans tout syndrome amnésique)
mais qui ne bénécie que de façon très marginale des
indices sémantiques proposés pour faciliter la récupéra-
tion. Cela témoigne d’un défaut de stockage des infor-
mations, lié à l’atteinte hippocampique qui est le propre
de la maladie d’Alzheimer. Les nouveaux critères recon-
naissent aussi des présentations cliniques atypiques de la
MA [4] : elles sont au nombre de 3. Le phénotype clinique
en est précis : aphasie logopénique, atrophie corticale
postérieure, syndrome dysexécutif prédominant. Dans
tous les cas, que la présentation soit typique ou non,
le diagnostic évoqué sur le phénotype clinique doit être
conrmé par la présence d’un ou plusieurs biomarqueurs.
Mais dans cet algorithme, le syndrome clinique doit res-
ter l’élément central du diagnostic. Le biomarqueur n’est
que conrmatif en rattachant le syndrome clinique à la
pathologie Alzheimer.
Cette nouvelle conception de la maladie d’Alzheimer a eu
plusieurs conséquences. En supprimant toute référence à
la démence pour le diagnostic, elle rend possible l’identi-
cation de la maladie au stade prodromal, prédémentiel.
Il s’agit à l’évidence d’une avancée puisqu’il n’y a pas de
raison de lier le diagnostic d’une maladie à un seuil de
sévérité. Attend-on que le patient parkinsonien soit gra-
bataire pour évoquer le diagnostic de sa maladie ? Cette
approche nouvelle a un effet collatéral non négligeable :
celui de rendre caduque, à terme, le concept de MCI
(mild cognitive impairment ou de troubles cognitifs légers),
antichambre syndromique dans laquelle les patients
atteints de maladie d’Alzheimer au stade prédémentiel
étaient confondus avec les troubles cognitifs d’une autre
nature (dépression, anxiété, lésions vasculaires céré-
brales…). La reconnaissance de la maladie d’Alzheimer au
stade prodromal a dynamisé la recherche thérapeutique en
autorisant l’inclusion de patients à un stade débutant de la
maladie, stade auquel on peut espérer que la charge amy-
loïde ne soit pas trop sévère. Ces critères ont également
ouvert la voie à la reconnaissance d’états précliniques de
© 2012 – Elsevier Masson SAS – Tous droits réservés.

Dossier scientifique
8 // Revue FRancophone des LaboRatoiRes - FévRieR 2012 - 439 bis
la maladie d’Alzheimer, s’inscrivant dans un continuum
selon lequel les lésions cérébrales anticiperaient, pendant
plusieurs années, l’apparition des symptômes. Ainsi, les
biomarqueurs « physiopathologiques » qui témoignent de
la pathologie Alzheimer (modications biologiques dans
le liquide céphalo-rachidien, rétention du ligand amyloïde
dans le cerveau) peuvent être présents chez des sujets
encore indemnes de tout symptôme. Il est probable que
dans l’avenir, les essais thérapeutiques et les enquêtes
épidémiologiques s’adresseront également à ces sujets
« asymptomatiques à risque » de développer une maladie
d’Alzheimer. Mais étant dans l’incapacité de prédire ceux
des patients qui développeront la maladie, nous avons
souhaité réserver le terme de maladie d’Alzheimer à la
seule phase clinique et d’abroger le terme d’Alzheimer
préclinique pour des raisons éthiques évidentes. En 2011,
le National institute of aging et l’Association Alzheimer
américaine ont eux aussi proposé de nouveaux critères
[5] qui nous semblent un peu en retrait par rapport aux
avancées de ceux de 2007 : ils dénissent toujours la mala-
die d’Alzheimer comme une démence ; ils maintiennent
en conséquence le concept de MCI ; ils introduisent
différents niveaux de probabilité diagnostique fondés
sur les différents types de biomarqueurs ; ils proposent
le concept de maladie d’Alzheimer préclinique, ce qui
nous semble éthiquement discutable.
Les critères de 2007 ont donc fortement stimulé la réexion
conceptuelle sur la maladie d’Alzheimer. Ils permettent de
recruter des patients dans des protocoles de recherche
clinique ou d’essais thérapeutiques avec un très haut
niveau de certitude diagnostique. À titre d’exemple,
nous pouvons admettre que le diagnostic de maladie
d’Alzheimer peut être pratiquement certié in vivo chez
un patient qui présenterait un syndrome amnésique
hippocampique avec atrophie de l’hippocampe à l’IRM,
diminution d’Aβ1-42 et augmentation de tau dans le LCR
et un PET amyloïde positif. Il n’est pas question, bien
sûr, de proposer cette approche chez tous les patients.
Elle doit être réservée chez ceux qui sont inclus dans
un protocole de recherche, un essai thérapeutique, un
suivi de cohorte ou pour lesquels un problème diagnos-
tique complexe se pose (sujet jeune, atrophie corticale
postérieure…). Il s’agit de critères de recherche. Leur
applicabilité en pratique courante est encore sujette à
caution pour plusieurs raisons : leur validation est en
cours ; la standardisation des mesures volumiques de
l’hippocampe ou des dosages biologiques du LCR reste
à faire ; l’analyse du marquage amyloïde est délicate
surtout dans les formes débutantes ; les comorbidités
(démence à corps de Lewy ; lésions vasculaires…) doivent
être prises en compte… Quoi qu’il en soit, ces nouveaux
critères de la maladie d’Alzheimer ont accompagné (ou
induit) une nouvelle conception de la maladie et il n’est
pas douteux qu’ils s’imposeront dans les années à venir
dans la pratique courante, tout au moins dans les pays
où les ressources technologiques seront disponibles et
pour les patients chez qui une certitude diagnostique
sera requise.
Déclaration d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflits d’intérêts en relation avec cet article.
Références
[1] McKhann G, Drachman D, Folstein M, Katzman R, Price D, Stadlan
EM. Clinical diagnosis of Alzheimer’s disease: report of the NINCDS-
ADRDA Work Group under the auspices of Department of health
and human services task force on Alzheimer’s disease. Neurology
1984;34:939-44.
[2] Kazee AM, Eskin TA, Lapham LW, Gabriel KR, McDaniel KD, Hamill
RW. Clinicopathologic correlates in Alzheimer disease: assessment of
clinical and pathologic diagnostic criteria. Alzheimer Dis Assoc Disord
1993;7(3): 152-64.
[3] Dubois B, Feldman H, Jacova C, DeKosky ST, Barberger-Gateau P,
Cummings J, et al. Research criteria for the diagnosis of Alzheimer’s
disease: revising the NINCDS-ADRDA criteria. Lancet Neurol
2007;6(8):734-46.
[4] Dubois B, Feldman HH, Jacova C, Cummings JL, Dekosky ST,
Barberger-Gateau P, et al. Revising the denition of Alzheimer’s disease:
a new lexicon. Lancet Neurol 2010;9(11):1118-27. Epub 2010 Oct 9.
[5] Jack CR Jr, Albert MS, Knopman DS, McKhann GM, Sperling
RA, Carrillo MC, et al. Introduction to the recommendations from the
National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on
diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement
2011;7(3):257-62. Epub 2011 Apr 21.
1
/
2
100%