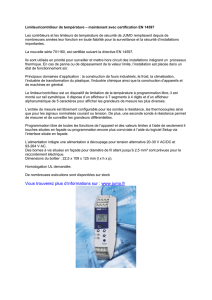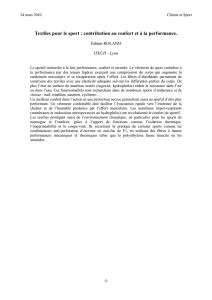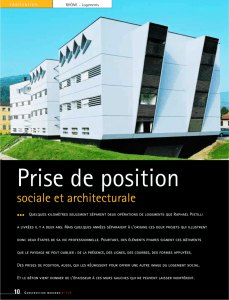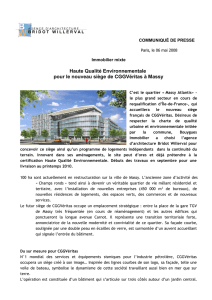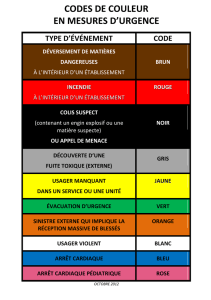L`architecture soft-tech

L’architecture soft-tech
La recherche de la technique non traumatisante
Marine Morain, Lauréna Cazeaux
Architectes, ingénieurs
Arbor&Sens, architecture et conseil, Lyon
en partenariat avec :

L’architecture soft-tech
La recherche de la technique non traumatisante
Marine Morain, Lauréna Cazeaux
Architectes, ingénieurs
Arbor&Sens, architecture et conseil, Lyon
leschantiersleroymerlinsource
Direction de la publication : Marie-Reine Coudsi,
directrice éditoriale et des savoirs de l’habitat, Leroy Merlin
Coordination éditoriale : Denis Bernadet,
chargé de mission, Leroy Merlin Source
Coordination graphique - maquette : Emmanuel Besson
Corrections - relectures : Béatrice Balmelle

SOMMAIRE
LE CONTEXTEACTUEL : NORMER ET PREVOIR L’IMPREVISIBLE .......................................................................... 4
POURQUOI L’APPROCHE SOFT-TECH EST-ELLE SOUHAITABLE? ....................................................................... 6
L’architecture et la technique : amour ou désamour .............................................................................................................................................. 6
De l’utilité d’une troisième voix ................................................................................................................................................................................................10
QU’EST-CE QUE L’ARCHITECTURE SOFT-TECH? ........................................................................................................................ 12
Soft-tech ou la technique non traumatisante .............................................................................................................................................................12
Soft-tech : définition progressive ............................................................................................................................................................................................ 16
COMMENT ALLER VERS UNE ARCHITECTURE SOFT-TECH? .................................................................................. 19
Faisons renaître le Cerbère ............................................................................................................................................................................................................. 19
Efficience contre efficacité ............................................................................................................................................................................................................. 20
La conception participative .......................................................................................................................................................................................................... 21
CONCLUSION .................................................................................................................................................................................................................................... 23
BIBLIOGRAPHIE / WEBOGRAPHIE ..................................................................................................................................................................... 24
OUVRAGES ............................................................................................................................................................................................................................................. 25
ANNEXES ................................................................................................................................................................................................................................................... 25

L’architecture soft-tech / mars 2014 / page 4
«
Le progrès technique est comme une hache qu’on aurait mis dans les mains d’un psychopathe
. »
Albert Einstein
LE CONTEXTEACTUEL : NORMER ET PREVOIR L’IMPREVISIBLE
Le préalable à la réflexion qui nous intéresse, et que nous
développerons plus tard, est issu d’un constat terrain. Depuis
des années, le monde de la conception architecturale ou
technique des bâtiments s’est lancé dans une course effrénée
à la performance : RT2000, puis RT2005, BBC, BBC+, RT2012…
Chaque année de nouvelles exigences réglementaires, nor-
matives ou volontaires, tels de nombreux labels et référen-
tiels locaux, naissent. Les institutions normatives accentuent
la mutation du monde du bâtiment vers une technique en
permanente évolution, solution évidente aux enjeux de la
planète et aux attentes de confort toujours renouvelées…
Ces outils (normes, labellisation, référentiels…) sont utiles
car ils permettent de faire évoluer les pratiques, en quantité
non infinitésimale. Ils initient un changement des règles de
conception ou de construction. Mais peuvent-ils prétendre
initier le changement des règles d’usage ? Sans doute pas,
mais c’est là une hypothèse à vérifier encore…
De fait, quelle est la légitimité sociale de ces normes,
de ces règles, de ces référentiels ? Qui porte la question de
l’usage dans un projet de construction aujourd’hui ? Les
labels garantissent-ils le fait qu’un bâtiment soit construit
avant tout pour accueillir la vie et non pour la performance ?
Quels outils ont été développés pour qualifier le bien vivre
en plus du moins consommer ? Autant de questions sans
réponses claires, car éminemment complexes… Pourtant
la question est déjà bel et bien posée par certains qui sou-
haitent voir émerger la haute qualité d’usage au même
titre que la haute qualité environnementale. Et la méthode
habituelle refait surface : multiplicité de critères, grilles ana-
lytiques, matrice de comparaison… là encore, il faut trouver
une méthode universelle d’évaluation pour pouvoir noter
et comparer, classer, départager… Ainsi nous fabriquons
des grilles pour classer les usagers, sans cesse changeants,
contrairement au bâtiment, figé !
Alors que des modèles physiques permettent de prévoir
de façon très précise le comportement d’un bâtiment face
à une sollicitation donnée, alors que l’ingénierie se perfec-
tionne, que la technique apporte de nouvelles solutions de
régulation, plus fines, plus rapides, plus adaptables… les sol-
licitations du bâtiment, elles, ne s’affinent pas, ne se régulent
pas selon des lois générales : elles dépendent de l’usage réel,
instable, complexe et déterminé par des facteurs multiples.
Or, plus le bâtiment devient performant, plus le rôle de l’usa-
ger devient déterminant, et plus l’occupant risque d’être stig-
matisé en raison de ses mauvaises pratiques.
La question fondamentale, finalement, est d’interroger la
façon de rendre mouvantes les pratiques de conception et
de construction, pour respecter l’imprévisibilité de l’habitant.

L’architecture soft-tech / mars 2014 / page 5
L’architecture est une discipline non spécialiste par
essence qui se préoccupe d’abriter les hommes dans les
meilleures conditions. Ces conditions ne se limitent pas à
offrir un habitat sain et viable. Il s’agit de gérer le rapport de
l’individu au monde qui l’entoure et à la société. L’architec-
ture va alors chercher le géographe pour connaître le terri-
toire, chercher le sociologue pour comprendre les groupes et
chercher le physiologiste pour comprendre les perceptions
du corps humain dans l’espace. L’émergence de l’approche
soft-tech, présentée ici, est issue de la pratique de l’archi-
tecture mêlée à une approche théorique, et c’est le regard
singulier que nous portons sur la construction liée à notre
formation technique d’une part et architecturale d’autre part
qui nous a permis d’aboutir à cette synthèse.
Comprendre le fonctionnement pragmatique des objets
techniques et être à l’écoute des individus et de leur rapport
au monde est la base de notre démarche, volontairement
non spécialiste, définitivement complexe.
Cette contribution à la réflexion que nous avons enga-
gée, découle d’une pratique réelle au sein de l’agence
Arbor&Sens (Lyon). Nous, Marine Morain et Lauréna Cazeaux
(architectes-ingénieurs issues d’une double formation dis-
pensée par l’école nationale supérieure d’architecture de
Lyon et de l’école nationale des travaux publics de l’État),
avons opéré un retour systématique des usages réels des
solutions architecturales et techniques mises en œuvre dans
des projets d’architecture, dite à haute qualité environne-
mentale, produits par l’agence. Ainsi, nous interrogeons la
pertinence des outils méthodologiques et scientifiques que
nous utilisons sous un regard scientifique : vérifier la validité
des hypothèses de modèles de plus en plus complexes utili-
sés dans la conception des bâtiments, même ordinaires.
C’est à partir de ces retours que la question du rôle des
concepteurs (qu’ils soient architectes ou ingénieurs) dans
la relation finale de l’usager au bâtiment s’est posée. Cette
étude prétend rechercher dans quelle mesure les modélisa-
tions et promesses des techniques mises en œuvre collent
à la réalité, en s’appuyant sur des retours terrain d’opéra-
tions livrées depuis plusieurs années et sur des observa-
tions menées dans différents quartiers ayant fait l’objet de
démarches environnementales exemplaires. Les conclusions
menant à des écarts importants, toujours expliqués par
l’usage faute d’être expliqués par les modèles, une tentative
d’identification des raisons majeures de discordance sera
avancée.
Leroy Merlin Source appuie ce travail depuis plus de
deux ans et a permis de mobiliser différents acteurs autour
de cette question de la relation entre technique et habitant.
Ainsi, nos remerciements vont naturellement à nos interlo-
cuteurs, patients et exigeants : Marie-Reine Coudsi, Denis
Bernadet et Pascal Dreyer ; ainsi qu’aux intervenants exté-
rieurs qui se sont impliqués dans ce travail, en particulier le
docteur Gaëtan Brisepierre.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%