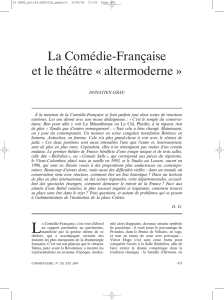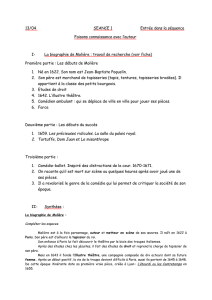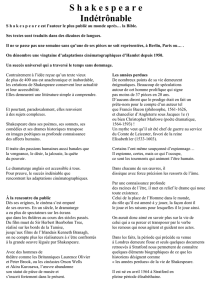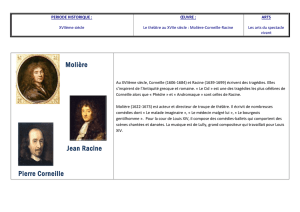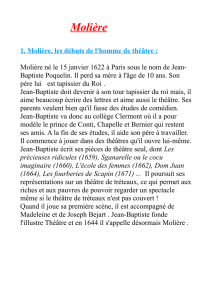Introduction (Fichier pdf, 383 Ko)

Introduction
À la rencontre de
Shakespeare chez Molière
Au Cœur de l’Histoire
La Comédie-Française : un nom tout d’abord, qui se rattache à une nation et
à son histoire. Depuis sa création sous le règne de Louis XIV, bien des batailles
et des tempêtes ont mis son existence en péril. Son fonctionnement très particu-
lier a fait l’objet de réformes et, au l de ces trois derniers siècles, la maison dite
« deMolière » ou encore « La Ruche », bourdonnante de créativité, est devenue
forte de son identité, de ses convictions et de ses conquêtes 1 .
Que l’on assiste aujourd’hui à une représentation place Colette, dans la salle
Richelieu agencée à l’italienne avec dorures et velours damassé, ou dans l’espace
intime du studio-théâtre sous le carrousel du Louvres ou en n dans la salle du
Vieux-Colombier créée en 1913 de facture sobre, on mesure la qualité d’une
programmation foisonnante et la prévalence d’un système institutionnel rigoureux 2 .
Ce qui se passe dans les coulisses du français in ue tant sur la programmation
que sur la réception des spectacles par un public sélectif, avisé et exigeant. Les
administrateurs, les sociétaires et les pensionnaires, de même que les metteurs en
• 1 – On nomme la troupe des Comédiens-Français « la Ruche » car au sein de cette institution,
tout est constamment en e ervescence. Se reporter au cahier d’illustrations pour en voir la symbo-
lisation frappée sur un médaillon.
• 2 – Sur l’Histoire de la Comédie-Française, des ouvrages majeurs ont été publiés et ont
nourri cette introduction, en particulier : Patrick D , La Comédie-Française , Paris, PUF,
coll. « Que sais-je? », n° 2736, 1993 ; Béatrix D , La Comédie-Française , Paris, Hachette, 1960 et
Marie-Agnès J , La Comédie-Française sous l’Occupation , Paris, Tallandier, 1998. En n, la revue
Les Nouveaux Cahiers de la Comédie-Française, dont le numéro hors-série « La Comédie-Française »,
La Comédie-française-L’avant-scène éâtre, Paris, novembre 2009, o re un condensé extrême-
ment clair des principaux rouages de la maison au l de quatre chapitres rédigés par les membres
actifs qui ont côtoyé de près les tréteaux de l’Institution.
« Shakespeare dans la maison de Molière », Estelle Rivier
ISBN 978-2-7535-2066-0 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr

Shakespeare dans la maison de Molière- 16 -
scène, ont un devoir d’allégeance et d’excellence en cette maison de renommée
devenue internationale au gré des politiques internes. Il n’est pas aisé d’en détenir
les secrets, mais on pressent combien les enjeux y sont disputés avec fougue et
ténacité, comme si un autre spectacle avait lieu à l’arrière-scène. Dans ce que nous
voyons aujourd’hui mis en scène se déploie en ligrane une histoire tricentenaire
qu’il nous importe de parcourir en quelques dates a n d’en mesurer les répercus-
sions sur les esthétiques et les choix de notre époque.
En quelques dates 3
En 1643, l’Illustre théâtre est créé par Jean-Baptiste Poquelin. Les représenta-
tions ont lieu dans la salle du Jeu de Paume , rue Mazarine et quai des Célestins.
Une première représentation devant le roi est donnée en 1658 car l’Illustre théâtre
est devenu « Troupe de Monsieur », le frère de Louis XIV. La Farce du docteur
amoureux est présentée dans la salle des gardes du Louvres. Se succèdent alors
des représentations dans divers lieux tels que l’immense salle du Petit-Bourbon ou
celle du Palais Royal . En 1665, il s’agit désormais de la « Troupe du Roi » ou les
« Comédiens du Roy » qui reçoit une pension annuelle ainsi que des grati cations
pour les représentations données dans les résidences royales 4 . Après la mort de
Molière en 1673, deux troupes, celle des « Tragédiens » du Marais et celle des
« Comédiens » du Palais-Royal fusionnent et s’installent à l’hôtel Guénégaud, rue
Mazarine. On parle alors des Comédiens-Français par opposition aux Comédiens
Italiens qui ont davantage recours aux machines théâtrales. Cultures identitaires
et techniques s’entretiennent de pair. Mais la troupe doit son épaisseur nale
à l’intégration de la troupe de l’hôtel de Bourgogne en 1680. En e et, cette
troupe rivale, dirigée par La orillière dans l’hôtel de Bourgogne, se joint à celle
menée par Charles Varlet de La Grange, dans l’hôtel Guénégaud 5 . Une troupe
unique naît par signature du roi le 21 octobre. Elle compte vingt-sept comédiens
et comédiennes dont Armande Béjart, Paul Poisson ou Jeanne Beauval 6 . Phèdre
et LesCarrossesd’Orléans ouvrent la programmation de la Comédie-Française
• 3 – Voir à ce sujet « La Comédie-Française en quelques dates », « La Comédie-Française »,
Les Nouveaux Cahiers de la Comédie-Française , op. cit. , p. 4-9 et Jean V -B , Naissance et
vie de la Comédie-Française. Histoire anecdotique et critique du éâtre-Français , Paris, Floury, 1945.
• 4 – Claude L , Nicole B , Les Comédiens de Molière . 1920-2002 , Paris, Séguier,
2002, élabore une analyse précise sur cette période. L’ouvrage ancien d’Émile C ,
Les Comédiens du Roy de la Troupe Française pendant les deux derniers siècles , Paris, Champion, 1879,
en o re une approche critique di érente.
• 5 – Cf. « Le dévouement acharné de La Grange », Pierre Notte , « La Troupe », Les Nouveaux
Cahiers de la Comédie-Française , op. cit. , p. 12-13.
• 6 – Cf. Agathe S , « La Société des Comédiens-Français », ibid. , p. 17-27.
« Shakespeare dans la maison de Molière », Estelle Rivier
ISBN 978-2-7535-2066-0 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr

Introduction - 17 -
le 26 août 1680. Malgré la tutelle royale qui vaut aux comédiens réunis par
un acte d’association une protection et un droit d’exclusivité, la rivalité entre
troupes demeure. Les Comédiens Italiens et le éâtre de la Foire sont leurs prin-
cipaux concurrents. Les représentations sont soumises à la censure, aux caprices
de la Couronne, mais aussi aux divers déménagements. Entre 1680 et 1799, la
troupe connaît pas moins de cinq lieux de représentation : l’hôtel Guénégaud
précédemment cité, la salle des Fossés-Saint-Germain-des-Prés (1689), la salle
des Machines (Palais des Tuileries, 1770), le Théâtre-français du Faubourg
Saint-Germain (1782, l’actuel Théâtre de l’Odéon), enfin, la salle Richelieu
dans la rue du même nom après les tumultes de la Révolution (1799) 7 . Ces
bouleversements externes sont représentatifs des tumultes internes à la troupe
du Français où le répertoire est assujetti aux aléas de la politique du pouvoir en
place et des rivalités nationales. Ainsi, par exemple, pour faire face à la concur-
rence des Comédiens Italiens ou du éâtre de la Foire, le Français qui jusque-là
avait inscrit l’alternance entre comédies et tragédies dans ses principes, valorise
l’œuvre de Voltaire au début du
e siècle et bouleverse les formes classiques
d’interprétation 8. AdrienneLecouvreur ainsi que Mademoiselle Duclos optent
pour un jeu naturel dans des costumes simplifiés. Le répertoire accueille de
nouveaux auteurs tels que Jean-BaptisteGresset, PhilippeNéricault Destouches,
Barthélémy-Christophe Fagan et Pierre-ClaudeNivelle delaChaussée qui instaure
la comédie « larmoyante ». Marivaux entre également à la Comédie-Française en
1720, mais rencontre un échec. Il faudra attendre 1793 avec Les Fausses Con dences
et 1802 avec Le Jeu de l’amour et du hasard avant qu’il n’occupe à son tour une
place de choix. Quant au Mariage de Figaro de Beaumarchais, monté en 1784, il
fait l’objet d’enthousiasme autant que de censure alors que la Révolution gronde.
D’un siècle à l’autre
À la fin du
e siècle, de par son statut de troupe royale, la Comédie-
Française occupe une position plus que délicate. En son sein s’opposent les
monarchistes aux « rouges » que sont François-Joseph Talma, Jean-Henri Dugazon
ou Grandménil, Madame Vestris (épouse de Dugazon) ou Mesdemoiselles de
• 7 – Le Journal de la Comédie-Française 1787-1799 , Noëlle G , Jacqueline R ,
La Comédie aux trois couleurs , préface d’Antoine V , Antony, SIDES/EMPREINTES, 1989,
retrace avec minutie les événements clefs vécus par la troupe du Français en cette période houleuse
les comédiens et leur institution étaient presque autant menacés que la tête des aristocrates.
• 8 – Au sujet de « l’alternance » à la Comédie-Française, voir Noëlle G , « Que joue-t-on
ce soir. L’alternance à la Comédie-Française », Les Nouveaux Cahiers de la Comédie-Française ,
op. cit. , p. 70-85.
« Shakespeare dans la maison de Molière », Estelle Rivier
ISBN 978-2-7535-2066-0 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr

Shakespeare dans la maison de Molière- 18 -
Garcins et Simon. Ces derniers s’installent rue de Richelieu dans le éâtre de la
République tandis que le Français devient éâtre de la Nation. Talma s’illustre
ainsi tant par ses qualités d’acteur que par sa verve républicaine 9. Notons en
passant que le 26 novembre 1792 paraît à l’a che du éâtre de la République,
Othello , LeMore de Venise , adaptation par Jean-François Ducis de la pièce du
même nom d’un certain William Shakespeare 10. Un premier pont est jeté entre la
France et sa voisine insulaire.
Du fait du scindement de son e ectif, l’ancienne Comédie-Française voit ses
privilèges s’e ondrer. Signi cativement, elle perd sa pension royale. Par ordre du
comité de salut public, la salle à L’Odéon est fermée en 1793, mais les comédiens
sont sauvés in extremis de la guillotine grâce à Charles Hippolyte de Labussière,
lui-même acteur 11. Le 30 mai 1799, les dissensions s’estompent et les deux camps
se réunissent pour reprendre leurs représentations au éâtre-Français, rue de
Richelieu. Talma y gure et instaure un renouveau des conventions de la repré-
sentation. De fait, la révolution a lieu aussi bien hors que dans les murs de cette
troupe désormais cinquantenaire 12.
Sous l’Empire, alors que Napoléon Bonaparte ne cache pas son admiration
pour Talma (il avait noué des liens avec lui pendant la Révolution), le Français
privilégie les œuvres classiques pour lesquelles il rencontre un vif succès grâce au
jeu de Fleury, Dugazon, Dazincourt, M
lle George ou M
lle Duschenois, d’autres
grands noms à l’a che des spectacles. Il faut aussi admettre que la concurrence
est moins vive puisque des vingt-quatre théâtres que comptait la capitale au
e siècle, il n’en reste plus que huit. Le répertoire est néanmoins revu, en
particulier après la mort de Talma en 1826 qui secoue l’Institution. La société
dont les statuts avaient été rétablis et revus dans un nouvel acte de 1804 est sur le
point d’être dissoute, mais le baron Taylor, nommé commissaire royal, fait entrer
de nouveaux auteurs au répertoire : c’est l’avènement du drame romantique 13. Les
• 9 – Plusieurs ouvrages ont été consacrés à ce comédien talentueux : celui, très récent, de Bruno
V , Talma , l’acteur favori de Napoléon I er , Paris, Éditions Pygmalion/Gérard Watelet, 2001 et
celui de Madeleine et Francis A , Talma ou l’histoire au éâtre , Paris, Éditions de Fallois,
2007, qui sert précisément le détail de notre encart en conclusion du présent chapitre.
• 10 – Au sujet de Jean-François Ducis, voir John G , Shakespeare for the Age of Reason ,
Earlier Stage Adaptations of Jean-François Ducis, 1769-1792 , Voltaire Foundation, 1992, ainsi que
PaulA , Jean-François D , Lettres de Jean-François Ducis , Kessinger Publishing, 2009.
• 11 – Employé au bureau de police des Tuileries en 1794, il est horri é par les exécutions en masse
dont il est mis au fait par les dossiers qui parviennent sous ses yeux. Il décide alors de jeter certains
d’entre eux où gurent les noms d’artistes du éâtre-Français.
• 12 – Noëlle G , Jacqueline R , « Agitation dans les rues, sur la salle et sur la
scène », op. cit. , p. 179-188.
• 13 – À ce sujet, on se reportera notamment à l’ouvrage d’Albert S , La Comédie-Française
depuis l’époque romantique. 1825-1984 , Paris, Fischbacher, 1895.
« Shakespeare dans la maison de Molière », Estelle Rivier
ISBN 978-2-7535-2066-0 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr

Introduction - 19 -
pièces d’Alexandre Dumas, de Victor Hugo, d’Alfred de Vigny déclenchent les
passions jusque dans les années trente. Avec Le More de Venise présenté en 1829,
nouvelle adaptation d’ Othello , le nom d’un auteur français, celui de Vigny cette
fois-ci, est de nouveau associé à celui de Shakespeare. Mais cette œuvre provoque
des débats, à l’instar du Hernani de Victor Hugo présentée l’année suivante et la
tragédie classique reprend le dessus.
Jusqu’alors, selon le décret de Moscou datant de 1812, la gestion de la troupe
était entre les mains d’un directeur (Jousslin de la Salle, Vedel ; Buloz, Lockroy,
Bazenerye se succèdent de 1833 à 1849). Au cœur du siècle, la fonction d’ad-
ministrateur voit le jour : Arsène Houssaye est nommé en 1850, le baron Empis
en 1856 et les Comédiens-Français deviennent troupe ordinaire de l’Empereur.
Le premier rétablit le nom de Comédie-Française et favorise un répertoire contem-
porain. La comédienne Rachel y connaît ses jours de gloire ; son successeur préfère
le théâtre classique 14. Quant à Édouard ierry qui administrera la maison pendant
douze ans (1859-1871), il met la comédie bourgeoise à l’honneur. Dès lors, les
administrateurs marquent de leur empreinte le style de la grande Institution et si
des acteurs de renommée, parmi lesquels Sarah Bernhard ou Mounet-Sully, o rent
des interprétations retentissantes, ce sont aussi les décors somptueux qui attirent
le public de plus en plus dense.
Jules Clarétie est l’administrateur qui passera le flambeau du
e au
e siècle puisqu’il occupera le poste de 1885 à 1913, une longévité louable
quand on connaît les di cultés nancières et matérielles que doit a ronter la
Comédie-Française en cette période : crise boulangiste, incendie du théâtre en
1900 (pérégrinations des comédiens entre l’Opéra, l’Odéon entre autres lieux de
représentation) ; implications politiques de Clarétie (Républicain et Dreyfusard) ;
grève des comédiens quand revient à l’administrateur l’exclusivité des choix de
pièces (le comité de lecture disparaît entre 1901 et 1910 ; Sarah Bernhard quitte
l’Institution). La mission de son successeur, Albert Carré, est donc de restau-
rer discipline et esprit de solidarité au sein de la maison. La Première Guerre
mondiale ne facilite pas cette perspective. Émile Fabre est nommé administrateur
général pendant la durée de la guerre quand Carré sert à son grade de lieutenant
colonel ; certains comédiens tels que Reynal ou Fontaine meurent sur le Front 15.
Le répertoire prend des accents patriotiques et se met en scène au éâtre des
Armées. Après la guerre, Fabre poursuit son mandat quand Carré rejoint l’Opéra
Comique où il o ciait auparavant. Des réformes voient le jour : les sociétaires
sont davantage impliqués dans les choix artistiques et leurs statuts évoluent (il n’y
• 14 – Sylvie C a consacré une étude complète sur la comédienne : Rachel , Paris,
Calmann-Lévy, 1989.
• 15 – Émile M , La Comédie-Française pendant la Guerre. 1914-1917 , Paris, Figuière, 1929.
« Shakespeare dans la maison de Molière », Estelle Rivier
ISBN 978-2-7535-2066-0 Presses universitaires de Rennes, 2012, www.pur-editions.fr
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%