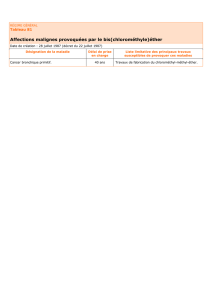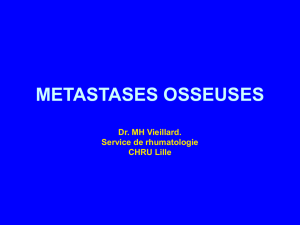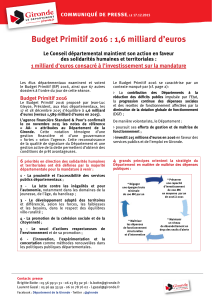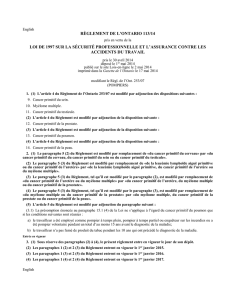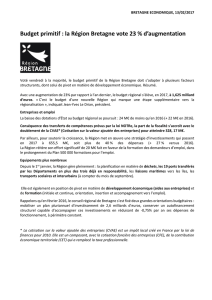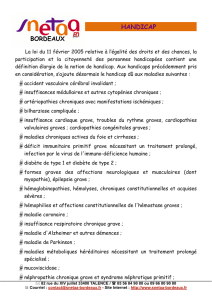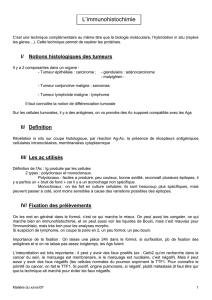Position de thèse - Université Paris

UNIVERSITE PARIS IV-SORBONNE
ÉCOLE DOCTORALE III
Doctorat nouveau régime
Littératures française et comparée
Alice LARRIVAUD-DE WOLF
LE PRIMITIF
DANS L’ŒUVRE DE MAUPASSANT
Thèse dirigée par Mariane BURY,
soutenue le 10 décembre 2011
Jury :
Jean-Louis CABANÈS
Michel CROUZET
Jean SALEM
Daniel SANGSUE

Maupassant, loin de partager les centres d’intérêt de ses contemporains sur l’avenir de
l’humanité, affirme sa singularité en explorant la part primitive de l’homme. Contre son siècle
qu’il perçoit comme décadent, il se sent bien plus héritier du
XVIII
e
où, dit-il dans l’une de ces
chroniques, « toutes les fines qualités de notre race ont atteint leur complet
épanouissement
1
». Comment comprendre chez un homme du
XIX
e
siècle cet intérêt pour les
origines ? Quelle forme inédite prend-il sous la plume de Maupassant ? Que recouvre ici
l’idée de primitif ? Pour enrichir au maximum le champ de notre recherche, nous avons relevé
et analysé les sens variés, tantôt péjoratifs tantôt mélioratifs, du terme primitif ; tous découlent
du sens étymologique : « premier en date, premier-né
2
», ce sens étant originellement utilisé
surtout dans les domaines de la religion et de la grammaire.
Pour bien montrer l’originalité de la notion de primitif chez Maupassant, nous ferons
d’abord le point sur ce que le
XIX
e
siècle entend par primitif. Si l’humanité est en progrès,
alors est primitif celui « qui a la simplicité des premiers âges
3
», qui est archaïque, « pas
encore sorti de l’abrutissement supposé de l’état de nature
4
», « sommaire, rudimentaire
5
»,
« rustre, grossier
6
», « fruste
7
», « prélogique
8
», voire « bête
9
». Parce qu’il est enraciné dans
la nature, est primitif ce qu’on peut apparenter à un animal, à une créature soumise à ses
seules pulsions. Est primitif celui dont l’instinct, la sexualité, la violence sont impossibles à
canaliser. Est primitif, donc, celui qui, comparé au civilisé, témoigne d’un « retard
10
» certain,
« d’une antériorité sauvage
11
». Nourries par la confusion faite au
XIX
e
siècle entre barbare,
sauvage et primitif, toutes ces définitions font état du jugement de valeur inhérent à la
conception de l’humanité en marche, selon laquelle il faut s’arracher au stade du primitif. La
représentation que l’anthropologie naissante donne du criminel en est tout à fait
représentative. Lisons à cet égard une des conclusions qu’Arthur Bordier, disciple de Broca et
fondateur en 1894 de la Société d’ethnologie et d’anthropologie de Grenoble, tire de son
« Étude anthropologique sur une série de crânes d’assassins » :
1
« Les Femmes » (Chro., J. I, p. 303).
2
Dictionnaire historique de la langue française, dir. A. Rey, Le Robert, vol. III, 2006, p. 2940.
3
Larousse, Grand Dictionnaire universel du
XIX
e
siècle, Paris, Admin. du grand Dictionnaire universel, 1875,
vol. XIII, p. 150. Voir aussi le Grand Dictionnaire de la philosophie (dir. Michel Blay, Larousse-CNRS éd.,
2003, p. 850) et l’article « Primitif » du Littré, Dictionnaire de la langue française (1873-1874, vol. III, p. 1318).
4
Grand Dictionnaire de la philosophie, dir. Michel Blay, Larousse-CNRS éd., 2003, p. 850.
5
Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française, dir. Alain Rey, rééd. 1993, p. 1632.
6
Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du
XIX
e
et du
XX
e
siècle (1789-1960), Gallimard-Centre
nationale de la recherche scientifique, vol. XIII, Gallimard, 1988, p. 1195. Voir CNRTL.
7
CNRTL.
8
Grand Dictionnaire de la philosophie, dir. Michel Blay, Larousse-CNRS éd., 2003, p. 850.
9
« Relatif aux groupes humains contemporains qui […] n’ont pas subi l’influence des sociétés dites évoluées »,
d’où « bête » chez Gide (CNRTL).
10
Bernard Mouralis, Montaigne et le mythe du bon Sauvage de l’Antiquité à Rousseau, Bordas, 1989, p. 116.
11
Grand Dictionnaire de la philosophie, dir. Michel Blay, Larousse-CNRS éd., 2003, p. 850.

les assassins que j’ai étudiés sont nés avec des caractères qui étaient propres aux
races préhistoriques, caractères qui ont disparu chez les races actuelles, et qui
reviennent chez eux, par une sorte d’atavisme. Le criminel ainsi compris est un
anachronisme, un sauvage en pays civilisé, une sorte de monstre, et quelque chose
de comparable à un animal, qui, né de parents depuis longtemps domestiqués,
apprivoisés, habitués au travail, apparaîtrait brusquement avec la sauvagerie
indomptable de ses premiers ancêtres […]. Le criminel actuel est venu trop tard
12
.
Bordier recourt au syllogisme pour faire sa démonstration : l’homme moderne s’est
arraché à sa nature première ; or le criminel est une bête sauvage ; donc le criminel
n’appartient pas à la modernité. « Venu trop tard », le criminel est « un anachronisme » : il ne
s’inscrit pas dans le schéma préconçu de la vision progressiste de l’humanité. Par le
vocabulaire qu’il emploie (« un anachronisme, un sauvage […], une sorte de monstre »),
l’anthropologue dénie au criminel son humanité. Littéralement innommable (« quelque chose
de »), ce mutant à rebours est l’irruption de la nature dans la culture, c’est-à-dire du chaos
dans l’ordre. Il incarne les pulsions et les tendances antisociales que la société apprend à
l’individu à canaliser, à sublimer ou bien à refouler ; loin de répondre à la définition de
l’homme moderne (grâce auquel la barbarie est révolue), il présente au contraire les
caractéristiques (« des superstitions, des faiblesses, des puérilités
13
») propres aux « premiers
ancêtres », aux « races préhistoriques ». On le voit, l’image du primitif, dont le criminel est
une des facettes, est totalement négative à l’époque du positivisme.
À la suite de Flaubert notamment, Maupassant s’inscrit en faux contre cette vision très
restrictive. L’approche est toute différente pour qui considère le primitif non pas comme le
signe d’une antériorité mais au contraire comme celui d’une permanence. Alors que Flaubert,
qui a selon les Goncourt la nostalgie d’« une grosse barbarie
14
», oppose au bourgeois policé
et modéré de son temps le Barbare violent et radical, Maupassant, lui, réunit les deux temps,
les amalgame. Dans l’« animal humain
15
» coexistent l’homme d’aujourd’hui et l’homme de
jadis, le contemporain de la révolution industrielle et des inventions scientifiques et
techniques et le survivant d’un passé très ancien, profondément archaïque. C’est à ce regard –
original et paradoxal en pleine époque du scientisme qui fait l’apologie de la maîtrise par
12
Revue anthropologique, vol. II, 1879, p. 278.
13
Revue anthropologique, vol. II, 1879, p. 278.
14
Journal, 14 déc. 1862, cité par Sandrine Berthelot, « Du barbare antique au primitif moderne : l’inscription
paradoxale du sublime dans l’œuvre de Flaubert de Salammbô à Un cœur simple », Discours sur le primitif,
textes réunis par Fiona McIntosh-Varjabédian, Édition du Conseil Scientifique de l’Université Charles-de-Gaulle
de Lille-3, 2002, p. 84.
15
L’expression est utilisée par Maupassant dans « Le Masque » (II, 1134) et dans Notre cœur (R, p. 1179) et
dans « Danger public » (Chro., J. III, p. 385).

l’homme de la nature – que nous invite Maupassant, dont l’œuvre toute entière travaille à
montrer le primitif dans et non contre le civilisé.
Cette conception d’un être mêlé nous amène à poser la problématique suivante : En
quoi le primitif est-il une figure objectivement dérangeante, voire subversive ? En posant la
question ainsi, on est forcé de constater les limites de notre langue puisqu’en français, la
subversion consiste en une entreprise lucide, délibérée de démolition des valeurs ; or, ce dont
nous parlons ici, c’est d’une conduite qui fait fi de la morale, qui n’en tient aucun compte,
exactement comme si elle n’existait pas. De même qu’on ne confond pas amoral et immoral,
de même on devrait pouvoir distinguer le comportement sciemment subversif, proche du
cynisme destructeur, du comportement objectivement subversif, mais dénué de toute intention
antimorale.
Nous répondons à cette problématique générale en trois temps. La première partie
consiste à se demander en quoi le rapport à la nature et au corps est primitif. Pour traiter cette
partie, nous avons pris primitif au sens de qui relève « de l’état de nature
16
», voire qui est
« en harmonie
17
» avec la nature, mais aussi au sens dépréciatif de « prélogique
18
»,
« rudimentaire
19
», « grossier
20
», voire « bête
21
», et enfin au sens de « qui s’exprime
spontanément, sans contrôle, ni calcul
22
». Dans notre corpus, loin d’être appréhendés sous
l’angle de la morale, le rapport à la nature, le corps, la sexualité, l’animalité, la bêtise sont
traités comme des composantes irréductibles de l’humain, les « impulsions instinctives » étant
des « déterminants communs à toute la race
23
». Bien sûr, cette conception du primitif ne
gomme pas l’ambivalence propre au mot, riche sur le plan sémantique. Partant, chez
Maupassant, qui se garde bien de magnifier le primitif, la nature et le corps sont
fondamentalement ambivalents : quand celle-ci est simultanément refuge et piège, celui-ci est
tantôt source de plaisir tantôt lieu d’asservissement ; de même, la sexualité est à la fois
abdication devant les instincts et pulsion de vie, l’animalité est soit bestialité soit spontanéité,
la pulsion est signe de vitalité ou de brutalité, la bêtise est tour à tour simplicité et stupidité.
16
Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française, dir. Alain Rey, rééd. 1993, p. 1632.
17
Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du
XIX
e
et du
XX
e
siècle (1789-1960), Gallimard-
Centre nationale de la recherche scientifique, vol. XIII, Gallimard, 1988, p. 1195.
18
Grand Dictionnaire de la philosophie, dir. Michel Blay, Larousse-CNRS éd., 2003, p. 850.
19
Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française, dir. Alain Rey, rééd. 1993, p. 1632.
20
Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du
XIX
e
et du
XX
e
siècle (1789-1960), Gallimard-
Centre nationale de la recherche scientifique, vol. XIII, Gallimard, 1988, p. 1195. Voir aussi Centre National de
Ressources Textuelles et Lexicales.
21
« Relatif aux groupes humains contemporains qui […] n’ont pas subi l’influence des sociétés dites évoluées »,
d’où « bête » chez Gide (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales).
22
« Article Primitif » sur le site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.
23
« Chronique » (Chro., J. II, p. 98).

Le primitif est donc chez Maupassant une figure complexe, tantôt valorisée tantôt dépréciée.
Mais il est surtout, par son inscription dans la matière, un miroir troublant (que le positivisme
aimerait croire déformant) tendu à l’homme du
XIX
e
siècle qui, se prétendant un être de pure
raison, cherche à renier ses origines.
Ainsi définie, la notion de primitif fonctionne, si l’on peut dire, comme un pavé dans
la mare, qui éclabousse la notion de civilisation et ses valeurs. C’est une autre facette du
terme qui est convoquée dans cette deuxième partie, le primitif désignant ici une figure
« originaire, donc pur[e] et non encore corrompu[e]
24
», vierge de « l’influence des sociétés
dites évoluées
25
», « préservé[e] de la décadence qui affecte les peuples civilisés
26
». À la
lumière du primitif, donc, Maupassant brosse un portrait cinglant de l’homme de son temps :
sous prétexte de vouloir s’émanciper de sa primitivité, il s’est façonné un environnement
artificiel que la culture et les institutions, avec leurs lois trompeuses et contre nature, ont
parachevé de pervertir. En dénonçant la société comme dénaturée, Maupassant en vient à
mettre en question la définition de la civilisation. Dans une telle conception de l’humanité,
l’opposition traditionnelle entre arriéré et évolué, archaïque et avancé, sauvage et civilisé ne
tient plus. En cette fin de siècle où la politique colonialiste est à son apogée et où le discours
dominant est raciste, la pensée de l’auteur, d’abord supérieure envers le colonisé tout en étant
critique sur les conditions de la conquête, va s’enrichir, grâce au contact avec l’Autre, et
progressivement favoriser un regard neuf et ouvert.
La troisième et dernière partie de notre travail s’intitule « Le primitif ou l’ébranlement
des repères ». L’acception anthropologique de la notion de primitif éclaire, a posteriori, d’une
lumière singulière cet aspect de l’œuvre de Maupassant. En effet, dans ses recherches sur la
mentalité primitive, Lévy-Bruhl a mis en évidence ce qu’il a appelé le principe de
« participation
27
». Alternative au sacro-saint principe de non-contradiction qui fonde la
pensée occidentale, le principe de participation « permet de loger dans la même réalité le
visible et l’invisible, ce que nous appelons la nature et le surnaturel, en un mot ce monde et
l’autre
28
». Commentant cette citation, Georges Gusdorf situe le primitif « au cœur d’une
réalité à peu près indissociable » où sont abolies les distinctions « entre le passé, le futur et le
présent, entre le proche et le lointain, entre le sacré et le profane, entre le positif et le
24
Grand Dictionnaire de la philosophie, dir. Michel Blay, Larousse-CNRS éd., 2003, p. 850.
25
Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du
XIX
e
et du
XX
e
siècle (1789-1960), Gallimard-
Centre nationale de la recherche scientifique, vol. XIII, Gallimard, 1988, p. 1193.
26
Bernard Mouralis, Montaigne et le mythe du bon Sauvage de l’Antiquité à Rousseau, Bordas, 1989, p. 116.
27
Lévy-Bruhl, Les Fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Paris, Alcan, 1910, p. 79.
28
Lévy-Brühl, La Mentalité primitive, Alcan, 1922, p. 226.
 6
6
1
/
6
100%