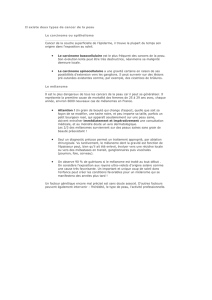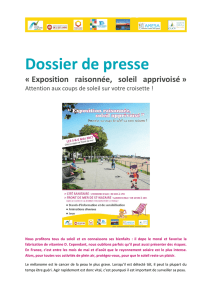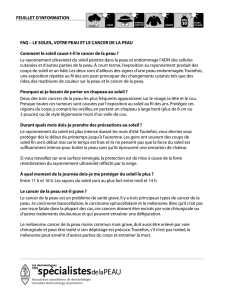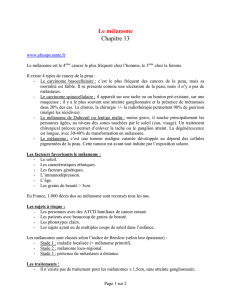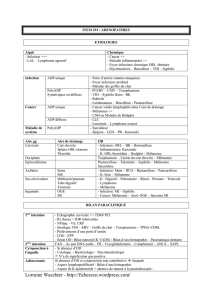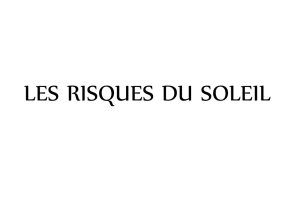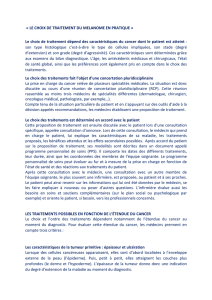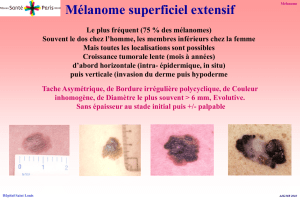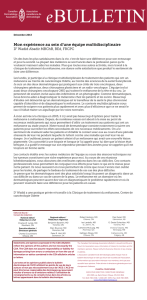Mélanome de la peau - Réseau Mélanome Ouest

Mélanome de la peau
Le mélanome est le plus rare des cancers de la peau
(2 % des cancers cutanés découverts) mais c'est aussi le
plus grave, notamment en cas de diagnostic tardif, en
raison de sa capacité à métastaser [1].
Le principal facteur de risque du mélanome et plus
largement de tous les cancers de la peau est l'exposition
au rayonnement solaire, particulièrement néfaste dans
l'enfance où la peau est très sensible aux ultraviolets. Le
risque de mélanome est aussi fonction du phototype des
individus, plus important chez les personnes à peau claire,
cheveux blonds ou roux et taches de rousseur, qui ne
bronzent pas ou peu. La présence de nombreux grains de
beauté (nævus) constitue également un facteur de risque
[1-3]. Enfin, 10 % des mélanomes surviennent dans un
contexte familial, défini comme la survenue d'au moins trois
mélanomes sur deux générations [4, 5].
La modification des habitudes d’exposition solaire, en lien
avec l'impératif social du bronzage et un mode de vie orienté
vers les activités de plein air, est à l'origine de l'augmenta-
tion importante de l'incidence du mélanome et de la mortali-
té liée à ce cancer depuis les années 50 dans tous les pays
d'Europe, l'Australie et les Etats-Unis [4, 6].
Les taux d’incidence standardisés ont fortement augmenté
en France entre 1980 et 2000, au rythme annuel moyen de
+ 5,9 % chez l’homme et de + 4,3 % chez la femme. Entre
2000 et 2005, la progression a été beaucoup plus modé-
rée, et les projections 2010 montrent une stabilisation des
taux d’incidence pour les deux sexes [7, 8]. Le nombre de
nouveaux cas est estimé à 3 300 chez l’homme et 4 100
chez la femme en 2005 [6].
La mortalité par mélanome a progressé de façon plus
modérée que l’incidence entre 1980 et 2000, avec des
hausses annuelles moyennes de 2,9 % chez l’homme et
de 2,2 % chez la femme. Depuis 2000, la mortalité a eu
tendance à se stabiliser [7, 8]. En 2007, le mélanome de la
peau a été à l’origine du décès de 866 hommes et 666
femmes en France métropolitaine [9].
Le mélanome de la peau est fréquent en Europe, même
si les niveaux d’incidence et de mortalité restent très en
dessous de ceux observés en Australie ou en Nouvelle-
Zélande. Au sein de l'Union européenne, la France
présente des taux d'incidence intermédiaires, entre les
taux élevés du nord de l'Europe et ceux, plus faibles, de
l'Europe du sud [10]. La situation est analogue pour la
mortalité par mélanome, avec toutefois un gradient nord-
sud moins marqué et une position légèrement plus favora-
ble de la France [10].
Le taux de survie relative à 5 ans en France est parmi
les meilleurs d'Europe pour les hommes (83 %), et en
position médiane pour les femmes (88 %) [11].
En France comme dans la plupart des pays, les mélano-
mes sont donc plus fréquents chez la femme, mais leur mor-
talité est plus élevée chez l’homme, ce qui peut s'expliquer
pour partie par un dépistage plus tardif chez ces derniers.
Les personnes atteintes d’un mélanome sont le plus
souvent admises en affection de longue durée (ALD). Entre
2005 et 2007, plus de 6 000 admissions en ALD ont ainsi
été prononcées en moyenne chaque année par les trois
principaux régimes d’assurance maladie [12]. Pour le seul
régime général, le nombre total de personnes en ALD pour
mélanome est estimé à 43 000 en 2009. Ce nombre a
pratiquement doublé en cinq ans [13].
Le traitement du mélanome est dominé par la chirurgie.
A un stade très précoce, il est guéri dans la quasi-totalité
des cas par simple exérèse chirurgicale. En revanche,
l'efficacité des traitements au stade métastatique (radio-
thérapie, chimiothérapie, immunothérapie) demeure
encore très faible avec un espoir dans les années à venir
avec la vaccination et la thérapie cellulaire [14].
Le mélanome a constitué le diagnostic principal de plus
de 12 000 séjours hospitaliers en court séjour en 2007
(hors séances de chimiothérapie et radiothérapie) [15].
L'intérêt du diagnostic précoce de cette tumeur est re-
connu. Son efficacité repose sur la complémentarité de
l'action du patient, du médecin généraliste (ou du méde-
cin du travail), du dermatologue et de l'anatomopatholo-
giste. Les campagnes d'incitation au diagnostic précoce,
développées en France comme dans de nombreux pays,
ont un impact positif mais limité dans le temps. Leur effi-
cacité en termes de diminution de la mortalité n'est pas
encore certaine [2].
La prévention primaire du mélanome reste donc essen-
tielle, par la réduction de l'exposition aux ultraviolets
solaires, au moyen de photo-protecteurs efficaces contre
les UVA et les UVB (indice SPF minimum de 40) mais aussi
aux ultra-violets artificiels, dont les dangers sont mainte-
nant clairement établis. La stabilisation de l'incidence du
mélanome et la baisse de la mortalité en Australie et dans
les pays du nord de l'Europe, probablement en lien avec
les actions massives d'information et de dépistage,
confortent ces orientations [2].
Dans les prochaines décennies, la raréfaction de l'ozone
atmosphérique est susceptible d'augmenter les doses
d'ultraviolets solaires et donc le risque de mélanome [7].
P a y s d e l a L o i r e
La santé observée en Pays de la Loire - 2011 Observatoire régional de la santé
25 mars 2011
Contexte
Le nombre de nouveaux cas de mélanome de la peau diagnostiqués en 2005 dans la population régionale est estimé
à 460 (fig. 1). Environ 370 personnes ont été admises en affection de longue durée (ALD) pour cette pathologie en
moyenne chaque année sur la période 2005-2007 par les trois principaux régimes d'assurance maladie [12].
Ce cancer a causé 99 décès de Ligériens en moyenne chaque année entre 2003 et 2007 (fig. 4).
54 % des admissions en ALD et 39 % des décès concernent des moins de 65 ans (fig.4). L'incidence est, comme au
plan national, plus élevée chez les femmes que chez les hommes, mais la situation est inverse pour la mortalité (fig. 5).
L'évolution de l'incidence régionale est analogue à celle observée en France. Après une période de forte croissance
jusqu'en 2000, les taux standardisés régionaux d'incidence se stabilisent chez les femmes, et leur progression est dé-
sormais plus modérée chez les hommes (fig. 5).
En 2005, l'incidence du mélanome de la peau en Pays de la Loire est supérieure d'environ 10 % à la moyenne natio-
nale chez les hommes comme chez les femmes. Chez ces dernières, l'écart région/France, qui atteignait 18 % au début
des année 80 s'est réduit, alors que chez les hommes, il tend plutôt à augmenter (fig. 5).
La mortalité régionale connait des fluctuations importantes, en raison de la faiblesse des effectifs concernés, mais
globalement, elle est aussi supérieure à la moyenne nationale (fig. 5).

Mélanome de la peau
Décès par mélanome de la peau
Pays de la Loire (moyenne 2003-2007)
5
4
Rang régional
La santé observée en Pays de la Loire - 2011 Observatoire régional de la santé 25 mars 2011
3
Pour la période 2003-2007, l'incidence et la
mortalité du mélanome de la peau en Pays de la
Loire sont statistiquement supérieures à la
moyenne nationale chez les hommes comme
chez les femmes [16].
1
Incidence estimée du mélanome de la peau
Pays de la Loire (1980-2005)
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
6
8
10
12
14
Sources : Francim, InVS, Inserm CépiDc, Insee
Standardisation sur la population européenne
Taux standardisés de mortalité : données lissées sur 3 ans
Taux standardisés d'incidence : données annuelles (disponibles tous les 5 ans)
Unité : pour 100 000
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
0
1
2
3
MORTALITE
INCIDENCE
Incidence Pays de la Loire Mortalité Pays de la Loire
Incidence France entière Mortalité France métrop.
Evolution des taux standardisés d'incidence estimée et
de mortalité par mélanome de la peau
Pays de la Loire, France (1990-2007)
Définitions et méthode
MM
MMéé
ééllll aa
aann
nnoo
oomm
mmee
ee dd
ddee
ee llll aa
aa pp
ppee
eeaa
aauu
uu : code CIM9 : 172 ; code CIM10 :
C43.
AA
AAffffffffee
eecc
ccttttiiii oo
oonn
nn dd
ddee
ee llll oo
oonn
nngg
gguu
uuee
ee dd
dduu
uurrrréé
ééee
ee (ALD) : voir fiche "Affections
de longue durée".
EE
EEss
ssttttiiii mm
mmaa
aattttiiii oo
oonn
nnss
ss FF
FFrrrraa
aann
nncc
cciiii mm
mm : voir fiche "Ensemble des
cancers".
IIII nn
nncc
cciiii dd
ddee
eenn
nncc
ccee
ee : nombre de nouveaux cas apparus sur une
période donnée.
TT
TTaa
aauu
uuxx
xx ss
ssttttaa
aann
nndd
ddaa
aarrrrdd
ddiiii ss
sséé
éé ee
eetttt iiii nn
nndd
ddiiii cc
ccee
ee cc
ccoo
oomm
mmpp
ppaa
aarrrraa
aattttiiii ffff : voir indicateurs.
Source : Francim, InVS
1. standardisation sur la population européenne
Unité : pour 100 000
< 15 15-2425-3435-4445-5455-6465-7475-8485 et
+
0
5
10
15
20
25
30
35
Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee
Unité : pour 100 000
Hommes Femmes âge
Taux d'admission en affection de longue
durée pour mélanome de la peau
selon l'âge et le sexe
Pays de la Loire (moyenne 2005-2007)
Nombre de
nouveaux cas
Taux d'incidence
standardisé 1
1980 Hommes
42 Femmes
89 Hommes
3,4 Femmes
5,9
1985
1990
1995
2000
68
99 125
162
139
175 201
233
5,2
7,0 7,8
9,6
9,0
10,4 11,2
12,2
2005 204 253 11,1 12,3
Source : Inserm CépiDc
* différence avec la France métropolitaine significative au seuil de 5 %
Moins de 65 ans 65 ans et plus Total
ICM
Hommes
Femmes 24
15 29
32 52
47 115 *
121 *
Ensemble
39 60 99 118 *
Taux standardisés d'incidence estimée du mélanome de la peau pour 100 000
8,9 - 10,1
10,2 - 11,7
11,8 - 13,1
13,2 - 15.3
France entière : 11,3
Taux standardisés d'incidence estimée
du mélanome de la peau (2005)
2
Source : Francim, InVS
Standardisation sur la population européenne
Hommes
Femmes
France entière : 10,1
Taux standardisés d'incidence estimée du mélanome de la peau pour 100 000
8,6 - 9,2
9,3 - 10,0
10,1 - 11,1
11,2 - 12,9

Mélanome de la peau
La santé observée en Pays de la Loire - 2011 Observatoire régional de la santé
[1] Halna JM. (1999). Les mélanomes. In
Incidence du
cancer en France : estimations régionales 1985-1995
.
Réseau français des Registres de cancer. pp. 37-39.
[2] HAS. (2006). Stratégie de diagnostic précoce du
mélanome. Recommandations en santé publique.
Rapport d'évaluation. 108 p.
[3] INCa. (2010). Rayonnements ultraviolets et risques
de cancer. 8 p. (Fiches repère).
[4] Grange F. (1995). Mélanomes primitifs multiples et
mélanome familial. Evaluation du risque et mesures de
dépistage. Comment apprécier le risque de développer
un deuxième mélanome chez le malade ? Dans sa
famille ? Faut-il mettre en oeuvre des méthodes
pour les dépister ?
Annales de dermatologie et de
vénéréologie
. vol. 122, n° 5. pp. 365-371.
[5] Green MH. (1999). The genetics of hereditary
melanoma and nevi. 1998 update. Cancer. vol. 86,
n° 8. pp. 1644-1657.
[6] Avril MF, Brodin M, Dreno B
et al
. (2002). Soleil et
peaux : bénéfices, risques et prévention. Ed. Masson.
296 p.
[7] Remontet L, Buemi A, Velten M, Jougla E, Estève J.
(2003). Evolution de l'incidence et de la mortalité par
cancer en France de 1978 à 2000. 217 p.
[8] INCa, InVS, Hospices civils de Lyon. (2010). Projection
de l'incidence et de la mortalité par cancer en France en
2010. Rapport technique. 75 p.
[9] Inserm CépiDc. Bases nationales des causes
médicales de décès 1980-2007, exploitation ORS Pays
de la Loire.
[10] Ferlay J, Shin HR, Bray F
et al
. (2010). Globocan 2008,
Cancer incidence and mortality worldwide. International
agency for research on cancer. [page internet].
http://globocan.iarc.fr
[11] Istituto Superiore di Sanità. Site d'Eurocare. Survival
of cancer patients in Europe.
www.eurocare.it
[12] Cnamts, CCMSA, RSI. Bases nationales des
admissions en affections de longue durée (ALD)
2005-2007, exploitation ORS Pays de la Loire.
[13] Cnamts. Site de l'Assurance maladie.
www.ameli.fr
[14] HAS, INCa. (2008). Guide affection longue durée :
tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique
ou hématopïétique. Mélanome cutané. 32 p.
[15] ATIH. Bases nationales PMSI MCO 2000-2007,
exploitation Drees.
[16] Fnors. Score-Santé. Site commun d'observation
régionale en santé.
www.scoresante.org
S o u r c e s
25 mars 2011
Merci pour leur contribution à
Philippe Pépin, ORS Ile-de-France
R e m e r c i e m e n t s
Etude cofinancée par l'ARS et le Conseil Régional des Pays de la Loire
Réalisation en partenariat avec l'ORS Ile-de-France
1
/
3
100%