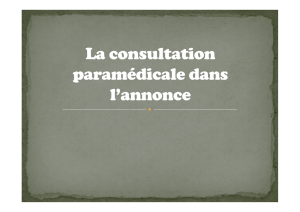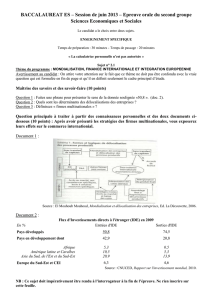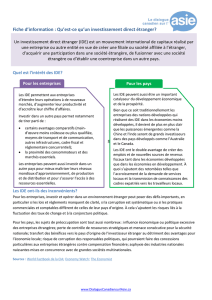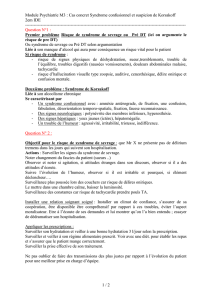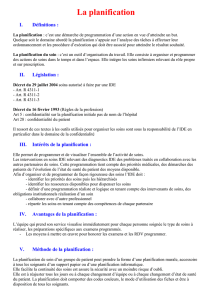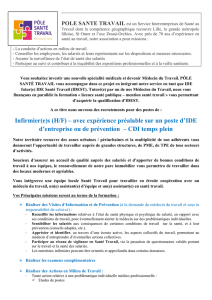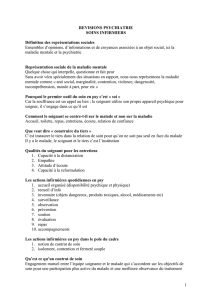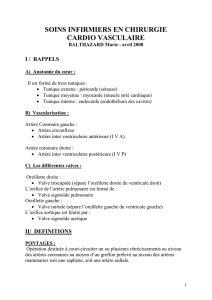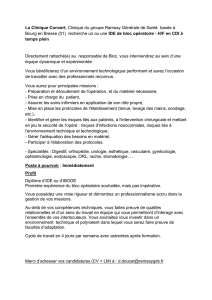presentation competence 2 mise en place des actions

UE 3.2.S2/C2/doc formateur
Objectif de la séquence:
-Que l’étudiant soit capable d’identifier le lien entre la compétence 1 et la compétence 2
-Que l’étudiant identifie les actions IDE sur prescription, en collaboration et sur rôle propre ainsi que
les actions de l’équipe pluridisciplinaire
-Que l’étudiant soit capable de nommer précisément le but recherché par la mise en place de ces
actions de soins.
Pré-requis:
Contenu de l’UE 3.1.S1
Le recueil de données cliniques
Moyen pédagogique
A partir d’une situation clinique du post-opératoire immédiat déjà travaillée dans le temps “recueil de
données cliniques”
DEROULEMENT DE LA SEQUENCE
1) Compétence 2 =“concevoir et conduire un projet de soins infirmiers”
Compétence 1 et 2 = compétences “coeur de métier” légitimant la compétence infirmière à raisonner,
analyser, prendre des initiatives en regard des règles qui régissent la profession.
= responsabilité et autonomie de l’IDE dans la prise en soins de ses patients.
La conception d’un projet de soins nécessite une bonne connaissance de la personne soignée, de ses
attentes, de ses besoins = élaboration d’un recueil de données et analyse de celui-ci afin d’identifier les
besoins en santé ou les risques pour la santé de cette personne.
Mais aussi , nécessité d’identifier les ressources humaines (équipe pluridisciplinaire) et matérielles du
service ( petits matériels, pharmacie, laboratoire, imagerie médicale, service d’animation, salle de
rééducation, salon coiffure, .....)et / ou de la structure.
Il nécessite la participation du patient et son accord. (cf “les droits des patients” et consentement éclairé +
participation du patient = efficacité) = négociation du projet avec le patient pour certains problèmes ou
risques qui nécessite une adhésion.
Ex: récupération de l’autonomie / soins d’hygiène, éducation du patient, adhésion au programme
thérapeutique ,....
Le projet de soins est celui du patient.
Janvier 2011/ASR
1
PRESENTATION COMPETENCE 2
MISE EN PLACE DES ACTIONS IDE

UE 3.2.S2/C2/doc formateur
L’élaboration du plan de soins correspond à la 2e étape du raisonnement clinique infirmier:
-1ère étape : raisonnement diagnostique (recueil de données, analyse,
identification des problèmes)
-2e étape : raisonnement thérapeutique = mise en place des actions,
évaluation et réajustement.
2/ Recherches / situation de Mme X
Les étudiants identifient les actions à mettre en regard des problèmes de santé réels et potentiels de Mme
X. lors de l’accueil après le bloc opératoire, dans le service de gynécologie.
Dans le corrigé ci-dessous, Les données en italiques sont celles déjà identifiées dans le temps “recueil de
données cliniques”
Janvier 2011/ASR
2

UE 3.2.S2/C2/doc formateur
RAPPEL: Les données en italiques sont celles déjà identifiées dans le temps “recueil de données cliniques”
Problème de santé Objectifs = pourquoi? actions
Risque hémorragique
Dans ce contexte du post-
opératoire immédiat, il s’agit
du risque prioritaire à
prendre en compte dans les
actes de soins.
=Notion de risque vital
Dépister les signes de
l’hémorragie post-opératoire
Surveiller le teint de la patiente = pâleur?
Surveiller la cyanose des extrémités
Surveiller les constantes : hypotension, pouls rapide et filant, polypnée
Surveiller l’état de conscience de Mme X: asthénie, réponses ?
Surveiller l’apparition de saignements au niveau du pansement, du redon, de la sonde
vésicale mais aussi au niveau vaginal
Surveiller la quantité des urines (en cas d’hémorragie interne, diminution de la diurèse
voire anurie pour compenser)
QUI: l’IDE.
Comment : Observation clinique. Ces signes sont à surveiller toutes les 30 mn lors du
retour de bloc immédiat et ceci pendant 4 h puis toutes les 2h.
Ces actions ne sont pas prescrites par le médecin, pourtant elles sont de la responsabilité
de l’IDE dans le cadre de son rôle en collaboration (/ problèmes qui découlent de la
situation médicale)
Réaliser et surveiller la NFS: GR, Hg, Hte. En fonction de la PM (rôle sur PM)
Risque de déséquilibre
hydro-electrolytique (ou de
deshydratation)
En lien avec l’anesthésie et le
fait qu’elle soit à jeûn
Dépister tout désordre hydro-
electrolytique
Surveiller l’apparition de nausées et de vomissements qui sont des effets indésirables des
anesthésiants. Or lors de vomissements, la personne perd de l’eau et des ions.
Surveiller le rapport des entrées et des sorties
Entrées = apports (perfusions + boissons)
Sorties = urines + liquide du redon
Surveillance de la diurèse
Surveillance clinique: pli cutané? Orbites creusées?; asthénie, sensation de soif intense?
Surveillance des constantes: hypotension, pouls rapide et filant
QUI: l’IDE. rôle en collaboration
Comment : Observation clinique .Ces signes seront à surveiller toutes les 30 mn lors du
retour de bloc immédiat et ceci pendant 4 h puis toutes les 2h.
Janvier 2011/ASR
3

UE 3.2.S2/C2/doc formateur
Prévenir un désordre hydro-
electrolytique (ou une
deshydratation)
Réalisation et surveillance du ionogramme sanguin (sodium et potassium ), de l’urée et de
la créatinine (fonction rénale).
En fonction de la PM QUI: l’IDE (rôle sur PM)
Surveillance et relai de la perfusion:SGI 1L / 12 H + 4g NaCl à 20% + 2g Kcl à 20%
QUI: l’IDE. Rôle sur PM
Si pas de nausées et de vomissements, se référer aux PM de l’anesthésiste: En général,
reprise des boissons 6h après le bloc et repas léger 8 h après le bloc.
= rôle sur PM
Comment: respect des PM et adapter / état clinique de la patiente
La douleur du post-
opératoire au niveau des
plaies voire dans les épaules
(évacuation du gaz/
coelioscopie)
Dépister toute manifestation de
douleur
Observer le facies: crispation des traits?
Observer si la patiente prend une position antalgique (ex: en chien de fusil)
Observer les plaintes de la patiente, son comportement
Relever les caractéristiques spécifiques de la douleur:
Son siège
Son intensité (EVA)
Ses irradiations
Son type
Sa durée
Sa périodicité
Ses facteurs aggravants / déclenchants
Surveillance des constantes : FR et pouls augmentés?
QUI: l’IDE. rôle en collaboration
Comment :Observation clinique Ces signes sont à surveiller toutes les 30 mn lors du
retour de bloc immédiat et ceci pendant 4 h puis toutes les 2h.
Janvier 2011/ASR
4

UE 3.2.S2/C2/doc formateur
Prévenir le risque de douleur
Dépister les effets indésirables
du traitement
-Installer confortablement Mme X, au calme et dans la pénombre et demander à son mari
de nous prévenir s’il y a un problème. = rôle propre de l’IDE, AS
- Sur PM:Perfusette de Perfafalgan* dans 50 ml SSI à 19h, 1h et 7h du matin.
QUI: l’IDE / rôle sur PM
Comment : dans 50 ml SSI à 19h, 1h et 7h du matin. (respect de la PM)
Surveillance de l'efficacité:surveiller l'absence de douleur (cf ci-dessus)
Surveillance des effets indésirables:toxicité hépatique en cas de surdosage. Sinon très peu
d'effets indésirables
QUI: l’IDE. rôle en collaboration
Le risque thrombo-
embolique en lien avec
l’intervention sur le petit
bassin
Dépister un risque thrombo-
embolique
Prévenir un risque thrombo-
embolique
Surveiller la dissociation pouls / T° = fébricule + pouls élevé. (Appelé pouls grimpant de
Mahler)
une douleur et chaleur et oèdeme du mollet
une douleur à la dorsiflexion du pied appelé signe de Hommans
une perte du ballottement du mollet ou perte du signe du drapeau
Les signes à dépister/ embolie pulmonaire:
Dyspnée, cyanose des extrémites, douleur thoracique,tachycardie
QUI: l’IDE. rôle en collaboration
Comment : observation (et toucher) clinique. 3 fois/ jour le 1er jour car après 1er lever à
J1 limite le risque (informer la patiente pour nous signaler toute anomalie)
Injection de Lovenox* 0,2 mg (H.B.P.M) QUI: l’IDE / rôle sur PM
Comment: en SC à 20 heures tous les jours
-Lui conseiller de bien bouger ses jambes lorsqu’elle est au lit.
- Surveillance de l'efficacité du Lovenox: ici l'IDE devra surveiller l'absence de signes
évoquant un risque thrombo-embolique (voir détail ci-dessus)
Janvier 2011/ASR
5
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%