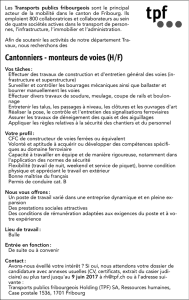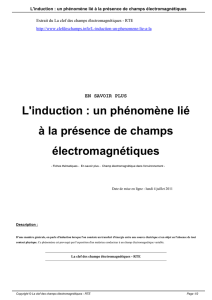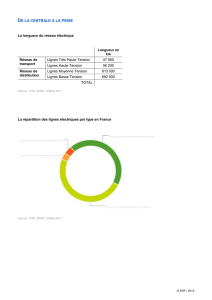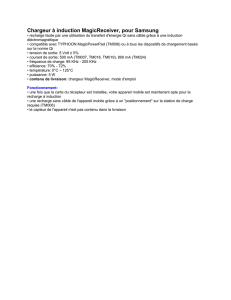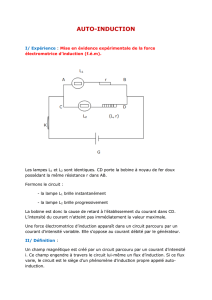Chimiothérapie d`induction dans les cancers des voies aéro

138 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 2 - février 2011
DOSSIER THÉMATIQUE
Cancérologie et ORL
Chimiothérapie d’induction
dans les cancers des voies
aéro-digestives supérieures
Induction chemotherapy in head and neck cancer
Y. Pointreau1, 2, 3, 4, G. Calais1, 2
1 Service de radiothérapie, centre
régional universitaire de cancérologie
Henry-S.-Kaplan, hôpital Bretonneau,
Tours.
2 Université François-Rabelais, Tours.
3 CNRS, UMR 6239 Génétique,
immuno thérapie, chimie et cancer,
Tours.
4 Laboratoire de pharmacologie-
toxicologie, CHRU de Tours.
E
nviron 550 000 nouveaux cas de cancers des
voies aéro-digestives supérieures (VADS) sont
diagnostiqués chaque année dans le monde,
dont 48 000 aux États-Unis, 76 000 en Europe et
20 000 en France. Le tabac et l’alcool restent les
facteurs de risque principaux des cancers épider-
moïdes des VADS ; plus récemment, le rôle du
papillomavirus humain (HPV) a été décrit dans la
survenue des cancers de l’oropharynx, et celui-ci
semble être corrélé à un meilleur pronostic (1). Pour
les deux tiers des patients environ, le diagnostic est
établi à un stade localement avancé, et 30 à 40 %
d’entre eux décéderont de leur maladie. Cette
population de malades représente un défi théra-
peutique, car il s’agit d’obtenir de meilleurs taux
de curabilité tout en essayant de préserver la
fonctionnalité des organes (larynx). Les stratégies
sont décidées en fonction de la classifi cation TNM,
du site primitif, de l’opérabilité, de l’âge et du perfor-
mance status (PS). La chirurgie, la radiothérapie, la
chimiothérapie et, plus récemment, les thérapies
ciblées constituent les piliers des armes thérapeu-
tiques, mais la séquence de traitement reste sujette
à discussion, en particulier dans les stratégies de
préservation d’organe et en cas de tumeurs non
opérables. La chimio thérapie d’induction (CI),
notamment l’arrivée des taxanes, est l’un des
principaux changements de ces 30 dernières années
dans la prise en charge des cancers localement
évolués. L’effet des nouveaux traitements doit être
évalué selon les critères classiques de survie, mais
aussi selon la préservation de la fonction d’organe et
la qualité de vie. Cet article reviendra sur le rationnel
de l’induction, les données actuelles et les perspec-
tives d’avenir.
Rationnel et données
avant les taxanes
Le concept de CI est né après l’identifi cation de
l’effi cacité des sels de platine dans les cancers des
VADS, puis l’association de ces derniers au 5 fl uoro-
uracile (5-FU).
L’utilisation de la CI pour les cancers des VADS a
plusieurs avantages théoriques :
➤
la réduction de la taille tumorale, permettant
un traitement local plus effi cace et moins toxique ;
➤la réduction de l’incidence des métastases ;
➤
la délivrance des cytotoxiques dans la tumeur,
sans dégâts préalables sur la vascularisation par la
chirurgie ou la radiothérapie externe (RTE) ;
➤
l’évaluation de la sensibilité tumorale, qui oriente
le choix du traitement suivant.
Plusieurs études ont évalué l’effi cacité de la CI.
L’étude de phase III randomisée publiée par A. Pacca-
gnella et al. comparait la combinaison du cisplatine
avec le 5-FU (PF) en induction avant traitement
locorégional versus le même traitement loco régional
seul chez 112 patients porteurs ou non de tumeurs
de stades III-IV opérables (2). Le taux de réponse
objective (RO) était de 80 %, sans différence signi-
fi cative sur la survie globale (SG), mais avec une
tendance à l’amélioration de la SG pour les patients
inopérables. Un autre essai randomisé italien (3) a
inclus des patients atteints de cancers opérables
de la cavité buccale : la moitié d’entre eux recevait
une CI par PF avant la chirurgie. Il y avait moins
de résections mandibulaires dans le bras chimio-
thérapie (52 versus 31 %) que dans l’autre bras, sans
effet sur la SG à 5 ans (55 %). Une étude du Groupe
d’étude des tumeurs de la tête et du cou (GETTEC),

La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 2 - février 2011 | 139
Points forts
»
La chimiothérapie d’induction suscite un regain d’intérêt depuis l’introduction des taxanes et s’est
positionnée dans les stratégies de préservation laryngée.
»
Si l’indication d’une chimiothérapie d’induction est retenue, elle est faite à l’heure actuelle avec un
schéma TPF ; le traitement optimal pour la suite de la prise en charge reste à définir.
»Des essais de phase III randomisés sont nécessaires pour comparer la chimiothérapie d’induction à la
radio-chimiothérapie concomitante dans les formes localement évoluées.
»Le positionnement des anti-EGFR doit être étudié en induction dans des études de phase III.
»L’évaluation de la réponse et les objectifs d’évaluation à plus long terme doivent s’harmoniser.
Mots-clés
Chimiothérapie
d’induction
Cancers des voies
aéro-digestives
supérieures
Préservation d’organe
Taxanes
Cétuximab
Highlights
»
Induction chemotherapy
has new interest since the
introduction of taxanes and
has positioned in the larynx
preservation strategies.
»
If induction chemotherapy is
indicated, TPF regimen must be
done, the following treatment
remains to defi ne.
»
For locally advanced cancer,
randomized phase III trials are
needed to compare induction
chemotherapy versus concomi-
tant chemoradiotherapy.
»
The positioning of anti-EGFR
in induction chemotherapy
should be studied in phase III
studies.
Keywords
Induction chemotherapy
Head and neck cancer
Organ preservation
Taxanes
Cetuximab
portant sur des patients atteints de cancers de
l’oropharynx de stades II à IV, comparait 3 cures
de PF suivies du traitement locorégional versus le
traitement loco régional d’emblée (RTE avec ou sans
chirurgie) [4]. Les taux de réponse étaient de 56 %,
et la SG médiane était, respectivement, de 5,1 et
3,3 ans dans les bras induction et contrôle.
La CI a particulièrement été comparée, dans les
stratégies de préservation laryngée, au traitement
standard d’avant les années 1990, la laryn gectomie
totale, qui avait des conséquences négatives
sur la qualité de vie du patient. Cette chirurgie
connaissait des échecs à la fois locorégionaux et
métastatiques (5). La CI par PF suivie de RTE en
cas de bonne réponse a été considérée comme une
possibilité, à la suite de la publication de 2 essais
randomisés rapportant de bons taux de préservation
laryngée (40 à 64 %) sans préjudice sur le contrôle
ou la survie (5, 6). L’essai randomisé princeps des
vétérans américains (6) a inclus 332 patients
porteurs de cancers laryngés de stade III ou IV et
a comparé une CI par PF suivie d’une RTE à une
laryngectomie totale suivie d’une RTE. Une préser-
vation était possible pour les deux tiers des patients.
L’European Organization for Research and Treatment
of Cancer a réalisé un essai, de schéma similaire,
portant sur 194 patients atteints d’un cancer du
sinus piriforme localement avancé, avec des résultats
proches (5).
Parallèlement à cette innovation, un standard a
émergé : la radio-chimiothérapie concomitante, dans
plusieurs localisations tumorales, dont les cancers
des VADS. Les résultats ont été renforcés par la méta-
analyse MACH-NC, actualisée en 2009, qui incluait
87 essais (16 485 patients) randomisés de phase III
contenant de la chimiothérapie (induction, conco-
mitante, adjuvante), réalisés entre 1965 et 2000 (7).
Les données retrouvaient un bénéfi ce de SG à 5 ans
de 4,5 % toutes séquences confondues et de 6,5 % en
cas de traitement concomitant. L’effet de la CI n’était
pas signifi catif, de l’ordre de 2 %, mais il le devenait
si seuls les schémas PF étaient retenus (p = 0,01 ;
HR = 0,88 ; IC
95
= 0,79-0,97). Aucun de ces essais
ne comportait de taxanes en induction.
Une comparaison directe pour les cancers du larynx
a été faite dans l’essai 91-11 du Radiation Therapy
Oncology Group (RTOG), qui comportait 3 bras : CI
par PF suivie de RTE, radio-chimiothérapie conco-
mitante avec cisplatine, et RTE seule (8). Cette
étude suggérait la supériorité signifi cative du bras
concomitant en termes de préservation laryngée à
2 ans (88 versus 75 et 70 %, respectivement, dans
les bras CI et RTE seule) et de contrôle locorégional.
Il n’y avait pas de différence de SG. Cependant, le
bras concomitant se révélait aussi le plus toxique
avec, à 5 ans, un taux de larynx fonctionnel de 45 %
(versus 43 % pour la CI). La CI en ORL, et particuliè-
rement pour les cancers du larynx, semblait moins
toxique (odds-ratio = 4,17 ; p = 0,0041). À l’avenir,
dans les essais, ce sera désormais la préservation de
la fonction de l’organe, plutôt que la simple préser-
vation de l’organe lui-même, qui sera considérée
comme un objectif (9).
Taxanes
Les taxanes constituent l’une des classes de chimio-
thérapie les plus récentes et actives dans les cancers
des VADS. Des données récentes d’essais de phases I,
II et III suggèrent que l’ajout des taxanes (docétaxel
et paclitaxel) aux chimiothérapies conventionnelles a
des conséquences sur l’effi cacité et même sur la SG.
Administrer du paclitaxel en monothérapie à des
patients en rechute permet d’obtenir des taux de
réponse de l’ordre de 40 %. En cas de combinaison
avec un sel de platine ou du 5-FU, l’effi cacité du
traitement augmente, ce qui confi rme le potentiel
du paclitaxel pour ces malades. En 2005, R. Hitt et al.
ont inclus 382 patients dans un essai de phase III
comparant 3 PPF (paclitaxel, cisplatine et 5-FU) à
3 PF en induction (10). En cas de réponse supérieure
à 80 %, les patients recevaient une RTE à 70 Gy avec
du cisplatine 100 mg/m² (à J1, J22 et J43). Le taux
de réponse complète (RC) dans le bras PPF était de
33 %, versus 14 % dans le bras contrôle (p < 0,001).
La radio-chimiothérapie concomitante a été plus
souvent réalisée après PPF (63 versus 44 %). La SG
n’était pas différente (37 versus 43 mois), mais, en
cas de tumeurs non résécables, elle était en faveur
du PPF (36 versus 26 mois ; p = 0,04).
L’introduction du docétaxel en combinaison avec
le PF majore le taux de réponse tumorale, ce qui a
permis de revisiter la CI et de renouveler l’intérêt

140 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 2 - février 2011
Chimiothérapie d’induction dans les cancers des voies aéro-digestives
supérieures
DOSSIER THÉMATIQUE
Cancérologie et ORL
dont elle faisait l’objet. Le schéma TPF avec
adaptation posologique des doses de PF pour une
meilleure tolérance a été testé dans plusieurs essais
jusqu’en phase III, avec des taux de réponse variant
de 50 à 100 %.
Trois essais de phase III publiés (11-13) testant le TPF
suivi d’une RTE, seule (GORTEC 2000-01 et TAX 323)
ou avec carboplatine (TAX 324), ont confi rmé la
supériorité du TPF sur le schéma PF en termes de taux
de réponse, voire en termes de SSP et de SG (12, 13).
Dans l’essai TAX 323, des patients atteints de
tumeurs de stade III ou IV non opérables ont été
randomisés entre un bras TPF (docétaxel et cisplatine
à 75 mg/m² J1 et 5-FU à 750 mg/m²/j de J1 à J5)
et un bras PF (cisplatine 100 mg/m² à J1 et 5-FU
1 000 mg/ m²/j de J1 à J5), avec 4 cycles programmés
toutes les 3 semaines (12). Les patients dont la
maladie ne progressait pas recevaient une RTE
conventionnelle à 70 Gy, une RTE accélérée ou
encore hyperfractionnée (dose totale maximale
de 70 Gy et 74 Gy, respectivement). Un total de
358 patients a été randomisé : 177 dans le bras TPF et
181 dans le bras PF. Le taux de réponse globale était
en faveur du bras TPF, atteignant 68 versus 54 %
(p = 0,006). L’intervalle médian sans progression
était de 11 mois pour le TPF et de 8,2 mois pour le
bras PF (p = 0,007). La survenue de métastases était
le premier événement de rechute pour 13 % des
patients dans le bras TPF et pour 10 % d’entre eux
dans le bras PF. La SG médiane était de 18,8 mois
pour le schéma TPF versus 14,5 mois pour le groupe
PF (p = 0,02).
Dans l’essai TAX 324, des patients atteints d’un cancer
de stade III ou IV considérés comme non opérables
ou bien candidats à une préservation d’organe ont été
randomisés entre un bras TPF (docétaxel 75 mg/ m²
à J1, cisplatine 100 mg/ m² à J1 et 5-FU 1 000 mg/ m²/j
de J1 à J4) et un bras PF (cisplatine 100 mg/m²
à J1 suivi de 5-FU 1 000 mg/ m²/j de J1 à J5), avec
3 cycles programmés toutes les 3 semaines (13).
Tous les patients recevaient au décours une RTE
(dose comprise entre 70 et 74 Gy) associée à du
carboplatine hebdomadaire ASC 1,5. Un total de
501 patients a été analysé. Le taux de réponse était
meilleur dans le bras TPF (72 versus 64 % ; p = 0,07).
La SG médiane était de 71 mois dans le bras TPF et
de 30 mois dans le groupe PF (p = 0,006). Les taux
de contrôle loco régional étaient meilleurs dans le
bras TPF ; l’échec métastatique était de 5 % dans le
groupe TPF et de 9 % pour le PF.
Plus récemment, l’essai GORTEC 2000-01, qui
était spécifi quement conçu pour l’évaluation de la
préservation laryngée, a randomisé 213 patients
atteints de cancer du larynx ou de l’hypopharynx
relevant d’une (pharyngo-)laryngectomie totale (11).
Les patients ont reçu 3 cycles de TPF (docétaxel et
cisplatine 75 mg/m² à J1 et 5-FU 750 mg/m²/j de J1
à J5) ou le standard PF (cisplatine 100 mg/m² à J1
suivi de 5-FU 1 000 mg/m²/j de J1 à J5). Les patients
répondeurs recevaient une RTE (parfois avec chimio-
thérapie concomitante), les autres étaient traités par
chirurgie suivie de RTE (parfois avec chimiothérapie
concomitante). Le taux de réponse globale était de
80 % dans le bras TPF versus 59,2 % dans le groupe
PF (différence de 20,8 % ; p = 0,002). Avec un suivi
médian de 36 mois, le taux de préservation laryngée
était de 70,3 % avec le TPF et de 57,5 % avec le PF
(différence de 12,8 % ; p = 0,03). Dans cet essai, le
schéma TPF augmentait le taux de préservation
laryngée, avec une meilleure tolérance, mais sans
effet sur la survie.
L’ensemble des 3 essais rapportait une meilleure
compliance et une meilleure qualité de vie dans le
bras TPF, avec des taux de neutropénie fébrile respec-
tivement de 5,2 %, 12 % et 10,9 % dans les essais
TAX 323, TAX 324 et GORTEC 2000-01.
Lors du congrès annuel de l’ASCO 2009, R. Hitt
et al. ont présenté, en communication orale, les
résultats de leur essai de phase III, qui incluait
439 patients atteints d’un cancer de stade III
ou IV (14). Les patients étaient randomisés entre
3 bras : radio-chimiothérapie concomitante avec
cisplatine (100 mg/m² à J1, J22 et J43) ; CI standard
par PF suivie du même traitement concomitant ;
CI par TPF suivie du traitement concomitant.
Les auteurs rapportaient un temps jusqu’à échec
signifi cativement meilleur en cas de CI qu’en cas
de radio-chimiothérapie concomitante d’emblée
(12,5 versus 5 mois ; p < 0,001), mais en regroupant
les 2 bras d’induction. De plus, un grand nombre de
patients a été exclu de l’analyse sans explication, ce
qui empêche de tirer des conclusions plus précises
sur la meilleure stratégie.
L’ensemble de ces données semble en faveur à la fois
de la CI et des traitements concomitants ; il semble
logique de les associer dans des stratégies dites
séquentielles en adaptant les temps de traitement
pour ne pas majorer les toxicités de manière additive
ni compromettre le traitement locorégional par
irradiation.
Rôle des anti-EGFR
L’utilisation d’anticorps monoclonaux tel le
cétuximab, dirigé contre le récepteur de l’Epidermal

La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 2 - février 2011 | 141
DOSSIER THÉMATIQUE
Growth Factor (EGFR), qui va empêcher la fi xation
du ligand naturel, représente une autre innovation
récente. L’EGFR est connu en ORL pour être associé
à un moins bon pronostic. L’effi cacité du cétuximab
(400 mg/m² en dose de charge suivie d’une injection
hebdomadaire de 250 mg/m²) a été validée dans un
essai de phase III, portant sur des tumeurs au stade
métastatique, en association avec le cisplatine et le
5-FU chez 442 patients (15) : la SG est passée de 7,4
à 10,1 mois (p = 0,04). Le cétuximab a également été
évalué en association avec la RTE versus la RTE seule
dans un essai de phase III portant sur 213 patients
atteints de cancers localement avancés (16, 17).
Son ajout majore la durée médiane de contrôle
locorégional (14,9 versus 24,4 mois ; p = 0,005) et
la SG médiane (29,3 versus 49,0 mois ; p = 0,03).
L’incidence des toxicités de grade 3 ne semblait pas
majorée. Une actualisation récente des données à
5 ans (17) confi rmait les résultats, et la SG semblait
meilleure pour les patients présentant un rash acnéi-
forme de grade supérieur ou égal à 2 (HR = 0,49 ;
IC
95
: 0,34-0,72 ; p = 0,002). L’étape suivante a
consisté à intégrer le cétuximab dans les schémas
d’induction.
Lors des 2 derniers congrès annuels de l’ASCO,
quelques abstracts concernant cette nouvelle
association ont été dévoilés.
En 2009, R. Mesia et al. rapportaient les données
d’un essai de phase II associant cétuximab et
TPF (docétaxel et cisplatine 75 mg/m² à J1, 5-FU
750 mg/ m² de J1 à J5) pour 4 cycles programmés (18).
S’y ajoutaient une antibioprophylaxie et l’utilisation
de facteurs de croissance. Les 50 patients, atteints de
cancer de stade IV non opérable, recevaient ensuite
une RTE accélérée avec boost concomitant (69,9 Gy)
et cétuximab 250 mg/ m²/sem. Il y a eu RO dans 78 %
des cas ; les toxicités sévères de grades 3-4 étaient
fréquentes, particulièrement les neutropénies (24 %),
souvent fébriles (20 %).
Un autre essai de phase II incorporant le cétuximab
en induction suivi d’une radio-chimiothérapie a
été proposé à 39 patients atteints de tumeurs
de stade III ou IVA-B (19). Ils recevaient du TPE
(docétaxel et cisplatine 75 mg/m² à J1, cétuximab
250 mg/m² à J1, J8 et J15 après une dose de charge de
400 mg/ m² à J1 du cycle 1) tous les 21 jours durant
3 cycles. Ensuite, une radiothérapie de 70 Gy avec
cisplatine 30 mg/m² et cétuximab 250 mg/m²/sem,
puis un traitement d’entretien par cétuximab sur
6 mois étaient planifi és. Avec un suivi médian de
36 mois, les taux de survie sans progression à 2 et
3 ans étaient respectivement de 70 % et 67 %. La
SG à 2 et 3 ans était de 77 %.
L’essai randomisé de phase II DeLOS II comparait
4 cycles de TPF en induction avec ou sans cétuximab,
suivis d’une radiothérapie avec cétuximab en cas
de RO, chez des patients atteints de carcinome
du larynx et de l’hypopharynx opérable (20). À la
suite de 5 décès toxiques parmi les 62 premiers
malades inclus, le 5-FU a été retiré. Au moment de
l’analyse, en janvier 2010, 78 patients étaient inclus.
Les auteurs concluaient que la toxicité du schéma
TPF-cétuximab était inacceptable, mais ils relevaient
une bonne effi cacité ; le schéma TP-cétuximab était
toutefois faisable.
L’essai E2303 évaluait le cétuximab avec une CI par
paclitaxel 90 mg/m² et carboplatine ASC 2 suivie,
en cas de bonne réponse, d’une RTE avec cétuximab
(et chimiothérapie) chez des patients atteints de
tumeurs de stade III ou IV résécables (21). Soixante-
dix des 74 patients inclus ont reçu la CI, et 68 la
radio-chimiothérapie concomitante. Quatre-vingt-
onze pour cent des 63 patients éligibles à l’analyse
avaient une réponse histologique complète au
moment des nouvelles biopsies. Aucune donnée
n’était rapportée concernant les toxicités.
Si l’on interprète l’ensemble de ces données, on peut
conclure que les schémas TP (± F) avec cétuximab
pourraient être une possibilité pour les patients
relevant d’une CI, mais que les toxicités en limitent
l’usage ; et que des essais de phase III sont néces-
saires pour valider les effets de l’ajout du cétuximab,
comparativement à un schéma TPF déjà très effi cace.
Conclusion et perspectives
Le schéma TPF a acquis une place indiscutable dans
la CI, sur la base d’une convergence de données :
la toxicité est acceptable ; comparativement au
schéma PF, il augmente signifi cativement le contrôle
loco régional, dans 3 essais publiés randomisés ; il
donne un taux de RO chez les deux tiers des patients,
et il a un effet signifi catif sur la SG et la survie sans
maladie dans les 2 essais TAX.
Cependant, plusieurs questions demeurent :
➤Quel est le nombre optimal de cycles en induc-
tion (2, 3, 4, ou plus) ?
➤Quel dosage pour chacune des molécules ?
➤
Comment évaluer la réponse au traitement ?
Imagerie et endoscopie jouent probablement un
rôle essentiel. Quel est l’intérêt du PET scan et de
l’IRM fonctionnelle ?
➤
Quand évaluer la réponse au traitement ? Entre
le deuxième et le troisième cycle ? Dès la fi n du troi-
sième cycle ou 3 semaines après, pour attendre une
"MMNMBDY
UNTR
Une deuxième
insertion gratuite
pour
les abonnés
Contactez Valérie Glatin
au 01 46 67 62 77
ou faites parvenir
votre annonce par mail

142 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XX - n° 2 - février 2011
Chimiothérapie d’induction dans les cancers des voies aéro-digestives
supérieures
DOSSIER THÉMATIQUE
Cancérologie et ORL
réponse maximale ? L’idée est toutefois de ne pas
perdre de temps pour pourvoir changer rapidement
de stratégie si le traitement n’est pas suffi samment
effi cace ou pour mettre en place la radiothérapie.
➤Comment optimiser le schéma TPF ? Par l’addi-
tion d’un anti-EGFR (cétuximab) au TPF (TPF-
cétuximab) ou par le retrait du 5-FU (TP-cétuximab) ?
L’évaluation des risques que sont les toxicités et un
potentiel d’amélioration relativement faible rendent
nécessaires des essais de phase III.
➤Comment intégrer le TPF en induction dans les
futurs schémas dits séquentiels, l’objectif étant de ne
pas compromettre le traitement locorégional tout en
essayant de l’optimiser (ajout d’une chimiothérapie
ou d’un anti-EGFR, modifi cation du fractionnement
ou de l’étalement) ?
➤
Quelles sont les bonnes indications de la CI ? La
préservation d’organe, les tumeurs non résécables,
les hauts risques métastatiques, les grosses tumeurs
ou les adénomégalies ?
Il est nécessaire de comparer en première ligne la
CI (quel est alors le meilleur schéma ?) à la radio-
chimiothérapie chez des patients relevant de prises
en charge différentes, sans mélanger les cas (préser-
vation, inopérables, cavité buccale versus oropharynx
versus hypo-pharyngolarynx, etc.).
Les études en cours devraient permettre de répondre
à ces interrogations ou, au moins, donner des
pistes. Les résultats défi nitifs des études DeCIDE
et PARADIGM devraient bientôt être disponibles.
Les résultats préliminaires sur les toxicités de l’essai
PARADIGM ont été présentés à l’ASCO en 2010 (22).
Cette étude de phase III comparait 3 cycles de TPF
suivis d’une RTE avec soit du carboplatine, soit du
docétaxel hebdomadaire à une radio-chimiothérapie
concomitante chez des patients atteints de tumeurs
localement avancées de stade III ou IV (majoritai-
rement, parmi les 145 patients inclus, des tumeurs
de l’oropharynx).
Une nouvelle méta-analyse incluant les données
récentes du schéma TPF est en cours, dans le but
d’évaluer plus globalement ce schéma et son effet
sur la survie par rapport à la radio-chimiothérapie
concomitante.
Les évaluations comparatives devront intégrer la
notion de fonctionnalité de l’organe, notamment
la qualité de la déglutition et de la voix, ainsi que
la qualité de vie. ■
Prise en charge des patients
et effi cience du système
de soins : renforcer les synergies
entre industriels et institutions
de recherche et de soins
À l’occasion d’une table ronde qui s’est tenue le lundi
17 janvier 2011 à l’hôpital américain de Neuilly-sur-
Seine, l’association CrossWorlds HealthCare Profes-
sionnals (CWHCP) a présenté une étude qualitative
intitulée “Optimiser les collaborations entre institutions
de recherche et de soins et industriels de santé” (OCIRSIS).
Cette étude met en avant certaines différences quant à
l’appréciation de l’importance relative des principaux
leviers d’optimisation de l’effi cacité et de l’effi cience
des systèmes de santé et des domaines dans lesquels
une collaboration plus étroite est nécessaire. Elle relève
néanmoins de nombreuses convergences entre industriels
et institutions de soins et de recherche, convergences
mises en exergue par les 6 experts hospitaliers réunis
autour du Dr Valery Labonne, président de l’association,
et Hervé Drevot, consultant en stratégie dans le domaine
de la santé lors de la table ronde. Ainsi, transformer
le modèle recherche et développement par le biais de
nouveaux modes de collaboration constitue un objectif
commun, mais aussi accroître l’impact de l’évaluation
des technologies de santé, optimiser la pertinence du
diagnostic et la personnalisation de la prise en charge,
rendre le patient acteur de sante, renforcer la continuité
et la coordination du parcours de soins et tirer parti des
potentialités des technologies de l’information et de la
communication.
Les informations sur l’étude et l’association sont disponibles
sur le site www.cwhcp.org.
Communiqué de presse de l’association
CrossWorlds HealthCare Professionals
Communiqués des conférences de presse, symposiums,
manifestations organisés par l’industrie pharmaceutique
Nouvelles
de l’industrie
pharmaceutique
1. Schwartz SR, Yueh B,
McDougall JK, Daling JR,
Schwartz SM. Human papillo-
mavirus infection and survival
in oral squamous cell cancer:
a population-based study.
Otolaryngol Head Neck Surg
2001;125(1):1-9.
2. Paccagnella A, Orlando A,
Marchiori C et al. Phase III
trial of initial chemotherapy
in stage III or IV head and neck
cancers: a study by the Gruppo
di Studio sui Tumori della Testa
e del Collo. J Natl Cancer Inst
1994;86:265-72.
3. Licitra L, Grandi C, Guzzo M
et al. Primary chemotherapy
in resectable oral cavity squa-
mous cell cancer: a randomized
controlled trial. J Clin Oncol
2002;21:327-33.
Retrouvez la suite
des références
bibliographiques
sur notre site
www.edimark.fr
Références
bibliographiques
 6
6
1
/
6
100%