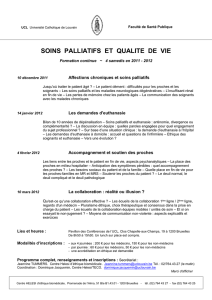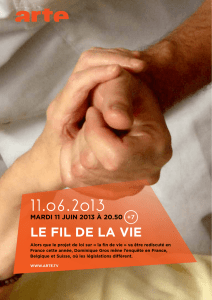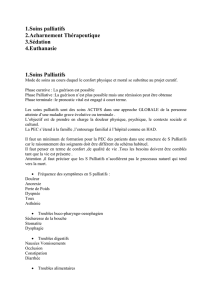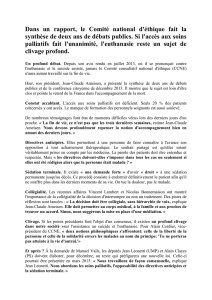Stage à la Maison Médicale Jeanne Garnier

Isabelle MONDOU IREB
Etudiante inscrite au PhD en Sciences Biomédicales, option Bioéthique, Université de Montréal
Rapport de stage
et au Doctorat en Ethique Biomédicale, Université Paris V, en cotutelle
Montréal, Avril 2002
Stage à la Maison Médicale Jeanne Garnier
PARIS XVème
du lundi 4 Février au vendredi 29 Mars 2002

Isabelle MONDOU IREB
Etudiante inscrite au PhD en Sciences Biomédicales, option Bioéthique, Université de Montréal
Rapport de stage
et au Doctorat en Ethique Biomédicale, Université Paris V, en cotutelle
Montréal, Avril 2002
Introduction
Je viens d’effectuer un stage d’une durée de huit semaines, en tant que
médecin omnipraticien et étudiante en bioéthique, à la Maison Médicale Jeanne
Garnier (MMJG), spécialisée en soins palliatifs. Cette expérience a été rendue
possible grâce à la bourse que m’a octroyée l’Institut International de Recherche
en Éthique Biomédicale (IREB) et bien entendu grâce à Madame le Docteur Marie-
Sylvie Richard et aux responsables de la MMJG qui m’ont invitée dans ces lieux.
Il m’a été demandé par l’IREB de rédiger un rapport de stage. J’avoue qu’il
m’est difficile de faire part pleinement et en y mettant le ton juste de cette
expérience vécue en unité de soins palliatifs, sans rompre ni la confiance dont m’ont
honorée les soignants et les malades du service, ni la confidentialité que je leur
dois.
Ceci étant dit, je rendrai compte de ce séjour parisien en présentant d’abord
les objectifs et la problématique de ma recherche, de manière un peu plus détaillée
que dans mon dossier de candidature. Ensuite, je décrirai de manière factuelle le
déroulement du stage. Enfin, je témoignerai de mes remarques et de mes
interrogations face à cette expérience, contribuant ainsi, je l’espère, à
l’avancement des connaissances dans le domaine de la recherche en éthique
biomédicale.

Isabelle MONDOU IREB
Etudiante inscrite au PhD en Sciences Biomédicales, option Bioéthique, Université de Montréal
Rapport de stage
et au Doctorat en Ethique Biomédicale, Université Paris V, en cotutelle
Montréal, Avril 2002
Objectifs et Problématique du sujet de recherche
Le concept des soins palliatifs, partisan du «laisser mourir», s’oppose en
principe et en pratique au «faire mourir», à l’euthanasie et au suicide médicalement
assisté. Dans de rares cas, les soins palliatifs s’avèrent insuffisants à soulager
l’extrême souffrance des patients. Quelques uns réclament alors une aide pour
mourir. Et, si certains médecins s’y opposent vigoureusement, d’autres envisagent le
recours à ces pratiques illégales.
Comment comprendre le processus de la prise de décision médicale dans ce
contexte clinique particulier ?
Soins palliatifs : historique
L’accompagnement bénévole des mourants dans des «hospices»1 s’est
professionnalisé, médicalisé, et s’est étendu, dans les années 1960 et sous
l’impulsion de C. Saunders, de l’Angleterre à l’Amérique du Nord. Depuis la création
du St Christopher’s Hospice londonien par C. Saunders (1967), et celle de la
première Unité de Soins Palliatifs hospitalière montréalaise par B. Mount (1974), un
nombre important de services de soins palliatifs a été créé à travers le monde.
Soins Palliatifs : définition
La définition des soins palliatifs reste sujette à débat, variant d’un
organisme à l’autre et au cours du temps. La définition que donnait en 2000
l’Association Québécoise des Soins Palliatifs est la suivante :
«Ensemble des interventions nécessaires à la personne atteinte d’une maladie dont l’évolution
compromet la survie ainsi qu’à ses proches, afin d’améliorer leur qualité de vie en considérant
les besoins dans toutes leurs dimensions.
1instauré par les Dames du Calvaire (Jeanne Garnier) au XIXème siècle puis les Soeurs de la Charité
(Marie Aikenhead)

Isabelle MONDOU IREB
Etudiante inscrite au PhD en Sciences Biomédicales, option Bioéthique, Université de Montréal
Rapport de stage
et au Doctorat en Ethique Biomédicale, Université Paris V, en cotutelle
Montréal, Avril 2002
Les soins palliatifs reconnaissent [entre autres] :
- La très grande valeur de la vie et le caractère naturel de la mort2 ...»
Soins palliatifs : caractéristiques
Des définitions données par les associations de soins palliatifs canadienne,
québécoise, française et l'O.M.S depuis les années 1970 ressortent les
caractéristiques principales de ce type de soins, et l’évolution de ces dernières : Ce
sont des soins actifs et globaux, intéressant la personne malade dans son ensemble
somatique, psychologique, social et spirituel. D’abord réservés aux patients atteints
de cancer en phase terminale, ils étendent leurs indications non seulement à
plusieurs maladies incurables parfois chroniques3, mais aussi dès le diagnostic de la
maladie et jusqu’à la mort, ce qui implique la diffusion de leur approche dans tous
les champs de la médecine. Leur objectif est le soulagement de la «douleur totale»
du malade pour améliorer sa qualité de vie. Ils sont organisés autour d’une équipe
interdisciplinaire et se passent à domicile ou en institution. Leur philosophie
s’intéresse au bien-mourir et s’oppose en principe à toute action qui pourrait
retarder ou «provoquer intentionnellement la mort».
Soins palliatifs : éthique clinique
Pour certains, les soins palliatifs sont revendiqués comme position éthique4,
mettant en oeuvre une certaine conception de la vie. Il s’agit pour eux, soignants et
accompagnants au sens large, de mettre en pratique la philosophie des soins
palliatifs, et d’«être simplement humains». Ainsi, le concept de douleur totale
suscite la prise en compte des multiples dimensions de la personne. La
reconnaissance du caractère singulier de chacun incite au respect de l’altérité. La
relation à l’autre devient primordiale, d’où, en pratique clinique, le souci permanent
de maintenir le malade en état de conscience. D’ailleurs, si l’éthique des soins
palliatifs est souvent perçue comme éthique du prendre soin, éthique de la
compassion et de la sollicitude, elle est aussi considérée comme une éthique
relationnelle. La communication entre les soignants et le patient, mais aussi avec les
proches, est au centre de l’activité palliative. L’union de tous les acteurs de soins
palliatifs en une véritable «communauté de soins», reflète l’engagement de chacun
2Rapport Lambert - Lecomte, sur l’état de situation des soins palliatifs au Québec, pour l’AQSP (en
processus d’évaluation auprès de ses membres), 2000
3maladies neurodégénératives, SIDA, cardiopathies ou pneumopathies sévères, polypathologies du
grand âge, etc...

Isabelle MONDOU IREB
Etudiante inscrite au PhD en Sciences Biomédicales, option Bioéthique, Université de Montréal
Rapport de stage
et au Doctorat en Ethique Biomédicale, Université Paris V, en cotutelle
Montréal, Avril 2002
au service de l’idéal commun.
L’éthique clinique impose aux soignants, une réflexion permanente sur les
problèmes rencontrés dans la pratique médicale. En soins palliatifs, l’éthique
médicale prévaut dans son intégralité, mais elle incite à la remise en question de
l’attitude médicale, à une «conversion intérieure», devant l’aggravation inéluctable
de la maladie : la qualité de vie prime sur sa durée. Les soins palliatifs choisissent
de laisser mourir (ne pas initier voire interrompre les traitements qui prolongent
l’agonie) plutôt que de faire mourir (pratiquer l’euthanasie ou l’aide au suicide).
Quand laisser mourir ? Devant le refus, la disproportion, ou l’inanité d’un traitement
? Comment laisser mourir ? En soulageant parfois au risque d'entraîner la mort, ou
en suscitant l’inconscience du malade ? Où laisser mourir ? À domicile ou à l’hôpital
? Pourquoi laisser mourir ? Peut-on être certain de l’inutilité du traitement curatif
? A-t-on réellement épuisé toutes les ressources médicales ? Et puis que répondre,
et comment répondre à la demande de mourir d’un patient en grande souffrance ?
Autant de questions qui rendent la prise de décision difficile et qui mettent en jeu
la responsabilité du médecin.
Problématique
Longtemps, les soins palliatifs ont eu la réputation de soulager toutes les
douleurs en fin de vie et promettaient une mort paisible et sans souffrance. Il
s’avère que parfois une prise en charge adaptée se révèle impuissante à offrir une
fin de vie supportable4. Parmi les patients en extrême souffrance, un certain
nombre, estimant avoir perdu toute qualité de vie, demande de façon rationnelle et
récurrente une aide pour mourir5 6. Parmi eux, la douleur n’est pas le plus
fréquemment en cause7, mais plutôt une souffrance globale, un délabrement
physique et moral à l’origine d’un sentiment complexe de perte de dignité, de
limitation de soi et de lassitude de vivre.
4Sobel, R., «The Myth of the Control of Suffering»,
Journal of Medical Humanities
, vol. 17, n*4,
1996
5D’après Deleuze Y., Van Oost C., «Aliquando mederi saepe cedare semper consolare. Faut-il
légiférer dans le domaine de l’euthanasie ?»,
Ethica Clinica
, La mort médicalisée, 1998, n*9, p. 36-38
6Byock, I. R., Consciously Walking the Fine Line : Thoughts on a Hospice Response to Assisted
Suicide and Euthanasia»,
Journal of Palliative Care
, 1993, vol.3, n*9, p.25-28
7Natali F., Décisions en fin de vie, l’euthanasie en question,
Soins
, n*647, juillet-août 2000, p. 42-47
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%