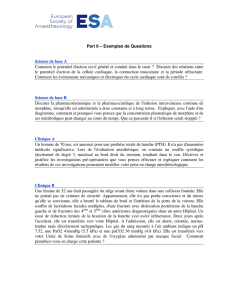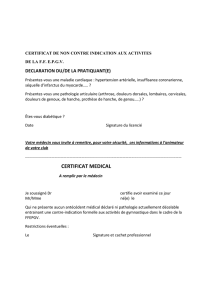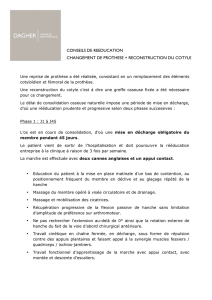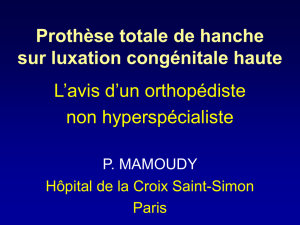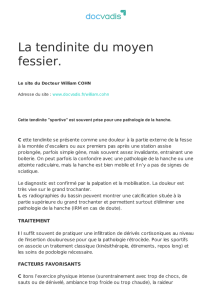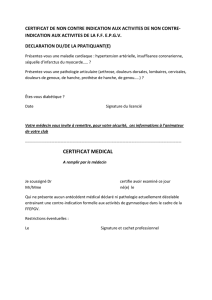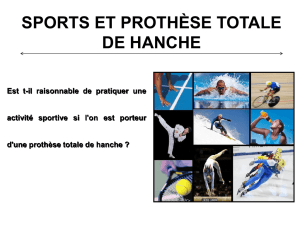De la dysplasie à l`arthrose

De la dysplasie à l’arthrose
P. Wicart, R. Seringe
L’avenir de la hanche à l’âge adulte peut être compromis par le développement de pathologies pendant
l’enfance. Leur conséquence ultime est le développement d’une arthrose. La hanche est une localisation
fréquente des pathologies de l’enfant. Les affections en cause peuvent être congénitales, comme par
exemple la luxation congénitale de la hanche ou certaines malformations. D’autres pathologies sont
acquises, parfois qualifiées à tort initialement de « rhume de hanche » ou de synovite aiguë transitoire,
comme l’ostéochondrite primitive, une pathologie inflammatoire ou dystrophique, ou enfin une lésion
traumatique. Il s’agit d’une articulation profonde, à la jonction entre le rachis et les membres inférieurs,
ce qui explique une variété importante de manifestations fonctionnelles et un retard diagnostique très
fréquent. L’étude de l’anamnèse et l’examen clinique sont les pivots de l’enquête étiologique et orientent
la prescription des examens complémentaires. Les examens radiologiques doivent être prescrits de façon
précise en fonction du type de pathologie suspecté. Le diagnostic et le traitement peuvent être urgents,
car certaines affections mettent en jeu le pronostic fonctionnel comme l’épiphysiolyse fémorale supérieure
ou l’arthrite de hanche, et parfois le pronostic vital comme certaines pathologies tumorales. Compte tenu
de leur fréquence et de leur pronostic sévère en cas de diagnostic tardif, l’arthrite de hanche et les
ostéomyélites fémorales proximales sont les préoccupations principales quel que soit l’âge et de façon
presque exclusive avant l’âge de 3 ans. Une boiterie d’installation récente chez un enfant âgé de plus de
10 ans doit faire évoquer en priorité une épiphysiolyse fémorale proximale.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Hanche ; Boiterie ; Épiphysiolyse ; Ostéoarthrite ; Dysplasie ; Ostéochondrite
Plan
¶Introduction 2
¶Embryologie de la hanche 2
Période embryonnaire 2
Période fœtale 2
Croissance sériée 2
De la naissance à l’âge de 1 an 2
De l’âge de la marche à l’adolescence 2
¶Vascularisation de l’extrémité proximale du fémur 2
¶Luxation congénitale de hanche 3
Étiologie 3
Dépistage de la LCH 3
Histoire naturelle de la luxation congénitale de la hanche 5
Complications de la luxation chronique de hanche
et de son traitement 7
Traitement de la luxation congénitale de la hanche 7
¶Coxa vara 9
Coxa vara congénitale 9
Coxa vara acquises 10
Coxa vara développementale 10
¶Synovite aiguë transitoire 10
Épidémiologie 10
Étiologie 10
Signes fonctionnels 10
Examen clinique 10
Examens complémentaires 10
Diagnostic différentiel 11
Traitement 12
¶Infections de la hanche 13
Physiopathologie 13
Ostéoarthrite de hanche du nouveau-né et du nourrisson 13
Ostéoarthrite de hanche de l’enfant et de l’adolescent 14
Examens à visée bactériologique 14
Diagnostic différentiel 15
Séquelles des infections de la hanche 15
¶Ostéochondrite primitive de hanche ou maladie
de Legg-Calvé-Perthes 16
Étiologie 16
Épidémiologie 16
Histoire naturelle 16
Anatomie pathologique 16
Pronostic 17
Étude clinique 17
Étude radiologique 17
Évolution des signes au cours de la maladie 17
Différents signes radiologiques selon la topographie 17
Autres examens d’imagerie 18
Formes cliniques 18
Diagnostics différentiels 19
Traitement 19
¶Épiphysiolyse fémorale supérieure du fémur 20
Étiologie 20
Présentation clinique 20
Examens complémentaires 21
Complications 21
Traitement 23
¶Chondrolyse idiopathique de hanche 23
¶4-007-E-10
1Pédiatrie
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 06/01/2017 par SCD Paris Descartes (292681). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

¶Tumeurs de la hanche 24
¶Traumatologie de la hanche de l’enfant 24
Fractures de l’extrémité proximale du fémur 24
Fractures de l’acétabulum 25
Luxation de la hanche 26
Avulsion traumatique des apophyses 26
¶Conclusion 26
■Introduction
L’avenir de la hanche à l’âge adulte peut être compromis par
le développement de pathologies pendant l’enfance. Leur
conséquence ultime est le développement d’une arthrose.
Les affections en cause peuvent être congénitales, comme par
exemple la luxation congénitale de la hanche ou certaines
formes de coxa vara.
Il peut aussi s’agir de pathologies acquises, parfois qualifiées
à tort initialement de « rhume de hanche » ou de synovite aiguë
transitoire. En effet, cette entité peut masquer des affections
graves pouvant engager significativement le pronostic fonction-
nel comme l’épiphysiolyse fémorale supérieure, l’ostéochondrite
ou une lésion traumatique, ou le pronostic vital comme les
ostéoarthrites de hanche ou certaines tumeurs.
■Embryologie de la hanche
Toutes les étapes du développement de la hanche sont à
connaître, depuis la période embryonnaire jusqu’à l’adolescence.
Période embryonnaire
Elle recouvre les 2 premiers mois de la vie intra-utérine et
correspond à l’organogenèse. C’est pendant cette période que
surviennent les malformations.
Dans un embryon de 4 semaines (qui mesure 5 mm) appa-
raissent les bourgeons des membres inférieurs. Les cellules
mésenchymateuses se multiplient et s’orientent pour dessiner
l’ébauche fémorale (tronc de cône) et l’ébauche pelvienne
(disque). Une densification cellulaire signale très tôt l’emplace-
ment de la future hanche au sein de l’ébauche commune entre
fémur et os iliaque. C’est vers la fin de la septième semaine
(embryon de 22 mm) qu’apparaît la fente articulaire correspon-
dant au début de la séparation des ébauches de la tête fémorale
et de l’acétabulum.
Cela résulte à la fois des phénomènes de dégénérescence
cellulaire et des sollicitations mécaniques liées aux premiers
mouvements des membres inférieurs.
La cavité articulaire est achevée à la neuvième semaine alors
que le fœtus mesure 40 mm. C’est à cette période que le tissu
mésenchymateux se transforme en cartilage et que, par ailleurs,
se mettent en place nerfs, vaisseaux et muscles.
Période fœtale
C’est une phase de maturation et de croissance cartilagineuse.
Le mécanisme de croissance est double. La croissance intersti-
tielle est pluridirectionnelle par division cellulaire et accumula-
tion de substances fondamentales. Cette croissance est expo-
nentielle non spécifique. Le programme génétique produit une
structure malléable sur laquelle les forces mécaniques ont de
plus en plus d’actions au fur et à mesure que l’organisme
augmente de volume et que la motricité se développe. Ce mode
de croissance persiste après la naissance et chez l’enfant, mais
sa vitesse diminue considérablement.
Croissance sériée
Elle s’effectue aux extrémités de chaque pièce diaphysaire
ossifiée où se mettent en place les plaques conjugales, lieu de
croissance sériée qui réalise un double phénomène : une
croissance axiale et partiellement transversale au sein du
cartilage (augmentation de volume et de longueur). Cette
croissance est d’apparition secondaire. Elle diminue avec l’âge et
est beaucoup moins malléable que la croissance interstitielle.
Durant le troisième mois, les artères centrales des maquettes
cartilagineuses induisent un mécanisme de calcification puis
d’ossification qui aboutit à l’apparition des noyaux osseux
primitifs de type diaphysaire, du côté fémoral le noyau primitif
de la diaphyse fémorale et du côté pelvien les noyaux primitifs
des trois constituants de l’os iliaque : l’ilion, l’ischion et le
pubis. C’est à l’union de ces trois pièces que se situe l’acétabu-
lum, et plus particulièrement le futur cartilage en Y
[1-3]
.
À partir du cinquième mois, la croissance se poursuit, avec
une tête fémorale qui passe de7à12mmàlanaissance. Le col
du fémur est court et trapu, alors que le grand trochanter est
particulièrement développé, la profondeur de l’acétabulum
diminue au cours des derniers mois de la vie intra-utérine.
À la naissance, la cavité acétabulaire est relativement peu
profonde mais représente une demi-sphère qui assure une
stabilité parfaite de la hanche. La capsule articulaire forme un
manchon très résistant épaissi en avant par le ligament de
Bertin. Le pourtour de l’acétabulum est représenté par le bord
saillant du limbus qui enserre solidement la tête fémorale. Le
col du fémur est court, avec une tête qui n’est pas parfaitement
sphérique. L’angle cervicodiaphysaire est de l’ordre de 135° à
145° et la torsion fémorale interne est de l’ordre de 25° à 30°.
Les changements qui vont se produire au moment de la nais-
sance consistent en une déflexion de hanche d’une part et,
d’autre part, en l’obtention d’une liberté de mouvements de
l’enfant permettant un remodelage harmonieux de l’acétabulum
cartilagineux et de la tête fémorale.
De la naissance à l’âge de 1 an
Deux modifications surviennent :
• l’allongement du col fémoral améliorant le bras de levier des
muscles fessiers ;
• la diminution de l’endorotation fémorale qui passe de 30°
à 10°.
La maturation osseuse progressive entraîne des modifications
radiologiques :
• apparition du noyau d’ossification épiphysaire fémoral
proximal à un âge variable entre 3 et 6 mois, mais parfois
jusqu’à 1 an ;
• modification de l’image acétabulaire plus particulièrement de
la partie inférieure de l’ilion permettant de caractériser la
pente ou angle acétabulaire.
De l’âge de la marche à l’adolescence
La croissance de la hanche se poursuit de façon progressive,
avec cependant une phase de développement préférentiel de
l’acétabulum entre les âges de 3 et 6 ans en ce qui concerne sa
maturation osseuse radiologique.
La puberté entraîne une fusion des différents cartilages de
croissance (cartilage en Y, cartilage sous-capital, cartilage
trochantérien).
Il ne faut pas sous-estimer les modifications survenant en fin
de croissance, en particulier concernant la modification de la
forme du fémur proximal sous l’influence des différents traite-
ments entrepris, ainsi que la dysplasie acétabulaire.
■Vascularisation de l’extrémité
proximale du fémur
Cette donnée est fondamentale puisque de son intégrité
dépend la vitalité du fémur proximal.
Le pédicule circonflexe antérieur se destine au massif tro-
chantérien alors que l’artère circonflexe postérieure va irriguer
l’épiphyse fémorale proximale, la plaque conjugale et une
grande partie de la métaphyse
[4]
.
4-007-E-10
¶
De la dysplasie à l’arthrose
2Pédiatrie
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 06/01/2017 par SCD Paris Descartes (292681). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

L’artère circonflexe postérieure s’insinue entre le tendon du
psoas et les muscles pectinés avant d’aborder la face inférieure
de la capsule articulaire à la base du col. Elle se dirige en arrière
puis remonte à la face postérieure du col fémoral, puis à sa face
supérieure où elle s’anastomose avec une branche de l’artère
circonflexe antérieure, formant un anneau artériel
extracapsulaire.
De cet anneau partent des artères cervicales qui perforent la
capsule pour circuler sous la synoviale à la surface du col
fémoral, donnant des branches à destinée métaphysaire et
d’autres à destinée épiphysaire.
Les principales artères nourricières de l’épiphyse sont situées
au bord supérieur et inférieur du col avec une forte prédomi-
nance pour le pédicule supérieur.
L’artère du ligament rond, de taille variable, irrigue une
portion négligeable de l’épiphyse.
Le cartilage de croissance sous-capital est vascularisé sur son
versant supérieur par les vaisseaux épiphysaires et sur son
versant inférieur par les vaisseaux métaphysaires.
Quel que soit l’âge de l’enfant, le cartilage de croissance
constitue une barrière absolue entre ces deux vascularisations
(Fig. 1).
■Luxation congénitale de hanche
La luxation congénitale de hanche (LCH) est une pathologie
fréquente, affectant de6à20pour 1 000 enfants naissant
vivants.
Étiologie
Le concept de posture luxante anténatale dans la genèse
d’une luxation congénitale de hanche est assez ancien et est
apparu comme prioritaire depuis les années 1970, en particulier
en France. Cependant, l’étiologie et la pathogénie de la LCH
restent assez confuses dans la littérature, chaque auteur ayant de
bons arguments pour présenter sa propre théorie. De très
nombreux arguments plaident en faveur de la théorie de la
posture luxante : ils sont d’ordres anatomique, clinique,
radiologique, échographique, épidémiologique, évolutif et
expérimental.
Dépistage de la LCH
Le dépistage commence par l’interrogatoire à la recherche de :
• antécédents familiaux (origine bretonne ou auvergnate) +++ ;
• anamnèse de la grossesse (perception de mouvements actifs
fœtaux, limitation du volume utérin (oligo/anamnios, gémel-
lité, utérus cicatriciel ou malformé), présentation en siège.
Le dépistage repose sur l’examen clinique.
Examen du nouveau-né
[5-7]
L’examen clinique du nouveau-né ne doit pas être considéré
comme facile. Il doit être précis et attentif. Avant de se focaliser
sur les hanches, il convient de rechercher d’autres anomalies
qui répondent aux mêmes étiologie et pathogénie : genu
recurvatum ou flessum, torticolis, metatarsus varus/adductus.
Il est réalisé dans de bonnes conditions sur un enfant
détendu, calme et repu, idéalement après un biberon. On peut
calmer l’enfant avec stimulation du réflexe de succion avec un
doigt. Des manœuvres de circumduction de la cuisse peuvent
faire céder un court instant l’activité motrice incessante. Enfin,
cet examen doit être différé ou refait plus tard dans de meilleu-
res conditions si nécessaire. Il est idéalement mené sur un plan
d’examen ferme. Plusieurs éléments doivent être recherchés :
• limitation de l’abduction : ce temps de l’examen comporte
plusieurs volets (Fig. 2);
• position spontanée des cuisses, degrés d’écartement, symétri-
que ou non, l’existence de plis cutanés internes de cuisse
asymétriques, ce qui est témoin d’une abduction non symé-
trique ;
• amplitude d’abduction étudiée hanches fléchies à 90° de
façon bilatérale synchrone. Les couches doivent avoir été
enlevées au préalable, le sillon interfessier qui doit être
perpendiculaire au plan de la table est la référence. Une
amplitude normale est de l’ordre de 70° à 85°. Si elle est
inférieure à 60°, on parle de limitation de l’abduction ou de
rétraction des abducteurs. Une amplitude supérieure à 90° est
anormale ;
• tonus des adducteurs ou manœuvre en « stretch » : il est
consiste à exercer une abduction comme précédemment mais
de façon rapide mais douce. Est noté l’« angle rapide » ou
« stretch réflexe » correspondant à une amplitude d’abduction
entraînant une contraction réflexe des adducteurs perçue
comme une secousse au cours de l’abduction. Il doit être de
50° à 70° (hypertonie s’il est inférieur à 20°-45° et hypotonie
s’il est de l’ordre de 80° à 90°) ;
• rétraction des abducteurs : mesure de l’amplitude d’adduction
passive (sur l’enfant à plat ventre de façon à étendre les
hanches).
Situations cliniques
À l’issue de cet examen, il est possible de distinguer quatre
situations :
• examen normal : tous les paramètres sont normaux ;
• limitation bilatérale de l’abduction avec hypertomie symétri-
que des adducteurs ;
2
4
5
6
7
8
9
10
11
1
3
Figure 1. Vascularisation de l’extrémité supérieure du fémur. 1. Bran-
che trochantérienne de l’artère circonflexe antérieure ; 2. branche supé-
rieure de l’artère circonflexe antérieure formant avec l’artère circonflexe
postérieure l’anneau artériel extracapsulaire ; 3. artère fémorale com-
mune ; 4. artère fémorale profonde ; 5. artère circonflexe antérieure ;
6. artère circonflexe postérieure qui va contribuer à former, avec la
branche supérieure de l’artère circonflexe antérieure, l’anneau extracap-
sulaire ; 7. pédicule postéro-inférieur (ou artère capsulaire inférieure ou
artère rétinaculaire inférieure) ; 8. artère métaphysaire antérieure ;
9. branche épiphysaire d’une artère métaphysaire antérieure (ne traverse
pas le cartilage de croissance) ; 10. artère du ligament rond ; 11. pédicule
postérosupérieur (ou artère capsulaire supérieure ou artère rétinaculaire
postérosupérieure).
50°
70°
85°
50°
70°
85°
Figure 2. Tonus des adducteurs et amplitude passive d’abduction chez
un nouveau-né normal. Angle rapide (en bleu) et angle lent (en rose).
.
De la dysplasie à l’arthrose
¶
4-007-E-10
3Pédiatrie
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 06/01/2017 par SCD Paris Descartes (292681). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

• rétraction bilatérale des abducteurs avec hypotonie des
adducteurs, amplitude excessive d’abduction et limitation de
l’adduction ; il ne s’agit pas de hanches hyperlaxes puisque le
secteur de mobilité est simplement déplacé vers l’hyper-
abduction ;
• bassin asymétrique congénital
[8]
caractérisé d’un côté par une
limitation de l’abduction et hypertonie des adducteurs et de
l’autre par une abduction normale voire excessive avec
rétraction des abducteurs (Fig. 3).
Une limitation bilatérale de l’abduction ou un bassin asymé-
trique congénital sont des éléments suspects : LCH dans un cas
sur quatre en cas de limitation bilatérale d’abduction (bilatérale)
et un sur sept en cas de bassin asymétrique congénital
(unilatérale).
Posture fœtale des membres inférieurs
Cette recherche peut être réalisée lors des tout premiers jours
de vie. Elle se base sur :
• le tonus des adducteurs ;
• le flessum, le recurvatum ou la dislocation rotatoire de
genou ;
• la position des pieds ;
• l’aisance avec laquelle on replie les membres inférieurs.
Il s’agit de hanches à risque lorsqu’une des trois postures
luxantes suivantes est suspectée :
• siège décomplété avec membres inférieurs en rotation
externe ;
• genoux semi-fléchis ;
• cuisses rapprochées au contact l’une de l’autre.
Craquements
Ils sont perceptibles manuellement et parfois audibles. Ils ne
constituent pas un élément suspect.
Instabilité
Il s’agit du maître symptôme de la luxation. Elle est caracté-
risée par le fait que la tête fémorale est sortie ou peut sortir de
l’acétabulum. Les techniques de recherche sont nombreuses. Les
manœuvres classiques de Le Damany
[6]
, Palmen
[9]
ou d’Orto-
lani avec écartement/rapprochement des cuisses ne permettent
de déceler que des ressauts francs. La manœuvre de Barlow est
plus sensible
[10]
(Fig. 4).
Plusieurs conditions peuvent être rencontrées.
La hanche est « luxable » si elle est spontanément en place,
se luxe lors du test de provocation et se réduit immédiatement
lorsque l’examinateur relâche sa pression. C’est l’examinateur
qui luxe la hanche. Il peut exister un ressaut de luxation.
La hanche est « luxée réductible » si elle est spontanément
luxée, que l’examinateur peut la réduire mais qu’elle se reluxe
dès que ce dernier interrompt sa manœuvre de réduction. Il
peut exister un ressaut de réduction.
Le ressaut, sensation palpable et visible correspondant au
franchissement du bord postérosupérieur de l’acétabulum par la
tête fémorale, est un signe inconstant accompagnant l’instabi-
lité. Il disparaît si l’obstacle est plus ou moins émoussé,
remplacé par la perception d’un piston qui est beaucoup plus
subtile (Fig. 5).
L’examen en décubitus ventral permet de palper le fémur
proximal dans la fesse, témoin d’une luxation haute.
Résultats de l’examen clinique
L’examen clinique permet de retenir l’une des cinq éventua-
lités suivantes :
• hanche normale ;
• hanche luxable ;
• LCH réductible car :
Chypertonie des adducteurs ;
Climitation de l’abduction ;
Cinstabilité mais réductibilité lors des manœuvres ;
• LCH irréductible car :
Chypertonie des adducteurs ;
Climitation de l’abduction ;
Cirréductibilité lors des manœuvres ;
• hanches suspectes car :
Chypertonie des adducteurs ;
Climitation de l’abduction ;
Cpas d’instabilité.
Au total, à la fin de cet examen clinique : les hanches
peuvent être qualifiées de normales, luxées ou « à risque ».
Une hanche à risque est caractérisée par au moins un des
éléments de suspicion suivants :
• antécédents familiaux de LCH ;
• anamnèse : présentations en siège ou autres anomalies
générant un rétrécissement du volume utérin ;
• autres anomalies cliniques de mêmes étiologie et pathogénie :
genu recurvatum ou flessum, torticolis, metatarsus varus/
adductus ;
• anomalies cliniques : limitation de l’abduction ou tonus
excessif des adducteurs.
Dans ce cas, il convient de renouveler les examens cliniques
et d’avoir recours à des méthodes paracliniques.
Échographie
L’échographie, introduite par Graf
[11]
, n’est pas une techni-
que de dépistage, mais une aide au diagnostic en cas de signe
45°
25°
75°
A
Figure 3. Bassin asymétrique congénital (A à C) : association d’une
hypertonie-rétraction des adducteurs (B) d’un côté et d’une rétraction des
fessiers et du fascia lata (C) de l’autre côté.
4-007-E-10
¶
De la dysplasie à l’arthrose
4Pédiatrie
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 06/01/2017 par SCD Paris Descartes (292681). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

d’alerte ou d’instabilité à la période néonatale. Une prescription
lors des premiers jours de vie est discutable, car il a bien été
montré que pendant cette période il existe une instabilité
physiologique qui disparaît dans neuf cas sur dix
[10]
.
Une échographie est indiquée à l’âge de 1 mois si la hanche
est considérée comme étant à risque 5 :
• anomalie clinique ;
• antécédent familial de LCH ;
• présentation du siège (accouchement par voie basse, césa-
rienne et version tardive) ;
• autres anomalies orthopédiques (genu recurvatum, torticolis
et déformations sévères des pieds).
En plus de son innocuité, l’échographie objective les structu-
res cartilagineuses, la capsule et les plans musculaires invisibles
en radiologie. L’échographie statique avec une coupe frontale
analyse la dysplasie acétabulaire. L’échographie dynamique, sur
des coupes presque horizontales, authentifie le déplacement de
la tête fémorale au cours de manœuvres de recherche de
l’instabilité (un déplacement inférieur à 3 mm est considéré
comme non pathologique).
Que ce soit à la naissance ou dans les premiers mois, la
radiographie du bassin de face n’a qu’une valeur d’appoint car
elle ne montre que ce qui est ossifié. Or, la hanche est très
immature à cet âge et essentiellement cartilagineuse. Au titre du
dépistage néonatal, la radiographie est inutile. En revanche, elle
est indiquée à l’âge de 4 mois en cas d’anomalie clinique passée
ou présente de la hanche et dans les mêmes indications que
l’échographie à l’âge de 1 mois. Les critères d’interprétation
doivent être connus (Fig. 6, 7).
La confrontation de l’imagerie à l’examen clinique doit être
constante. En aucun cas, l’examen clinique ne doit être négligé
en faveur de l’échographie. Le dépistage clinique des hanches
instables demeure difficile et doit être répété.
Histoire naturelle de la luxation congénitale
de la hanche
[12]
La dysplasie correspond à un défaut de couverture de la tête
fémorale par l’acétabulum secondaire à une anomalie le plus
souvent de l’acétabulum et/ou de la tête, avec diminution de la
surface de contact entre ces deux structures, d’où augmentation
de la pression intra-articulaire. En l’absence de dégradation
arthrosique, la dysplasie n’entraîne pas de boiterie. Une dyspla-
sie acétabulaire expose à une dégradation arthrosique. Un des
éléments permettant de quantifier la dysplasie acétabulaire est
l’angle de Wiberg (Fig. 8). Il y a une corrélation entre la rapidité
d’apparition d’une coxarthrose et l’importance de la dysplasie
acétabulaire évaluée selon l’angle de Wiberg. Si cet angle est
inférieur à 20°, l’apparition d’une arthrose est précoce au cours
de la troisième décade de la vie. La survenue d’une arthrose
dépend aussi de la taille, du poids du sujet et de son activité.
B
C
Figure 4. Technique de recherche de l’instabilité (selon Barlow).
A. Une main bloque le bassin avec le pouce sur le pubis, l’autre tient la partie proximale du fémur en empaumant la jambe hyperfléchie sur la cuisse.
B. Il est souvent plus commode d’empaumer le bassin par une prise latérale et lorsque la main de l’examinateur est trop petite, d’empaumer directement la
face postérieure de la cuisse.
C. C’est surtout un petit mouvement de pronosupination de la main qui permet d’apprécier la stabilité de la hanche en recherchant un éventuel déplacement
antéropostérieur ou postéroantérieur.
AB
Figure 5. Schémas explicatifs de l’instabilité de hanche, faisant com-
prendre pourquoi le ressaut est inconstant.
A. Ressaut franc.
B. Pas de ressaut, mais sensation de piston.
.
De la dysplasie à l’arthrose
¶
4-007-E-10
5Pédiatrie
© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 06/01/2017 par SCD Paris Descartes (292681). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%