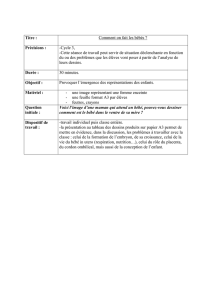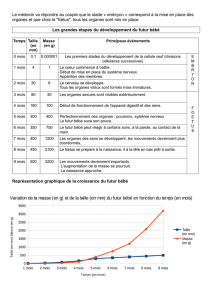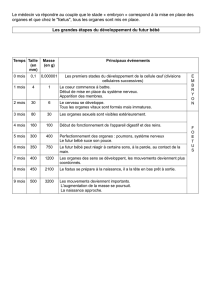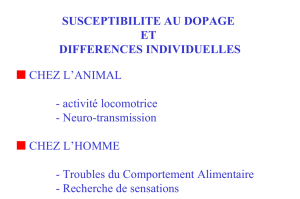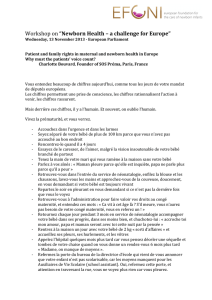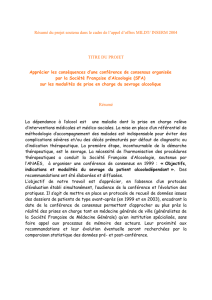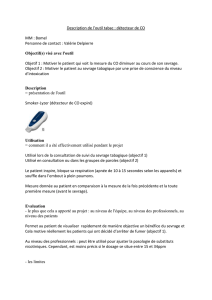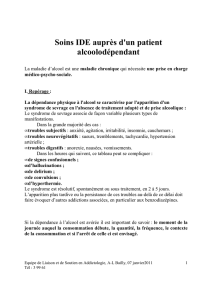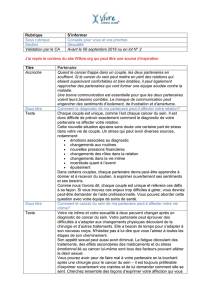Le sevrage - Ashtarout

154
ﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋ ﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋﻋ
e-mail : ashtaroutte@yahoo.com
’Ashtaroût
Cahier hors-série n° 6 (décembre 2005) ~ Matriochkas & autres Lolitas / La Chambre des enfants, pp. 154-166
ISSN 1727-2009
Melanie Klein
(1936)
Le sevrage
MELANIE KLEIN (1936) : « Weaning », repris in The
Writings of Melanie Klein, vol. I, 1975, pp. 290-305, et note
explicative pp. 434-435.
Traduction française établie par Sandra Azar, revue
avec Amine Azar & rewritée avec Laurence Klein. On y a
surtout cherché la simplicité et l’élégance. La segmentation,
les titres et les inter-titres sont le fait de la rédaction. On a
également ajouté quelques notes et une bibliographie.
I. Le cadre théorique
1. La première gratification
2. L’activité mentale la plus primitive
3. Projection & introjection
4. Objets partiels & objet total
5. Stimuli & premières coordinations corporelles
6. « Bon » & « mauvais » sein
7. Le sadisme
8. La culpabilité
9. Réparation & cadeaux
10. Phantasme & réalité
II. Le sevrage
11. Perte, frustration & privation
12. La petite Rita
III. La mère suffisamment bonne
13. Un bon contact
14. Patience & compréhension
15. L’intervalle entre les prises alimentaires
16. L’usage de la tétine
17. Sevrage du pouce & masturbation
18. L’apprentissage de la propreté
19. Le nursage
20. Favoriser l’autonomie de l’enfant
21. Ne pas chercher à accélérer sa croissance
22. Développement sexuel & séduction
23. Faire dormir le bébé dans sa chambre
24. Comment pratiquer le sevrage du sein
25. Les bébés n’ayant pas été allaités
26. Sur l’échec d’une adaptation véritable
27. « Weaning from » & « weaning to »
NOTE EXPLICATIVE
des éditeurs anglais
Il s’agit ici de la contribution de Melanie Klein à
un cycle de conférences publiques données par des
psychanalystes. Cette série de conférences a été pub-
liée en 1936 dans un petit livre Sur la Manière d’élever
les enfants (On Bringing up children). En 1952, lors de la
parution de la seconde édition, Melanie Klein a ajou-
té une préface et une postface.
Initialement, dans « Les principes psychologiques de
l’analyse précoce » (1926), Melanie Klein avait décrit le
sevrage comme un traumatisme inaugurant le com-
plexe d’Œdipe, considérant que la frustration infligée
par la mère nourricière détournait l’enfant d’elle et le
tournait vers son père. Plus tard, dans son étude inti-
tulée « Une contribution à la psychogenèse des états maniaco-
dépressifs » (1935), étude où elle a exposé sa théorie
subséquente sur la position dépressive, elle a éclairé le
sevrage différemment. Le sevrage est alors défini
comme étant par excellence la perte totale du premier
bon objet externe de l’enfant, perte qui porterait à
leur apogée les émotions et les conflits de la position
dépressive. En même temps, le sevrage, s’il était réus-
si, donnerait un élan positif à l’acceptation de subs-
tituts et à la découverte de sources de gratification
plus larges.
De ces nouvelles conceptions, Melanie Klein
donne une présentation vivante et dépourvue de
technicité et, comme il convient à un guide pratique
pour élever les enfants, elle y inclut des conseils
psychologiques sur les problèmes de l’éducation des
tout petits. Elle compare brièvement le sein et le
biberon, sujet qu’elle aborde de manière plus appro-
fondie dans la première note de son étude « En obser-
vant le comportement de jeunes enfants » (1952). Dans la
deuxième elle revient encore au thème du sevrage.

155
I.
Le cadre théorique
La première
gratification
La découverte par Freud de l’existence d’une par-
tie inconsciente de l’esprit dont le noyau est
formé dans l’enfance la plus précoce est l’une des
découvertes les plus fondamentales et les plus pro-
fondes jamais faites dans l’histoire de l’humanité.
C’est ainsi que les sentiments et les phantasmes
1
infantiles laissent leurs marques sur l’esprit, marques
indélébiles qui sont emmagasinées, demeurant actives
et exerçant une influence continue et puissante sur la
vie émotionnelle et intellectuelle de l’individu. Les
sentiments les plus précoces sont éprouvés en liaison
avec des stimuli extérieurs et intérieurs. La première
gratification que l’enfant retire du monde extérieur
est la satisfaction éprouvée à être nourri. La psycha-
nalyse a montré que seulement une partie de cette
satisfaction procède de l’allègement de la faim et
qu’une autre partie, non moins importante, procède
du plaisir que le bébé éprouve quand sa bouche est
stimulée par la succion du sein de sa mère. Cette gra-
tification est une partie essentielle de la sexualité in-
fantile, et de fait c’est même son expression initiale.
Le plaisir est aussi éprouvé lorsque le lait chaud coule
le long de la gorge et remplit l’estomac.
L’activité mentale
la plus primitive
Le bébé réagit aux stimuli déplaisants, et à la
frustration de son plaisir, par des sentiments de
haine et d’agression. Ces sentiments de haine sont
dirigés contre les mêmes objets que ceux du plaisir, à
savoir les seins de la mère. Le travail psychanalytique
a montré que les bébés âgés de quelques mois seule-
ment s’adonnent déjà à la construction de phantas-
mes. Je crois qu’il s’agit là de l’activité mentale la plus
primitive et que les phantasmes existent dans l’esprit
de l’enfant presque dès la naissance. Il semblerait que
des phantasmes répondent immédiatement à chaque
stimulus que l’enfant reçoit. Aux stimuli déplaisants,
1
[Orthographe kleinienne signifiant qu’il s’agit d’un fantasme in-
conscient.] (NdT)
y compris la simple frustration, répondent des phan-
tasmes d’un genre agressif ; aux stimuli gratifiants,
ceux centrés sur le plaisir.
Projection
& introjection
Comme je l’ai déjà dit, l’objet de tous ces phan-
tasmes est, en premier lieu, le sein de la mère. Il
peut paraître curieux que l’intérêt très minime dont
dispose le tout petit enfant soit restreint à une partie
seulement de la personne plutôt qu’à sa totalité. Il
faut garder à l’esprit qu’à ce stade l’enfant n’a qu’une
capacité de perception extrêmement peu développée,
au physique comme au mental, et le fait le plus
important est qu’il n’est concerné que par l’obtention
ou par la privation d’une gratification immédiate.
Freud a dénommé cela le « principe de plaisir-
déplaisir ». Ainsi, le sein de la mère qui donne ou
refuse la gratification devient dans l’esprit de l’enfant
imprégné des caractéristiques du bien et du mal. Par
conséquent, ce qu’on pourrait nommer le « bon » sein
devient le prototype de ce qui est ressenti tout au
long de la vie comme bon et bienfaisant, alors que le
« mauvais » sein tient lieu de tout ce qui est mal et
persécuteur. La raison en est que, lorsque l’enfant
tourne sa haine contre le sein rejetant ou « mauvais »,
il attribue au sein lui-même toute sa propre haine
active contre lui Ŕ ce processus est appelé projection.
Mais il y a un autre processus de grande impor-
tance se déroulant parallèlement et que l’on nomme
introjection. Ce terme définit l’activité mentale par
laquelle l’enfant, dans son phantasme, prend à l’inté-
rieur de lui-même tout ce qu’il perçoit dans le monde
extérieur. Nous savons qu’à ce stade l’enfant reçoit sa
satisfaction principale par l’intermédiaire de la bou-
che, qui devient de ce fait le canal principal par lequel
l’enfant prend à l’intérieur de lui-même non seule-
ment sa nourriture, mais aussi, dans son phantasme,
le monde qui lui est extérieur. Ce n’est pas seulement
la bouche, mais jusqu’à un certain point le corps tout
entier avec tous ses sens et toutes ses fonctions, qui
accomplit ce processus de « prendre à l’intérieur de
soi ». Ŕ Par exemple, l’enfant prend en soi en respi-
rant, prend en soi à travers les yeux, les oreilles, le
toucher, etc. Au début, le sein de la mère est son
constant objet de désir, et par conséquent la première
1
2
3

156
chose à être introjectée. Dans son phantasme l’enfant
suce le sein à l’intérieur de lui, le mâche et l’avale.
Ainsi, il ressent qu’il l’a effectivement pris à l’intérieur
de lui, qu’il possède le sein de sa mère en lui-même
avec ses bons et ses mauvais aspects.
Objets partiels
& objet total
La concentration et l’attachement de l’enfant à
une partie seulement de la personne sont caracté-
ristiques de cette étape précoce du développement, et
rendent compte en grande partie de la nature phan-
tastique
1
et irréelle de sa relation à toute chose, par
exemple, à des parties de son propre corps, aux gens,
aux objets inanimés, à toutes ces choses qui sont bien
sûr au début seulement perçues faiblement. Dans les
deux ou trois premiers mois de la vie de l’enfant, son
monde objectal pourrait être décrit comme constitué
de portions gratifiantes, hostiles ou persécutives, du
monde réel. C’est environ à cet âge qu’il commence à
voir sa mère et les autres autour de lui comme des
« personnes entières ». La perception réaliste qu’il a
d’elle (et d’eux) se développe progressivement pen-
dant qu’il relie le visage de sa mère qui le regarde avec
les mains qui le caressent et avec le sein qui le satis-
fait. La faculté de percevoir « des touts », (une fois
qu’il est parvenu à éprouver du plaisir pour des per-
sonnes entières en qui il se met à avoir confiance),
s’étend au monde extérieur au-delà de la mère.
Stimuli& premières
coordinations corporelles
À ce moment-là, d’autres changements ont égale-
ment lieu chez l’enfant. Lorsque le bébé est âgé de
quelques semaines, on peut observer qu’il commence
vraiment à apprécier certains moments de sa vie
éveillée. Et, si l’on en juge d’après les apparences, il y
a des moments où il se sent vraiment heureux. Il
semble qu’à cet âge les stimuli localisés trop puissants
diminuent (au début, par exemple, la défécation est
souvent ressentie comme déplaisante), et une meil-
leure coordination commence à s’établir dans l’exer-
cice des différentes fonctions corporelles, Ŕ ce qui
entraîne non seulement une meilleure adaptation
1
[Orthographe kleinienne signifiant qu’il s’agit d’un fantastique
issu de l’inconscient.] (NdT)
physique mais aussi une meilleure adaptation mentale
aux stimuli externes et internes. On suppose que les
stimuli ressentis au début comme étant douloureux,
cessent de l’être et que certains d’entre eux sont
même devenus agréables. Le fait que l’absence de sti-
muli puisse alors être ressentie comme un plaisir en
soi, indique que l’enfant n’est plus trop gouverné par
des sensations douloureuses provoquées par des
stimuli déplaisants, ni aussi avide de stimuli agréables
associés à la gratification immédiate et complète pro-
curée par l’ingestion de nourriture. Sa meilleure adap-
tation aux stimuli rend la nécessité d’une satisfaction
immédiate et forte moins urgente
2
.
Je me suis référée aux premiers phantasmes et
aux premières peurs de persécution liés aux seins
hostiles, et j’ai expliqué comment ils sont connectés à
la relation d’objet phantasmatique du tout petit en-
fant. Les premières expériences que l’enfant fait des
stimuli douloureux externes et internes fournissent
une base à la constitution de phantasmes concernant
des objets hostiles externes et internes, et contribuent
largement à leur construction
3
.
« Bon » &
« mauvais »sein
Durant l’étape la plus précoce du développement
mental chaque stimulus déplaisant est apparem-
ment relié dans le phantasme du bébé au sein hostile
ou rejetant. Inversement, chaque stimulus agréable
est en relation au « bon » sein gratifiant. Il semble que
nous ayons ici deux cercles, l’un bienveillant, l’autre
malveillant, tous les deux fondés sur l’interaction de
facteurs externes (environnementaux) et internes
(psychiques). Ainsi, la force des phantasmes de natu-
re effrayante devrait diminuer soit par une baisse
quelconque de la quantité ou de l’intensité des stimuli
douloureux, soit par une augmentation de l’aptitude
de l’enfant à s’y ajuster. À son tour, la diminution en
intensité des phantasmes effrayants lui permet
d’avancer petit à petit vers une meilleure adaptation à
2
En cette connexion je me rappelle d’un commentaire fait ré-
cemment par le Dr Edward Glover. Il a signalé que le change-
ment brusque entre sensation très douloureuse et sensation très
agréable pourrait être ressenti comme douloureux en soi.
3
Le Dr Susan Issacs a souligné l’importance de ce point dans une
communication à la British Psycho-Analytical Society (janvier, 1934).
4
5
6

157
la réalité, contribuant ainsi à la diminution de ces
phantasmes.
Il est important pour le bon développement de
l’esprit de l’enfant qu’il puisse se placer sous l’influen-
ce du cercle bienveillant que je viens de définir. Cela
l’aidera considérablement à se forger une image de sa
mère en tant que personne. Cette perception crois-
sante de la mère comme un tout implique non seule-
ment un changement très important dans son déve-
loppement intellectuel mais aussi dans son dévelop-
pement émotionnel.
Le sadisme
J’ai déjà mentionné que des phantasmes et des
sentiments de nature agressive et de nature éroti-
que gratifiante, qui sont dans une large mesure con-
fondus (fusion appelée sadisme), jouent un rôle pré-
pondérant dans la vie précoce de l’enfant. Ils sont
tout d’abord centrés sur les seins de sa mère, mais ils
s’étendent graduellement à tout son corps. Les phan-
tasmes et les sentiments d’avidité érotiques et des-
tructeurs ont pour objet l’intérieur du corps de la
mère. En imagination, l’enfant l’attaque, lui dérobe
tout son contenu et le dévore
1
.
Au début, les phantasmes de destruction sont
essentiellement de type succion. Ceci se manifeste
par la fougue avec laquelle certains enfants tètent,
même lorsque le lait est abondant. Plus l’enfant ap-
proche du moment où ses dents vont couper, plus
ses phantasmes sont de mordre, de déchirer, de mas-
tiquer et donc de détruire leur objet. Beaucoup de
mères constatent, longtemps avant la percée dentaire,
que l’enfant a des tendances à mordre. L’expérience
psychanalytique a prouvé que ces tendances s’accom-
pagnent de phantasmes de nature franchement can-
nibale. L’analyse des tout petits montre que le carac-
tère destructeur de tous ces phantasmes et sentiments
sadiques bat son plein quand l’enfant commence à
percevoir sa mère comme une personne entière.
1
[Rappelons que pour Melanie Klein (1930) : « À l’intérieur du
corps de la mère, l’enfant s’attend à trouver : (a) le pénis du père,
(b) des excréments, et (c) des enfants, toutes ces choses étant assi-
milées à des substances comestibles. » Cf. Essais de psychanalyse,
trad. franç., p. 263.] (NdT)
En même temps il éprouve alors un changement
dans son attitude émotionnelle envers sa mère.
L’attachement agréable pour le sein se transforme en
des sentiments envers elle en tant que personne. Ces
sentiments à la fois d’amour et de destruction sont
éprouvés envers une seule et même personne, don-
nant lieu à des conflits profonds et troublants dans
l’esprit de l’enfant.
La culpabilité
Il est, à mon avis, très important pour l’avenir de
l’enfant de pouvoir être capable d’évoluer des pre-
mières peurs de persécution et d’une relation d’objet
phantasmatique à une relation avec la mère comme
une personne totale et un être aimant. Cependant,
quand il y réussit, des sentiments de culpabilité sur-
gissent en relation avec ses propres impulsions des-
tructrices, qu’il craint maintenant d’être un danger
pour l’objet aimé. Le fait qu’à ce stade du dévelop-
pement l’enfant soit incapable de contrôler son sadis-
me, lequel jaillit à toute frustration, aggrave davantage
le conflit et l’inquiétude que l’enfant ressent à l’égard
de la personne aimée. Encore une fois, il est très
important que l’enfant puisse gérer de manière satis-
faisante les sentiments conflictuels Ŕ amour, haine et
culpabilité Ŕ qui surgissent dans cette nouvelle situa-
tion. Si les conflits se révèlent intolérables, l’enfant ne
peut établir un rapport heureux avec sa mère, ouvrant
ainsi la voie à beaucoup d’échecs dans le dévelop-
pement ultérieur. Je pense en particulier aux états de
dépression injustifiés ou anormaux qui prennent à
mon avis leur origine profonde dans l’échec de la
bonne gestion de ces premiers conflits.
Réparation &
cadeaux
Considérons maintenant ce qui se passe quand les
sentiments de culpabilité et de peur pour la mort
de sa mère (qui est redoutée comme résultat de ses
souhaits de mort inconscients à son égard) sont adé-
quatement gérés. Ces sentiments ont, je pense, des
effets à long terme sur le bien être mental futur de
l’enfant, sur sa capacité d’aimer et sur son dévelop-
pement social. À partir d’eux jaillit le désir de restaurer,
7
8
9

158
qui s’exprime par de nombreux phantasmes de sauve-
tage et de réparation de toute sorte. Ces tendances à
réparer que j’ai trouvées dans l’analyse des petits
enfants sont les forces motrices dans toutes les
activités constructives, dans tous les intérêts, et dans
le développement social. Nous les trouvons à l’œuvre
dans les premières activités de jeu et à la base de la
satisfaction que l’enfant ressent dans ses propres
exploits (achievements), même les plus simples, par
exemple le fait d’empiler des cubes, ou de les remet-
tre d’aplomb Ŕ tout cela est partiellement dérivé du
phantasme inconscient d’effectuer une sorte de res-
tauration à une ou plusieurs personnes qu’il aurait
blessées dans ses phantasmes. De surcroît, je pense
que, même les tous premiers exploits du bébé, tels
que jouer avec ses doigts, retrouver quelque chose
qui a roulé de côté, se mettre debout et effectuer
toutes sortes de mouvements volontaires Ŕ tout cela
est aussi connecté à des phantasmes où l’élément de
la réparation est déjà présent.
L’analyse des tous petits (récemment, même des
enfants entre un et deux ans ont été analysés) montre
que les bébés âgés de quelques mois relient leurs
selles et urines à des phantasmes dans lesquels ces
matières sont considérées comme des cadeaux. Ce
sont non seulement des cadeaux et, en tant que tels,
des marques d’amour envers la mère ou la nourrice,
mais aussi des moyens de restauration. Inversement,
quand les sentiments de destruction sont dominants,
le bébé dans son phantasme va déféquer et uriner en
colère et avec haine, et utiliser ses excréments comme
des produits hostiles. Ainsi les excréments produits
avec des sentiments amicaux sont, dans les phan-
tasmes, utilisés comme un moyen pour soigner les
blessures infligées par les selles et les urines dans les
moments de colère.
Il est impossible dans les limites de ce travail
d’étudier en profondeur le lien entre les phantasmes
agressifs, les peurs, les sentiments de culpabilité et le
souhait de réparation. Néanmoins, j’ai abordé ce sujet
parce que je voulais montrer que les sentiments
agressifs, qui mènent à tant de troubles dans l’esprit
de l’enfant, sont également de la plus haute impor-
tance pour son développement.
Phantasme & réalité
J’ai déjà mentionné que l’enfant prend menta-
lement en lui-même Ŕ introjecte Ŕ le monde
extérieur dans la mesure où il peut le percevoir. Dans
un premier temps il introjecte le bon et le mauvais
sein, mais progressivement c’est toute la mère (égale-
ment conçue comme une bonne et une mauvaise
mère) qu’il prend en lui-même, et dans la foulée le
père et les autres personnes de son entourage, mais
cela à un moindre degré au début. Ces figures gran-
dissent en importance et acquièrent au fil du temps
une indépendance dans l’esprit de l’enfant. Si l’enfant
réussit à établir en lui-même une mère gentille et
secourable, cette mère intériorisée se révèlera d’une
influence hautement bénéfique pendant toute sa vie.
En dépit du fait que cette influence va normale-
ment changer de caractère avec le développement de
l’esprit, elle restera comparable à la place vitale que la
vraie mère a dans l’existence même du petit enfant. Je
ne veux pas dire par là que les bons parents « intério-
risés » vont consciemment être ressentis comme tels,
(même chez le petit enfant le sentiment de les pos-
séder en lui est profondément inconscient). Ils ne
sont pas ressentis consciemment comme étant à
l’intérieur, mais plutôt comme un élément constitutif
de la personnalité, de l’ordre de la gentillesse et de la
sagesse (kindness and wisdom). Ce processus conduit à
une assurance et une confiance en soi-même, et aide
à combattre et à vaincre les sentiments de peur
d’avoir de mauvaises figures à l’intérieur de soi et
d’être gouverné par sa propre haine incontrôlable. De
plus, au-delà du cercle familial, cela mène à avoir
confiance dans les personnes du monde extérieur.
II.
Le sevrage
Perte, frustration
& privation
Comme je l’ai déjà montré plus haut, l’enfant
ressent de manière très aiguë toute frustration.
En dépit du fait que des progrès dans le sens de
l’adaptation à la réalité se poursuivent en permanen-
ce, la vie émotionnelle de l’enfant apparaît dominée
par le cycle des gratifications et des frustrations. Mais
10
11
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%