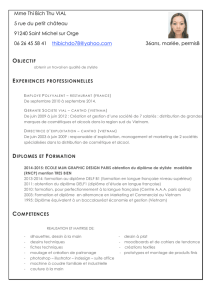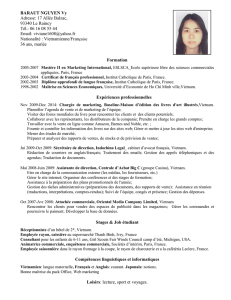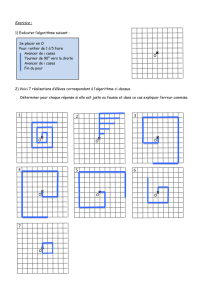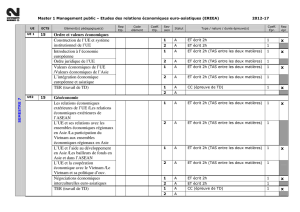de la SOciétéFrançaise d`Orthopédie Pédiatrique

octobre - novembre 2011 - Commission paritaire en cours - N° ISSN en cours
Bureau de la SOFOP
Président : C. Bo n n a r d - 1er Vice-Président : C. ro m a n a - 2e Vice Président : J. Le C h e v a L L i e r - Fu t u r 2e Vice Président : C. Ka r g e r
Ancien Président : C. mo r i n - Secrétaire Général : J.L. Jo u v e - Trésorier : P. La s C o m B e s
Membres du Bureau : B. de Bi L L y , F. Ch o t e L , a Ka e L i n , P ma r y , J. sa L e s d e ga u z y (so F C o t ), P Wi C a r t
la Gazette est dorénavant publié en format A4, an d’être directement imprimée
à partir de votre ordinateur via notre adresse www.saurampsmedical.com
Fondateur
J.C. POULIQUEN †
Editorialiste
H. CARLIOZ Paris)
Rédacteur en chef
C. MORIN (Berck)
Membres
J CATON (Lyon)
P CHRESTIAN (Marseille
G FINIDORI (Paris)
J L JOUVE (Marseille
R KOHLER (Lyon)
P LASCOMBES (Nancy)
G F PENNEÇOT (Paris)
M RONGIERES (Toulouse)
J SALES DE GAUZY (Toulouse)
R VIALLE (Paris)
et le GROUPE OMBREDANNE”
Correspondants étrangers
M BEN GHACHEM (Tunis)
R JAWISH (Beyrouth)
I. GHANEM (Beyrouth)
Editeur
SAURAMPS MEDICAL
S.a.r.l. D. TORREILLES
11, boulevard Henri IV
CS 79525
34960 MONTPELLIER Cedex 2
Tél. : 04 67 63 68 80
Fax : 04 67 52 59 05
La Gazette
de la SOciété Française d’Orthopédie Pédiatrique
N°34
Editorial SO.F.O.P.
L’ARC EN CIEL
C’est le drapeau du GEOP, comme dirait
Nelson Mandela ! Ouvert aux enfants
de tous les pays, de toutes origines reli-
gieuses ou ethniques.
Les Anciens, ceux qui ont créé le GEOP
avaient déni sa feuille de route à
Palavas : développer l’orthopédie pé-
diatrique, lui donner une légitimité
scientique et enseigner cette disci-
pline à tous, non seulement aux étu-
diants francophones mais aussi aux
étudiants étrangers. Ces fondateurs, à
qui nous devons tout, ont sillonné le
monde d’Abidjan à Téhéran, d’Alger à
Lima, de Beyrouth à Montévidéo.
Les relations internationales sont la
force motrice de notre société. Il s’agit
de faire connaître les travaux scien-
tiques mais aussi de développer un
savoir faire chirurgical singulier. Notre
discipline est au cœur de l’essentiel,
au cœur de la vie et de l’avenir de nos
enfants.
C’est dans cet esprit qu’est née la mis-
sion au Vietnam. Le Docteur Desgrip-
pes a eu le grand mérite d’initier cette
mission.
Après La Chaîne De l’Espoir, Children
Action, grâce au soutien précieux, in-
faillible de Mr Bernard Sabrier, cette
mission a pu se poursuivre. Elle est de-
venue Franco-Suisse. Ce partenariat a
enrichi nos relations. Mais rien de tout
cela n’aurait été possible sans Mme Phi
et Mme Giang, ces combattantes de
l’armée de l’ombre, qui toujours entou-
raient familles et enfants d’un amour
quasi maternel.
Il s’agit d’une mission humanitaire
unique au monde, exemplaire : elle
s’appuie sur des chirurgiens de haut
niveau, un support logistique très
élaboré et surtout, ce qui fait sa force
et son originalité, une continuité sans
relâche. Avec Yersin et Pasteur, avec
Dunant et Eiel, la France et la Suisse,
se sont retrouvées au Vietnam.
Avec nos amis vietnamiens, nous
avons fait plus que travailler ensemble.
Nous avons partagé des émotions, des
fêtes et aussi de grands chagrins après
le décès du père de l’orthopédie pé-
diatrique vietnamienne le professeur
Phung. Avec le temps, nous sommes
devenus une famille.
Chaque année, notre retour est un ri-
tuel chaleureux et fertile en échanges.
Le Vietnam fait partie de notre espace
aectif. Autour de cette mission, des
amitiés très fortes se sont construites.
Quel bonheur de constater chaque
année les progrès de l’orthopédie pé-
diatrique vietnamienne. Quelle satis-
faction d’assister au développement
spectaculaire de ce pays. Avec André
Kaelin, l’année dernière, nous avons
partagé une grande émotion. Nous
avons été invités à consulter et opérer
des enfants à Nhi Dong2 : un hôpital
magnique, un très long rectangle de
trois étages, avec des couloirs lumi-
neux ouverts sur de grands jardins, des
salles d’opérations spacieuses. Un hô-
pital avec une architecture moderne,
d’avant garde. Quelle n’a pas été notre
surprise d’apprendre que cet hôpital
avait été construit il y a plus d’un siè-
cle par Eiel ! Après la Poste de Saïgon,
après le pont sur le Mékong, Eiel avait
donc marqué de son empreinte ce
pays… ! Et après tant de turbulences
historiques, la vie, l’amitié, la fraternité
ont repris leurs cours avec les chirur-
giens de Children Action.
Mille mercis à Bernard Sabrier de sou-
tenir moralement, nancièrement
cette mission Franco -Suisse. Mais les
actions humanitaires de notre société
sont multiples, elles ne s’arrêtent pas
au Vietnam. Certains se sont investis
en Côte d’Ivoire, d’autres à Kaboul,
d’autres en Birmanie, d’autres à Gaza,
à Haïti, d’autres en Afrique du Nord.
Combien de chirurgiens étrangers ont
été accueillis et formés dans nos ser-
vices ? Ces actions sont nos plus belles
lettres de noblesse.
Ensemble, nous partageons les mêmes
valeurs morales, les mêmes idéaux,
nous puisons notre énergie dans la fra-
ternité, l’humanisme et la solidarité.
Ensemble, nous regardons dans la
même direction. Notre métier nous
élève. Il fait de nous des citoyens du
monde. Les enfants sont notre préoc-
cupation quotidienne, notre obses-
sion permanente. La Société Française
d’Orthopédie Pédiatrique a fait sienne
cette citation de Saint-Exupéry:
« Etre homme, c’est être responsable,
c’est sentir en posant sa pierre que
l’on contribue à bâtir le monde ».
Pr A. Diméglio
Sommaire
Trois rencontres avec Alexandre Yersin ......2
par P.-Y. Zambelli
Missions orthopédiques au Vietnam
Comment ça marche ? ......................................5
par M. Dutoit
Mission «Children Action» au Vietnam .......8
par A. Kaelin
Des opérations pour guérir
et apprendre à soigner
Missions orthopédiques au Vietnam ........ 13
par B. Sabrier, S. Kolly
Chirurgie de la scoliose au Myanmar ....... 15
par J. Sales de Gauzy, JL Jouve,
Zaw Wai Soe
Mission pédiatrique en Bulgarie ................ 17
par B. Fragnière
Orthopédie pédiatrique
à l’hôpital Mère Enfant «Le Luxembourg»
à Bamako (Mali) ................................................ 18
par C. Bronfen, L. Marcucci, G. Pierrard,
B. Her, P. Cuny, P. Besnard, A. Simaga
MSF et l’activité chirurgicale
traumatologique ............................................. 19
par P. Hérard

2
Trois rencontres avec Alexandre Yersin
par Pierre-Yves Zambelli
Alexandre Yersin (1863-1943)
Photo de Pierre Lanith Petit (Coll. Musée d’Orsay)
Fig. 1: la rue du Docteur Yersin à Morges,
commune suisse du canton de Vaud
Gamin, je me souviens alors, un de mes meilleurs amis habi-
tait, tout comme moi, la charmante ville de Morges (Fig. 1).
Son père vétérinaire résidait à la rue du Dr Yersin. Mon esprit
d’enfant, et naturellement simplicateur, t l’amalgame en-
tre le Dr Willi, le vétérinaire, et le Dr Yersin. Cela devait être le
grand-père me disais-je !
Plus tard au l de ma scolarité, je compris que le Dr Yersin
n’avait pas grand-chose à voir avec le père de mon ami et
je compris que A. Yersin avait dû être un grand médecin et
de plus une gure Morgienne notable. Il faut dire que nos
parents, à l’époque, s’occupaient de politique locale et que
tout ce qui était Morgien était par axiome au dessus de la
norme. Durant notre éducation secondaire, l’histoire nous
enseigna le cataclysme des grandes épidémies de peste qui
ravagèrent l’Europe ; la peste noire du milieu du 14ème siècle
puis la peste de Londres au 17ème et celle de Marseille au dé-
but du 18ème laissant des édices au Tessin et au sud de la
France qui bornaient les limites de la contagion. Pas trop at-
tiré par la précision historique, j’avais résumé dans mon es-
prit que la bonne ville de Morges avait été aectée par une
de ces épidémies et j’imaginais que Yersin avait contribué à
la découverte de l’agent causal de cette maladie, ainsi que
son traitement. La diérence de date entre les épidémies
du Moyen âge et la vie beaucoup plus contemporaine de
A. Yersin (1863-1943) ne m’avait pas particulièrement inter-
pellé. Ma première rencontre avec le personnage s’arrête là,
A. Yersin avait été un grand homme, médecin et de surcroît
de Morges, ville de mon enfance et de mes origines.
Il ne m’en fallait pas plus.
Ma seconde rencontre avec A. Yersin, fut durant mes études
de médecine. Pas tant grâce aux bases de microbiologie en-
seignées durant le cursus, qui par ailleurs ne me fascinaient
guère, mais principalement car la faculté de médecine de
Lausanne comptait un auditoire A. Yersin. Je m’étais souvenu
de ce médecin Morgien qui, non seulement avait son nom
sur une plaque d’une rue de la ville de mon enfance, mais
qui en plus avait un auditoire qui portait son nom. Cepen-
dant, mes études me passionnaient et dans les innombra-
bles notions et concepts ingurgités pour la préparation des
examens propédeutiques, il y avait une petite place pour
Yersinia Pestis, la bactérie ou plutôt le bacille découvert par
A. Yersin. Je crois que mes souvenirs qui remontent à une
trentaine d’années, gardaient l’idée assez imprécise que la
peste n’était certes plus un problème de santé publique ac-
tuelle, que Yersin l’avait découverte en Indochine. Je m’étais
en ce temps interrogé sur ses conditions de travail là-bas,
me demandant dans quel laboratoire il avait pu œuvrer et
avec quel microscope et qualité d’image il avait pu travailler.
Yersin ne m’avait pas trop marqué comme personnage, mais
il devenait associé clairement à Yersinia Pestis, l’agent causal
de la peste. La peste, dont les formes cliniques buboniques
pulmonaires et septicémiques, ne laissait que peu de chan-
ce de survie au patient en ces temps reculés. Le bacille est
un coccobacille à la coloration bipolaire. On le retrouve en
grande quantité dans les bubons qui correspondent à l’in-
ammation aiguë d’un ganglion situé sur le premier relais
de drainage. Les bubons sont localisés classiquement à l’aine
voire dans le creux axillaire. C’est au niveau de cette lésion
ganglionnaire que l’on trouve, dans une purée de pus, des
germes en grande quantité. Les formes cliniques pulmonai-
res ou septicémiques conduisent rapidement au décès du
patient dès que le relais ganglionnaire est dépassé. Yersinia
pestis est hautement pathogène pour les petits rongeurs,
notamment les rats. C’est d’ailleurs le réservoir principal. La
propagation de l’infection est le fait des ectoparasites du rat
soit les puces (Xenopsylla cheopsis). Lorsque les rats attei-
gnent un état de surpopulation en déséquilibre, ils meurent
en grand nombre et les puces, aidées par des conditions
d’hygiène très précaires à l’époque, pouvaient alors conta-
miner de manière massive les populations des villes portuai-
res où les rats pullulaient. L’homme devenait alors un hôte
inhabituel pour ces puces en mal de rats survivants.

3
Ainsi les grandes épidémies de peste purent se déclarer
avec les conséquences que l’histoire nous conte, d’autant
que la mortalité de l’infection non traitée est de l’ordre de
80-90 %.
Par la suite, dans le cadre de ma formation en chirurgie or-
thopédique, je dois avouer que la peste ne fut qu’un vague
souvenir de bachotage et je n’imaginais pas être confronté à
nouveau à A. Yersin, autrement que lors de cours que je don-
nais dans l’auditoire portant son nom (Fig. 2) ou en passant,
sans trop y penser, par la rue A. Yersin à Morges.
Plus tard, lors de missions en collaboration avec Children
Action où j’ai accompagné Christian Morin à 7 reprises au
Vietnam, Alexandre Yersin est revenu au présent, surpris
de rencontrer une large avenue portant son nom à Hô-Chi-
Minh City (Fig. 3) et apprenant qu’il était mort à Nah-Trang
une ville localisée plus au Nord.
De plus cette ville possède un musée à son egie. En plai-
santant avec Ch. Morin, je lui disais alors ma erté de savoir
que Yersin était de Morges tout comme moi et en se bala-
dant en n de journée dans Hô-Chi-Minh City, je suis tombé
sur le Livre de Roux qui, par son intitulé, semblait donner
une vision un peu diérente ou originale du personnage. Je
l’ai dévoré lors de notre retour dans l’avion et deux ans plus
tard, j’ai eu l’envie de corriger mon ignorance du passé et de
vous parler de ma troisième rencontre avec A. Yersin.
D’abord contrairement à ce que l’on peut lire dans le texte
de Pierre Le Roux, Yersin n’est pas né dans le Lavaux, mais
à Aubonne une ville de La Côte sur les berges du Léman à
une dizaine de kilomètres de Morges. Sa famille maternelle
protestante, originaire des Cévennes, était venue s’y instal-
ler à la révocation de l’édit de Nantes. Son père, prénommé
aussi Alexandre, était intendant des poudres de la Suisse
romande et professeur de sciences naturelles aux collèges
de Morges et d’Aubonne. Le père d’Alexandre décédera peu
avant sa naissance et sa mère s’installera à Morges pour y
élever ses trois enfants. A 19 ans en 1882, il obtient son bac-
calauréat es lettres et débutera ses études à Lausanne à la
faculté de médecine, il les poursuivra à Marburg puis à Paris.
Sous l’égide d’Emile Roux, il intègre l’institut Pasteur et s’il-
lustre par des découvertes en collaboration sur la diphtérie.
En 1889, il défend sa thèse sur la tuberculose expérimentale
et obtient la nationalité française l’année suivante. Il suit le
cours de bactériologie de Robert Koch à Berlin et, promis
à un brillant avenir au sein de l’institut Pasteur, de manière
assez surprenante, il obtient un titre de médecin des Messa-
geries Maritimes et quitte Paris pour l’Indochine française.
Nul ne sait exactement les raisons de ce revirement, certains
arguent qu’il était tombé amoureux de la mer lors d’un sé-
jour en Normandie, mais il est fort possible que cet homme
jeune de 27 ans était un passionné, à l’esprit inventif et très
ouvert, certainement très indépendant et qu’il eut besoin de
prendre un peu de distance. Il dut ressentir le besoin d’in-
connu, de mener sa barque de manière libre, peu attiré par
les honneurs de la science ou de la capitale.
Yersin n’était certainement pas très facile à vivre et surtout
très têtu dans la volonté de réaliser ses idées en soit nom-
breuses.
Après des péripéties tant administratives que pratiques, il
obtient de se lancer dans des expéditions qui lui permet-
tront de découvrir les terres inconnues de la région centrale
de Vietnam. Lors de la première expédition en terrain très
dicile, composé de euves tumultueux et d’une jungle
hostile, il découvre Nha-Trang auquel il s’attache. Lors de ces
expéditions, il observe, note, consigne des données scienti-
ques très diverses. Il se montre un scientique ouvert aussi
bien attiré par la cartographie, la géologie, l’étude de la fau-
ne et de la ore. Mais, il analyse aussi les populations indigè-
nes, leurs modes de vie avec de nombreuses réexions sur
l’agronomie et l’hygiène de ces peuples faisant de Yersin un
anthropologue averti. Ses explorations sont saluées par les
autorités et la corporation scientique.
Médecin-explorateur, il se rend à Hong Kong pour tenter
d’apporter quelques lumières et une aide face à l’épidémie
de peste descendue de Mongolie touchant les côtes sud de
la Chine. On ne sait si il a été envoyé comme il le prétend
Trois rencontres avec Alexandre Yersin
par Pierre-Yves Zambelli
Fig. 2 : l’auditoire A. Yersin à la faculté de médecine de Lausanne
Fig. 3 : rue Yersin à Hô-Chi-Minh-Ville; le seul francophone
avec Pasteur à « posséder » sa rue dans la capitale du Vietnam

4
Trois rencontres avec Alexandre Yersin
par Pierre-Yves Zambelli
par la France pour protéger les intérêts nationaux face à
cette épidémie ou si c’est lui, qui attiré par ce éau et sa
compréhension, a suscité son voyage à Hong Kong. En
tous les cas, sur place sa collaboration initiale avec l’armée
britannique fut assez dicile, et il dut s’installer dans une
paillote proche de l’hôpital militaire où il mènera ses
recherches. Il parle peu d’un concurrent direct sur place,
Kitasato pionnier de l’école de microbiologie japonaise. La
découverte du germe responsable de la peste aurait pu
être attribuée au deux mais Yersin, grâce à son installation
précaire sans étuve ni matériel scientique sophistiqué, a
joué de chance car la culture de Yersinia pestis s’est avérée
plus aisée à température ambiante (28°). Il faut absolument
lire le compte rendu scientique de la découverte du bacille
de la peste, il montre le génie de Yersin, l’acuité de son sens
de l’observation et la rigueur de sa démarche scientique.
Il décrit les symptômes, il met en évidence le germe causal,
précise sa mise en culture et démontre sa virulence en
l’inoculant à des petits rongeurs… Il ne mettra par contre
pas en évidence le rôle des puces comme vecteur inter-
espèce laissant ce soin à Simond.
Après cette étape clé de sa carrière, un retour à Paris où il
initie la sérothérapie de la peste, il exprime le souhait de
repartir et fondera à Nha-Trang une succursale de l’Institut
Pasteur de Saigon. Cette station de recherche dépasse le
domaine de la microbiologie, Yersin y mènera certes des tra-
vaux de sérothérapie et dans le domaine vaccinal, mais son
esprit ouvert et ses idées profuses le poussent à s’intéres-
ser à l’agronomie toujours soucieux du rapport de l’homme
avec son milieu. Il introduira l’Hévéa en collaboration avec
les entreprises françaises du caoutchouc, pour donner à ses
dires un potentiel économique aux autochtones. Il s’intéres-
se aux zoonoses du bétail. Il a le projet d’un Sanatorium sur
le plateau de Dalat, station d’altitude pour les tuberculeux,
loin des anophèles du paludisme.
Yersin est un homme, moderne, il a une des premières voi-
tures d’Indochine, il s’intéresse à l’astronomie et installe une
coupole à Nah-Trang…
Cet homme, sans doute pas facile, comme j’ai pu le décou-
vrir semble n’avoir jamais été attiré par les honneurs, les fou-
les et les distinctions, il n’a jamais porté sa croix de la légion
d’honneur et s’est toujours caché des multiples titres et dis-
tinctions qu’il a reçus. Je pense que son acte le plus « mé-
diatique » est d’être resté président d’honneur de l’Institut
Pasteur à Paris où il s’est rendu à la séance annuelle jusqu’à
77 ans… Il décédera à l’âge de 80 ans à Nah-Trang où il est
enterré.
Bien sûr tout n’est pas clair ni transparent dans cette dé-
couverte du personnage, mais j’ai été fasciné par son côté
scientique avant-gardiste. Il a ce côté protestant, individua-
liste et indépendant. Il n’aimait pas les honneurs ni la foule,
étonnamment il est bien plus connu et populaire au Viet-
nam qu’en Helvétie ou en France. Je crois qu’il fut un grand
médecin au sens large, utilisant le terrain « vierge » de l’Indo-
chine inexplorée pour y parfaire ses réexions et expérimen-
tations sur l’interaction de l’homme avec la nature. Yersin,
qui se considérait chercheur avant d’être médecin, par son
approche anthropologique et sa vision avant-gardiste de la
santé et de l’hygiène des populations, a contribué à dessiner
les bases d’une médecine humaniste soucieuse de la santé
publique.
J’ai aimé découvrir ce personnage au cours de ces trois ren-
contres et si Yersin fut incontestablement un médecin scien-
tique voyageur et explorateur, on ose espérer que les plus
jeunes s’en inspirent et soient poussés à aller voir ailleurs
pour aiguiser leur curiosité et étendre leurs connaissances.
Mais que les moins jeunes se rassurent, car si les voyages
forment la jeunesse, ceux réalisés plus tard, parfois, permet-
tent de corriger l’ignorance, et donnent un sens au chemin
parcouru.
l’ORTHOPÉDISTE PÉDIATRE ET lA JUSTICE
L. Geffroy, S. Guillard, A. Hamel, E. Mayrargue,
J.- M. Rogez
Isbn : 978 284023 722 8
184 pages
mai 2011
30 €
La prise en charge de l’enfant grand handicapé en milieu hospitalier, relève d’une étroite collabora-
tion interdisciplinaire, au centre de laquelle les inrmières ont un rôle majeur.
Le polyhandicap est un état morbide de poly-décience, maintenant reconnu par la société, en par-
ticulier sous la pression des associations de famille. Il est heureusement passé le temps de la conno-
tation péjorative que le vocabulaire qualicatif comportait : aliéné, boiteux, arriéré, débile, diorme, estropié, idiot, incurable, taré,
conduisant à une sourance de la famille et à une exclusion de ces personnes.
La prise en charge de l’enfant grand handicapé en milieu hospitalier est un problème complexe qui demande des compétences
spéciques et bien souvent une présence de tous les instants. C’est une charge de travail inrmière très lourde que l’on aronte
avec d’autant plus de sérénité que l’on possède une véritable compétence dans ce domaine. La compétence s’acquiers par la
connaissance et permet un soin ecace, rigoureux, sobre, respectueux de l’enfant, de l’accepter avec ses diérences et sa person-
nalité sans jugement.

5
Missions orthopédiques au Vietnam
Comment ça marche ?
par M. Dutoit
Introduction
L’activité de Children Action (CA) a débuté en 1996 et à ce
jour plus de 43 000 consultations ont été réalisées (toute
étiologie confondue). L’auteur du texte participe aux mis-
sions depuis l’an 2000, et est chef de projet depuis 2004. A
n 2010 plus de 3700 interventions orthopédiques ont été
réalisées par les chirurgiens européens en mission ainsi que
par les chirurgiens vietnamiens. Dans le cadre des 7 missions
orthopédiques annuelles de CA nous réalisons environ 175
opérations et 1000 consultations (anciens et nouveaux cas).
De plus, près de 2872 appareillages orthopédiques ont été
prescrits et plus de 700 chaises roulantes délivrées. Une telle
activité nécessite une bonne organisation tant au niveau
de CA que sur le terrain. Elle est riche d’enseignement, nous
permettant non seulement de progresser, mais aussi d’amé-
liorer la qualité de la prise en charge de nos patients. Avec
le temps, en particulier dans les grands centres, la situation
s’est sensiblement améliorée, mais le nombre de démunis,
sans accès réel aux soins, demeure important dans tout le
pays.
L’ecacité ainsi que la qualité d’une activité chirurgicale hu-
manitaire programmée impliquent un certain nombre de
conditions :
• Organisation humanitaire structurée : statuts, program-
mes….
• Chirurgiens formés, compétents et expérimentés (réfé-
rences pour nos collègues locaux, mais aussi pour les
malades et leur famille)
• Organisation et ancrage local : recrutement des mala-
des, choix des hôpitaux, collaboration avec nos collè-
gues (formés ou en formation)
• Coordinatrice (teur) local
• Suivi des malades
• Autorisation des autorités sanitaires
(« permis de travail »)
Le groupe CA des chirurgiens orthopédistes engagés au
Vietnam est formé essentiellement de membres de la SO-
FOP qui se connaissent bien et qui ont, très souvent, le
même langage. Cette communauté d’idées est importante
pour assurer le suivi de malades opérés par d’autres et pour
réellement prendre charge les malades et leur famille. Ainsi
la qualité de notre action dépend non seulement des indica-
tions opératoires, de la réalisation de la chirurgie, mais aussi
et surtout du suivi des malades ; plus de 60 % des cas sont
revus ce qui représente pour les conditions locales un taux
de revue important. Notre prise en charge est particulière-
ment appréciée par les parents des enfants qui la compare
à celle d’autres organisations humanitaires qui opèrent ou
font opérer beaucoup d’enfants sans en assurer le suivi.
La qualité de notre suivi est appréciée non seulement par
les parents des patients atteints d’aections orthopédiques,
mais aussi pour les patients neurologiques faute de structu-
res adéquates locales et pour lesquels les traitements occi-
dentaux ne sont pas envisageables. L’expert étranger dans
l’esprit des familles vietnamiennes est souvent l’ultime re-
cours : « on a tout fait pour l’enfant, même l’expert ne peut rien
faire ». L’abstention thérapeutique fait appel à la connais-
sance non seulement de l’histoire naturelle des pathologies,
mais aussi à l’appréciation des possibilités thérapeutiques
locales qui ont, en 10 ans, en particulier dans les grands cen-
tres, fait de grands progrès.
Organisation pratique
Recrutement des malades-coordination locale
Le recrutement des malades s’est fait, pendant de nombreu-
ses années par un groupe de volontaires locaux se rendant
dans les provinces et prenant en charge les enfants dému-
nis, sans vrai tri des malades. Depuis quelques années le re-
crutement se fait de plus en plus avec la collaboration des
hôpitaux dans lesquels nous opérons ce qui contribue à
la formation médico-chirurgicale de nos collègues vietna-
miens. Les actions de recrutement dans les provinces (an-
nonce presse, TV, demande spécique, etc.) peuvent être fai-
Fig. 1 : hôpital de Thanh Hoa situé à 150 Km au sud ouest de Hanoi et avec lequel nous collaborons
régulièrement à raison de 2 à 3 missions par an depuis 2009
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%


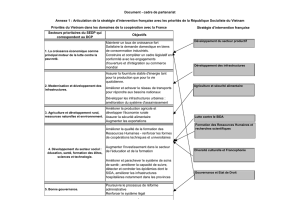


![III - 1 - Structure de [2-NH2-5-Cl-C5H3NH]H2PO4](http://s1.studylibfr.com/store/data/001350928_1-6336ead36171de9b56ffcacd7d3acd1d-300x300.png)