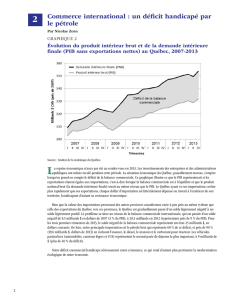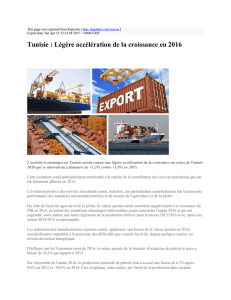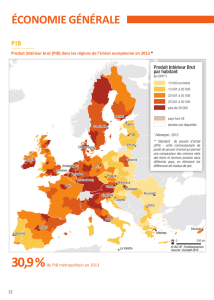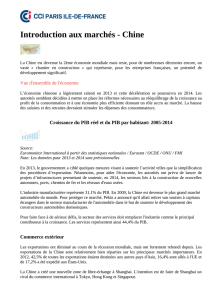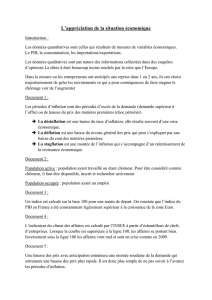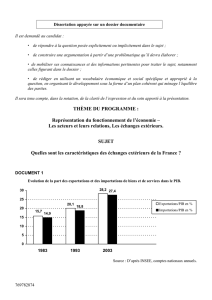rapport du femise 2003 sur le partenariat euro

RAPPORT DU FEMISE 2003 SUR LE
RAPPORT DU FEMISE 2003 SUR LE
PARTENARIAT EURO-MEDITERRANEEN
PARTENARIAT EURO-MEDITERRANEEN
Analyses et propositions du
Analyses et propositions du
Forum Euro-Méditerranéen des Instituts Economiques
Forum Euro-Méditerranéen des Instituts Economiques
Heba Handoussa, Economic Research Forum, Egypte
Jean-Louis Reiffers, Institut de la Méditerranée, France
Coordonnateurs
Ce rapport a été réalisé avec le soutien financier de
la Commission des Communautés Européennes. Les
opinions exprimées dans ce texte n’engagent que
les auteurs et ne reflètent pas l’opinion officielle de
la Commission.
Septembre 2003
Institut de la Méditerranée
FEMISE
C
A
I
SS
E
D
EP
A
R
G
N
E
P
R
O
V
E
N
C
E
-
A
L
PE
S
-
C
O
R
S
E
2003

-iii-
Heba HANDOUSSA, Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran & Turkey, Egypte
Jean-Louis REIFFERS, Institut de la Méditerranée, France
Sergio ALESSANDRINI, Istituto d’Economia, Universita Luigi Bocconi, Italie
Aziz Al KAZAZ, Deutches Orient Institut, University of Hamburg, Allemagne
Bruno AMOROSO, Federico Caffe Center, Roskilde University, Danemark
Slimane BEDRANI, Centre de Recherches en Economie Appliquée pour le Développement, Algérie
Driss BEN ALI, Centre d’Etudes Stratégiques, Université Mohammed V, Maroc
Agnès CHEVALLIER, Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales, France
Michael GASIOREK, Sussex University, Royaume-Uni
Mohieddine HADHRI, Centre d’Etudes Méditerranéennes et Internationales, CETIMA, Tunisie
Hanaa KHEIR ELDIN, Faculty of Economics and Political Studies, Cairo University, Egypte
Alejandro LORCA CORRONS, Universidad Autonoma de Madrid, Espagne
Samir MAKDISI, Economics Department, American University in Beirut, Liban
Tuomo MELASUO, University of Tampere, TAPRI, Finlande
Seyfeddin MUAZ, Royal Scientific Society, Jordanie
Yilmaz ÖZKAN, Center for Mediterranean Studies, Turquie
Meine Pieter Van DIJK, Economic Faculty, Erasmus University, Hollande
Septembre 2003
Ce rapport a été présenté au Steering Committee du FEMISE,
réuni à Marseille le 28 juillet 2003.
Membres du Steering Committee :
RAPPORT FEMISE 2003 SUR
LE PARTENARIAT EURO-MEDITERRANEEN
Avec la contribution de :
Frédéric Blanc Institut de la Méditerranée, France
Yasmin Fahim Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran & Turkey, Egypte
Nathalie Grand Institut de la Méditerranée, France
Maryse Louis Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran & Turkey, Egypte
Diaa Nour El Din Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran & Turkey, Egypte
Nathalie Roux Centre d’Economie et de Finances Internationales, France

-iv-
TABLE DES MATIERES
A/ SIX ORIENTATIONS PRINCIPALES POUR LE DÉVELOPPEMENT
I- Couvrir les besoins en emplois, une nécessité impérieuse . . . . . . . . . . . . . . p.1
a- Un problème qui ne réside plus dans l’évolution démographique mais dans la
structure de la population. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.2
b- Une transition démographique largement entamée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.2
c- Un objectif central, obtenir une croissance sensiblement plus forte et
créatrice d’emplois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.5
d- Un besoin de nouveaux emplois considérable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.6
II- Consolider un actif, la stabilisation macro-économique . . . . . . . . . . . . . . . p.8
a- Une macroéconomie stabilisée qui a pu, jusqu’ici, résister aux chocs . . . . . . . . . . . p.8
b- Des contraintes et des rigidités contre-productives à long terme qui pèsent
sur l’action des gouvernements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.14
c- La stratégie de l’Etat employeur en dernier ressort, des effets de long terme
néfastes qui pèsent sur les capacités de croissance futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.17
III- Améliorer la vitalité de la croissance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.19
a- Privilégier l’action sur la productivité globale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.19
b- Accélérer la mise en oeuvre des réformes nécessaires pour modifier le régime de
croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.23
IV- Conforter la compétitivité dans les échanges de biens et services et
l’attractivité des capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.30
a- Les échanges de biens : l’ouverture des PM progresse, particulièrement avec l’UE,
mais les échanges ne sont pas assez diversifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.31
b- Les échanges de services : des avantages comparatifs aujourd’hui limités
dans les services commerciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.33
c- La décennie manquée en matière d’IDE, un déclin de l’attractivité comparée
qui semble se corriger actuellement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.35
d- Etude d’un cas : un secteur menacé, le textile-habillement en Méditerranée . . . . . p.40
V- Modifier une dynamique du marché du travail freinée par la structure de l’em-
ploi, l’inadéquation de la formation et la législation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.53
VI- Contrôler le développement de la pauvreté, une contrainte absolue. . . . . p.56
a- Une pauvreté qui ne s’étend pas mais qui gagne en profondeur . . . . . . . . . . . . . p.56
b- La lutte contre la pauvreté et les performances des économies . . . . . . . . . . . . . . p.59
c- La migration dans les pays du Sud de la Méditerranée, conséquence
de la pauvreté et du chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.60
d- La question de l’emploi des femmes et de leurs revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.64
B/ MONOGRAPHIES SUR LA SITUATION MACRO-ECONOMIQUE DES PM . . . . . . . . . . . . . . . . p.69
Notes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.143
Bibliographie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.143
Annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.147

-v-
RAPPORT FEMISE 2003 SUR
LE PARTENARIAT EURO-MEDITERRANEEN
Septembre 2003
RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Le développement des sociétés méditerranéennes
dans les prochaines années va devoir s’organiser
autour de l’articulation d’un impératif et d’un actif.
L’impératif est de répondre aux besoins d’emplois
considérables des 15 prochaines années. L’actif,
qui s’est construit tout au long des années 90 au
prix de lourds efforts, est la stabilisation macroé-
conomique pour laquelle les performances des PM
sont à l’égale des meilleurs pays en développe-
ment et des nouveaux candidats. A l’évidence,
cette stabilisation n’a pas permis la revitalisation
des sociétés méditerranéennes. Mais, sans elle,
aucune construction n’est possible. Sans elle, on
peut se demander comment les PM auraient pu
résister aux nombreux chocs externes qu’ils ont
subis ces trois dernières années.
Selon le Femise, cette articulation est possible en
suivant six grandes orientations :
√couvrir les besoins en emplois,
√consolider la stabilisation macroéconomique,
√améliorer la vitalité de la croissance,
√conforter la compétitivité dans les échanges
et l’attractivité des capitaux,
√modifier la dynamique des marchés du travail
freinée par la structure de l’emploi, l’inadé-
quation de la formation et la législation,
√contrôler le développement de la pauvreté.
Le problème des besoins en emploi
n’est plus une question démographique, contin-
gente aux diverses hypothèses que les spécialistes
peuvent faire et, donc, discutables. C’est un fait
qu’illustrent parfaitement deux simples chiffres :
en 2000, la population des moins de 15 ans, ceux
qui chercheront bientôt une activité, s’élève à plus
de 80 millions de personnes et dépasse la popula-
tion active qui représente, elle, près de 74 millions
de personnes.
Les PM sont en effet indiscutablement entrés en
phase de transition démographique. Les taux de fer-
tilité ont baissé, comme le rythme de croissance de
la population. Mais, la transition n’étant pas ache-
vée, la population active ne suit pas la même ten-
dance et son taux de croissance augmente toujours.
L’existence d’une population active nombreuse,
assortie d’une transition démographique rapide,
peut fort bien être transformée en avantage écono-
mique puissant, notamment par le jeu du cycle
épargne-investissement. C’est d’ailleurs ce qui
explique en partie le « miracle asiatique » dans les
années 70-80. Mais, il est alors indispensable que
la vitalité des économies soit suffisante pour offrir
les postes de travail nécessaires à la transformation
de la population « jeune » en population « active »,
des postes suffisamment productifs pour que cet
accroissement de l’emploi ne se fasse pas au détri-
ment du salaire réel ni de la compétitivité.
Pour les PM, on peut évaluer l’ampleur du défi que
représente la couverture des besoins en emplois.
Dans les quinze prochaines années, compte tenu
de la structure actuelle de la population et des
marchés du travail, il faudra près de 34 millions
de nouveaux postes pour ne pas dégrader la
situation existante pourtant déjà préoccupante.
L’amélioration nécessaire des taux d’activité, rela-

-vi-
tivement bas dans la plupart des PM, accroît enco-
re l’effort puisque atteindre le taux d’activité
moyen de l’Union réclamera 50,3 millions
d’emplois supplémentaires.
Parvenir à cet objectif ne pourra se faire
sans poursuivre la stabilisation macroécono-
mique. Les PM ont maintenant acquis une véri-
table maîtrise de leurs grands équilibres, notam-
ment dans le contrôle de l’inflation et du déficit
budgétaire (à l’exception du Liban et de la
Turquie). Les politiques monétaires rigoureuses
employées s’avèrent saines et leur permettent
d’éviter le recours au seigneuriage. Malgré des
taux de chômage encore importants et des taux de
croissance du PIB positifs mais insuffisants vis-à-
vis du besoin de création d’emploi, la région dispo-
se là d’un véritable actif qu’il faut absolument
préserver pour bâtir une stratégie de développe-
ment soutenable. Atout acquis par un chemine-
ment progressif, ce qui l’a ancré dans les pratiques
gouvernementales, il a permis aux PM de préser-
ver leur cohésion sociétale malgré la succession de
chocs internes (sécheresses) et externes (diminu-
tion du tourisme, hausse des cours du pétrole)
qu’ils viennent de subir en peu de temps.
La consolidation de cet actif va nécessiter en pre-
mier lieu de repenser l’action des gouvernements
sur le plan de la structure budgétaire et de leurs
stratégies d’emplois dans le secteur public.
La fiscalité est un point où les PM peuvent res-
taurer certaines marges de manœuvre sans
remettre en cause la stabilisation macro-écono-
mique, car les principales rigidités auxquelles ils
doivent faire face peuvent rapidement être réso-
lues. Côté recettes, la perte due à l’abaissement
des droits de douanes semble parfaitement soute-
nable en regard des expériences de la Jordanie et
de la Tunisie, où l’augmentation de l’activité liée à
l’ouverture engendre les recettes fiscales compen-
sant les pertes inititales. Encore faut-il que le sys-
tème fiscal combine de manière optimale la fiscali-
té directe et indirecte. Côté dépenses, on ne peut
ignorer le poids de la situation politique qui
implique un montant de dépenses de défense gros-
sièrement équivalent aux investissements étran-
gers entrant dans la région. S’y ajoute celui de la
dette externe, dont le paiement du service ôte des
circuits économiques locaux d’importants mon-
tants financiers. Toutefois, la plus grande contrain-
te entièrement du ressort des PM reste la charge
que représentent les salaires des emplois publics.
Dans les PM, l’emploi public civil atteint presque
17% de l’emploi total (contre 11% en moyenne
dans le monde) et les salaires versés absorbent
près de 27% des dépenses publiques totales. Mais,
plus que le poids que cela représente dans le bud-
get, c’est la stratégie même de l’État
employeur en dernier ressort qui pose, à
terme, plus de problèmes qu’elle n’en résout
dans la situation des PM, notamment en biaisant les
marchés du travail et en entraînant des effets néga-
tifs dans la sphère réelle. D’une part, les salaires
offerts dans la fonction publique sont nettement
plus élevés que dans le secteur privé, ce qui draine
les plus hautes qualifications vers les administra-
tions et prive le secteur privé en général, les sec-
teurs nouveaux en particulier, des ressources
humaines nécessaires à leur compétitivité. D’autre
part, en cas de ralentissement économique, un tel
niveau de dépenses courantes, qui ne peut être
réduit, oblige à baisser les dépenses d’investisse-
ment et/ou à recourir à l’endettement public.
En second lieu, il reste encore deux points néga-
tifs du point de vue macroéconomique auxquels il
faut rapidement remédier : la fragilité structu-
relle de la méthode d’équilibrage des comptes
extérieurs et la faiblesse de la croissance.
Au niveau des comptes extérieurs, les PM expéri-
mentent toujours un déséquilibre commercial. Ce
n’est pas le déficit qui pose problème. Il est sou-
vent le lot des pays en transition et correspond à
un déficit d’épargne qui traduit notamment le fait
que la population est jeune et l’écart de dévelop-
pement à combler important. Mais, il est compen-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
1
/
166
100%