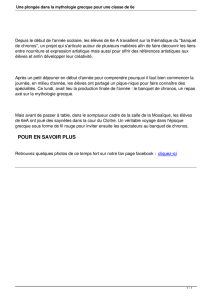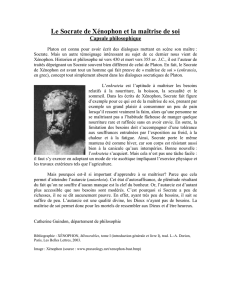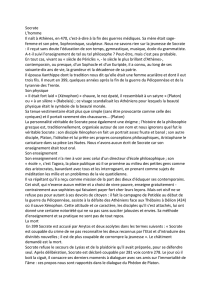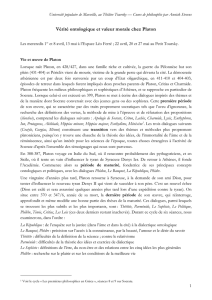Position de thèse - Université Paris

UNIVERSITÉ
PARIS IV – SORBONNE
ÉCOLE DOCTORALE I (22) – MONDES ANCIENS ET MÉDIÉVAUX
E. A. 1491- Édition et commentaire des textes grecs et latins
T H È S E
pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS IV – SORBONNE
Discipline / Spécialité : ÉTUDES GRECQUES
Présentée et soutenue par
Yannick SCOLAN
le 16 novembre 2013
LES BANQUETS LITTÉRAIRES
DE PLATON À ATHÉNÉE
Sous la direction de
Madame le professeur Dominique ARNOULD
JURY
— Madame le professeur Dominique ARNOULD – Université de Paris IV - Sorbonne
— Monsieur le professeur Alain BILLAULT – Université de Paris IV - Sorbonne
— Monsieur le professeur Michel FARTZOFF – Université de Franche-Comté
— Madame le professeur Sophie GOTTELAND – Université de Bordeaux III - M. de Montaigne
— Madame le professeur Estelle OUDOT – Université de Bourgogne

2
Il faut attendre 1931 et l’ouvrage fondateur de J. Martin
1
pour qu’une première étude
soit consacrée à l’ensemble du corpus des Banquets littéraires. J. Martin divise son ouvrage en
quatre parties : la première consacrée à la « théorie des Anciens », la deuxième aux « topoi »
que constituent les personnages et les situations, la troisième à l’évolution des Banquets et la
dernière à un résumé séparé de chaque ouvrage.
J. Martin se sert des remarques éparses qu’il trouve chez Hermogène le rhéteur sur les
συμπόσια σωκρατικά et sur le Banquet de Platon en particulier, pour définir, a priori, la
nature du genre symposiaque. Il considère que le mélange du σπουδαῖον et du γελοῖον est un
élément central et discriminant pour toutes les œuvres de son corpus. Ce faisant, il ne se
départit pas des éléments que soulignaient déjà les premiers traducteurs de Platon et de
Xénophon, sinon quand il suppose que la combinaison initiale du σπουδαῖον et du γελοῖον
laisse la place, par la suite, à deux veines contradictoires, l’une satirique avec Ménippe et
Lucien et l’autre spécifiquement sérieuse avec les œuvres érudites de Plutarque, d’Athénée et
de Macrobe dont l’unité tiendrait à leur commune référence au modèle platonicien.
J. Martin suppose alors que Platon donnerait naissance à un genre particulier, dont son
autorité suffirait à assurer le développement. Car les auteurs ultérieurs auraient repris et imité
les personnages et les situations que son Banquet contenait. Ainsi Agathon servirait-il de
modèle aux hôtes des œuvres ultérieures, Aristophane et Alcibiade aux bouffons, Aristodème
aux invités en surnombre, Éryximaque aux médecins, Socrate aux retardataires, Alcibiade,
encore, aux trouble-fête.
F. Frazier
2
propose une répartition légèrement différente des œuvres qui appartiennent
au corpus des Banquets, quand elle souligne à quel point il est difficile de parvenir à une
définition unificatrice. Elle propose de distinguer deux « branches » parmi les Banquets, l’une
« littéraire », à laquelle appartiendraient les œuvres de Platon, de Xénophon ou le Banquet des
Sept Sages, et l’autre « savante », dont les Propos de table et les Deipnosophistes seraient des
exemples.
L’étude de L. Romeri
3
adopte, quant à elle, une démarche qui tient de l’anthropologie
littéraire, pour étudier « le rapport à la sphère alimentaire dans une réunion d’hommes
savants
4
» et proposer une lecture unificatrice des Banquets. Elle fait l’hypothèse, à nos yeux
contestable, que Platon et Xénophon passent sous silence les « éléments les plus typiques du
banquet au profit du seul élément discursif
5
», que la nourriture est, dans leurs œuvres,
incompatible avec la discussion et que c’est dans le refus du συμπόσιον, de ses usages et de
ses plaisirs que s’affirme la sagesse de Socrate. En conséquence, le Banquet, chez ces deux
auteurs, serait précisément « a-sympotique
6
», car le λόγος, pour s’y déployer, s’affranchirait
de la table et du vin. Paradoxalement, ce rapport particulier à la « sphère alimentaire » ferait
du Banquet de Platon l’élément unifiant les différentes veines du corpus symposiaque. Car
c’est par un même oubli de la nourriture que les Propos de table se rattacheraient à la tradition
du « banquet socratique
7
». À l’inverse, L. Romeri met en avant la profusion des plats dans le
Banquet de Lucien et dans les Deipnosophistes d’Athénée — pour l’un l’usage excessif et
bouffon qui en est fait, pour l’autre la concordance étroite de la table avec les exposés érudits
qui la prennent pour objet — et elle tire parti des références que les deux auteurs font de
l’œuvre de Platon pour en supposer le renversement radical.
1
J. Martin, Symposion, die Geschichte einer literarischen Form, Paderborn, 1931.
2
F. Frazier et J. Sirinelli, Plutarque. Propos de table, t. IX, 3, Paris, Les Belles Lettres, 1996, vol. 3, p.
178-179.
3
L. Romeri, Philosophes entre mots et mets. Plutarque, Lucien et Athénée autour de la table de Platon,
Grenoble, 2002.
4
Ibid., p. 16.
5
Ibid., p. 17.
6
Ibid., p. 95.
7
Ibid., p. 188.

3
Tenter de réduire la radicale diversité formelle des Banquets, s’appliquer à dégager des
conventions unificatrices qui justifieraient la naissance de deux veines contradictoires, refuser
d’analyser les œuvres de Plutarque, de Lucien et d’Athénée pour elles-mêmes, ou encore
penser que tous ces auteurs, au moment d’entamer leur travail d’écriture, se sont contentés de
se mettre « à la table de Platon » en voyant en lui une figure tutélaire, positive ou négative, a
indéniablement biaisé la lecture de ces œuvres.
L’injustice la plus criante, sans doute, a concerné le Banquet de Xénophon, dont
certains critiques ont supposé, à la suite d’Athénée, qu’il n’était que le résultat de la rivalité
jalouse que son auteur aurait nourrie à l’égard de Platon. Il a donc fallu comparer les deux
Banquets, applaudir au génie de l’un et regretter la fadeur de l’autre, auquel on n’a cessé de
concéder, pourtant, une proximité plus grande avec la réalité qu’on a supposé avoir été celle
de Socrate. Au premier les lauriers de l’art, au second la perfide consolation d’un intérêt plus
historique que littéraire, au point qu’il n’a jamais semblé possible de parler du Banquet de
Xénophon sans évoquer celui de Platon.
En réalité, Xénophon s’affranchit du modèle de Platon quand il compose son ouvrage.
Et son originalité est bien plus grande que ce qui a pu être supposé. Car Xénophon imagine un
banquet singulier, qui tient davantage de la comédie en bon nombre de ses passages. Certes,
Platon, avant lui, a témoigné de la fréquentation par Socrate de la maison de Callias. Mais il
n’a jamais eu l’audace de Xénophon, qui place le philosophe au sein d’une assemblée si
unanimement étrangère à la vertu que la scène — fictive ou réelle, peu importe finalement —
de ce Banquet tient du plus piquant des paradoxes.
Sans doute Callias fait-il partie des débauchés les plus notoires d’Athènes. Sa fortune,
mal acquise, sert une vie de plaisirs à l’écart des tâches publiques auxquelles sa naissance et
son rang auraient, pourtant, dû l’appeler. Ses largesses sont si grandes qu’il ouvre sa table à
quiconque veut en profiter et ses mœurs sont si relâchées qu’on soupçonne mal les poètes
comiques d’avoir eu besoin d’une lourde caricature quand ils l’ont mis en scène. Surtout, ses
liens avec Lycon, dont on peut supposer qu’il s’agit bien, également, de l’accusateur de
Socrate, ont été précisément soulignés dans une pièce d’Eupolis, dont Xénophon semble faire
le point de départ de son Banquet.
Car il se saisit du sujet même de son Autolycos et de l’amour que Callias a nourri pour
le jeune garçon, âgé alors d’une douzaine d’années, avec la bénédiction intéressée de son
père, Lycon. C’est à la table de ce débauché que Socrate accepte de prendre place, ce Socrate
dont Xénophon vante ailleurs la mesure et la tempérance. Il n’y refuse pas les plaisirs — ni
ceux du vin, ni ceux des divertissements — mais il les ordonne et, partant, conduit Callias, au
moyen du banquet lui-même, sur le chemin de la vertu.
Socrate corrige sans cesse le συμπόσιον de son hôte, et il l’empêche de sombrer dans le
désordre. S’il accepte de boire sans soif, il invite cependant ses compagnons à ne le faire que
par petites rasades. Le voici encore qui s’extasie des prouesses d’une jeune chanteuse, mais il
propose bientôt qu’on produise un spectacle digne des peintures qui représentent les Grâces,
les Heures et les Nymphes. Une querelle s’élève-t-elle, il ramène l’assemblée vers la concorde
en lui faisant entonner des chansons de banquet. Surtout, il se saisit du moment rituel où l’on
apporte le parfum pour céder, comme on le fait ordinairement dans un συμπόσιον, au plaisir
de la devinette et de l’énigme et pour inviter l’assemblée des convives à définir la véritable
odeur de la vertu. Le déroulement du banquet conduira Lycon à louer la καλοκἀγαθία de
Socrate, après qu’il aura entendu les conseils que le philosophe adresse à Callias dans sa
relation avec Autolycos.
Il ne s’agit donc pas d’une œuvre décousue, dont l’entrain désordonné serait le garant
d’une quelconque authenticité, mais de la définition progressive du naturel philosophique
dans les circonstances qui lui sont le plus défavorables. Et c’est précisément le banquet, dans
son déroulement, qui devient le moyen de cette ascension vers la vertu.

4
Dans ces circonstances, ce n’est pas le thème de l’amour qui permet de rapprocher le
Banquet de Xénophon de celui de Platon, mais le partage d’une même incongruité de
situation. Car Socrate, quand il arrive chez Agathon, n’est pas davantage à sa place que dans
la maison de Callias.
De fait, les personnages du Banquet de Platon sont tous, mis à part Aristophane, les
disciples des meilleurs sophistes, dont ils sont les auditeurs silencieux dans le Protagoras, et
ils appartiennent aux hétairies aristocratiques de Teucros, d’Alcibiade et de Léagoras, quand
Socrate semble, pour sa part, céder à un usage, dont il n’a pas l’habitude, en prenant un bain
et en revêtant des chaussures pour se rendre chez Agathon.
Dans ce Banquet, Socrate est un intrus, autant d’un point de vue social que d’un point
de vue intellectuel. Chacun des orateurs est le dépositaire d’un savoir qu’il prétend définitif
sur l’Amour et supérieur à celui des autres. Phèdre produit un discours à la manière d’Hippias,
Pausanias à la manière de Prodicos, et Éryximaque s’illustre par ses propos naturalistes dont
la feinte modestie n’atténue pas sa volonté de rivaliser avec Empédocle, avant qu’Agathon
n’emporte tous les suffrages pour la beauté de l’éloge qu’il produit d’Éros. Voilà donc la belle
société qui est réunie chez Agathon. Socrate y fait doublement figure d’étranger : il ne partage
ni la condition ni le savoir des autres convives. Il est le seul qui se refuse à produire un
discours d’autorité, le seul qui avoue la pauvreté de sa science et, même, qui s’en amuse
quand il prend place aux côtés d’Agathon.
En somme, Socrate incarne la figure mythologique d’Éros : comme lui, il va pieds nus,
couche à même le sol, vit dans l’indigence, est rude, malpropre. Comme lui, surtout, il n’est ni
savant ni ignorant, mais toujours mû par une quête sans cesse renouvelée du beau.
L’opposition entre ces deux conceptions du savoir est très précisément associée par
Platon au rapport de chacun au banquet et à ses usages. Platon n’exclut en rien le συμπόσιον
de son ouvrage. Bien au contraire, il fait de Socrate le seul convive parfaitement accompli.
Certes, Socrate se plie, dans un premier temps, à la décision collective de ne boire aucune
goutte de vin et, quand survient Alcibiade, il ne rechigne guère davantage à vider les coupes
qu’on lui tend. Mais alors que les uns, dans la sobriété comme dans l’ivresse, cèdent à l’ennui
ou au sommeil et manquent à leur qualité de convives, il est le seul à ne subir aucun des deux
excès du manque et de la complétion, mais il prolonge indéfiniment le banquet.
Indifféremment satisfait de boire ou de ne pas boire, il ne cesse de discuter qu’avec
l’endormissement de ses compagnons : lui seul continuera ses activités, comme à l’ordinaire,
quand poindra le jour.
Platon ménage dans son récit, un rapport d’identité entre le philosophe et le convive : il
met ses personnages à l’épreuve du banquet et, par lui, révèle la nature véritable du savoir.
Cette intention particulière le conduit à dupliquer les figures du philosophe jusqu’à celle
d’Éros, comme en une remontée vers le principe.
La narration du Banquet procède par emboîtements successifs, si l’on peut dire. À notre
connaissance, c’est la seule œuvre de Platon qui présente ainsi les trois genres de récits tels
qu’ils sont définis dans la République : on y trouve un dialogue encadrant, qui est imitatif,
puis un récit simple — celui d’Apollodore, qui ne masque jamais sa qualité d’auteur. Au sein
de ce récit se trouve celui d’Aristodème, simple et imitatif à la fois. Cette superposition des
trois strates narratives est reproduite à l’intérieur même des propos qu’Apollodore a recueillis
de la bouche d’Aristodème : car le dialogue de Socrate avec Agathon devient lui-même le
cadre du récit que livre Socrate de sa rencontre passée avec Diotime et de l’enseignement
qu’elle lui a dispensé quand elle-même lui a raconté la naissance d’Éros, lors d’un banquet
divin. La structure narrative du Banquet ménage donc un rapport d’identité entre Éros,
Diotime, Socrate, Aristodème et Apollodore, dont certains indices peuvent donner à penser
qu’il constitue lui-même une image de l’auteur en son œuvre.
De même que le συμπόσιον est, avec Platon et Xénophon, le cadre, mais également le

5
moyen de la définition du savoir véritable, Plutarque, dans le Banquet des Sept Sages,
remonte aux sources de l’histoire de la philosophie en imaginant la réunion, près de Corinthe,
de Solon, de Bias, de Thalès, d’Anacharsis, de Cléoboulos, de Pittacos et de Chilon autour du
tyran Périandre. Faut-il plus particulièrement chercher une parenté formelle de cette œuvre
avec celle de Platon ? Ce n’est pas de l’amour que parlent les personnages du Banquet des
Sept Sages, mais de l’amitié. Et, pour ce qui est du sujet même, la filiation de Plutarque tient
davantage d’Aristote que de Platon ou de tout autre : les convives de Périandre, et pas
seulement Solon, conviennent tous que c’est la démocratie dont il convient de faire l’éloge
quand vient le moment de débattre de la meilleure forme de gouvernement. Car c’est en un tel
régime, comme on le trouve affirmé par Aristote (Éthique à Nicomaque, VIII, 11, 1161b) que
l’amitié est le plus développée, comme elle doit l’être également au sein du banquet.
Certes, d’un point de vue formel, on trouve, comme chez Platon, un dialogue encadrant,
où Dioclès satisfait la curiosité de ceux qui l’interrogent sur la réception de Périandre, puis
une série d’exposés qui précèdent un mythe final — celui d’Arion. Mais il n’est rien de la
narration propre au Banquet de Platon. Et Plutarque n’est pas moins le débiteur de
Xénophon : comme lui, il fait de l’hôte du banquet un être sourd à la philosophie. Car
Périandre, en qui Plutarque refuse de voir un Sage, y est marqué par la souillure de l’inceste et
par la perspective du meurtre prochain de son épouse. Il demeure incapable tout autant de
comprendre les signes des dieux que de participer réellement à la discussion des convives.
Enfin la simplicité de sa réception, en même temps qu’elle est remarquée par le narrateur
Dioclès, est dénoncée comme un faux-semblant et une hypocrisie de circonstance.
En réalité, Plutarque, pour ce qui est de l’économie narrative de son ouvrage, trace une
voie qui lui est propre, en élargissant progressivement le dialogue aux différents cercles de la
sociabilité : il part du banquet et de l’amitié qui doit régir les liens qui unissent des proches ;
on passe ensuite au cadre de la cité, avant que l’ouvrage ne trouve son achèvement dans
l’évocation de l’harmonie universelle et de la φιλανθρωπία des dieux. Cette ascension
progressive accompagne une discussion qui ne se nourrit que du banquet et de son contexte, à
partir d’énigmes ou d’oracles. Ces προϐλήματα conduisent à souligner la providence divine et
à définir la nature apollinienne de la philosophie, dont Plutarque fait, en quelque sorte ici,
l’archéologie, jusqu’à l’exposition finale des sentences delphiques que la tradition prête aux
Sept Sages.
Sans doute le Banquet des Sept Sages aurait-il pu figurer parmi les Propos de table s’il
n’avait pas présenté le caractère assumé d’une fiction des temps passés. La seule différence
tient, en réalité, à la modernité des discussions qui sont relatées dans les Propos de table, dont
le Banquet des Sept Sages semble définir le principe même.
Car les Propos de table ne développent pas seulement des προϐλήματα comme on en
trouve dans le corpus aristotélicien. Il s’agit encore moins d’une collection inorganisée de
questions auxquelles le banquet fournirait un cadre et permettrait de présenter de façon
artificiellement vivante un recueil d’ὑπομνήματα. Les Propos de table constituent, eux aussi,
une œuvre d’une grande cohérence programmatique : chaque question, qu’elle concerne le
banquet et ses usages ou qu’elle cherche, pour elle-même, à satisfaire une curiosité naturelle,
naît du contexte symposiaque et fait l’objet d’un récit introducteur qui permet d’ébranler
l’opinion première et de mettre la pensée en mouvement. Les personnages des Propos de
table ne font pas de philosophie en tant que telle, mais ils appliquent un raisonnement
philosophique à des objets qui, par leur triviale proximité, échappent au champ ordinaire de
son questionnement.
Il ne s’agit pas d’aboutir à quelque vérité que ce soit sur les questions que le banquet
fournit à l’acribie des convives. La nature des προϐλήματα συμποσιακά est aporétique. Et
c’est bien là que se trouve son intérêt : dans une assemblée qui mêle ignorants et savants,
chacun doit exercer son esprit en proposant des développements qui lui sont propres et en
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%