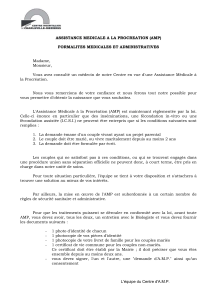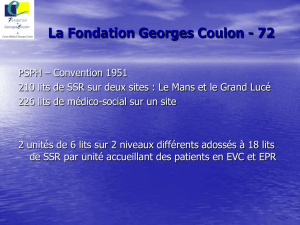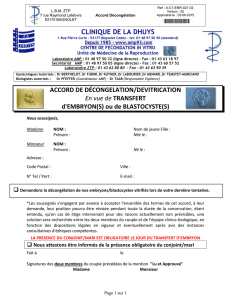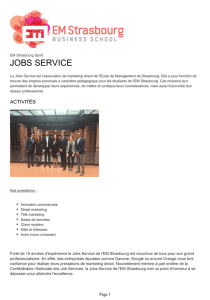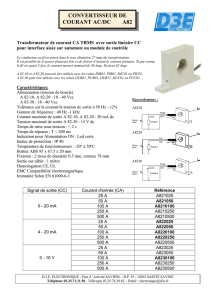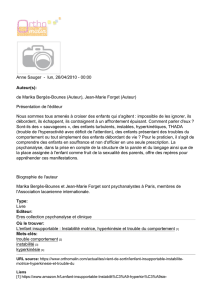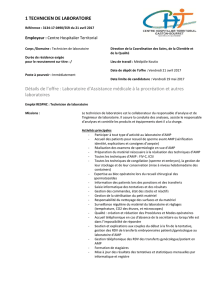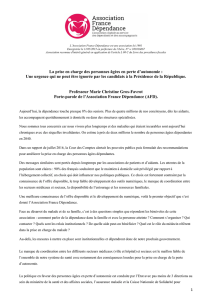Les structures d`accueil

49
Doc'AMP Hors-série n°1 Les champs d’intervention
Yannick Vaitilingom
Journaliste
Autour du handicap
De l’adulte
Les Maisons d’accueil spécialisé (MAS) sont régies
et créées dans le cadre de la loi d’orientation en fa-
veur des personnes handicapées [Décret du 26 dé-
cembre 1978]. En 2006, la DRESS comptait 470 éta-
blissements sous cette appellation. Les MAS héber-
gent des adultes gravement handicapés ou poly-
handicapés en manque d’autonomie, et orientés par
la CDAPH [Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées, anciennement
COTOREP] afin de leur assurer une surveillance mé-
dicale et des soins constants, mais aussi, et de ma-
nière permanente :
• l’hébergement ;
• certains soins médicaux (les MAS ne bénéficient pas
d’équipements techniques et sanitaires lourds : ce
ne sont pas des hôpitaux) ;
• les aides à la vie courante ;
Les structures d’accueil
L’idée selon laquelle « les aides médico-psychologiques
n’interviennent généralement pas à domicile mais exercent dans
des établissements spécialisés appartenant au secteur associatif,
au secteur hospitalier ou aux communes. » a depuis fait son chemin.
D’abord, parce qu’elles interviennent désormais à domicile,
ensuite par manque évident de clarté.
En effet, cette définition démontre qu’il serait plus facile de
reconstituer un puzzle, où chaque pièce aurait sa propre autonomie :
Comment fonctionne chacun de ces établissements ?
Comment s’intègrent-ils dans un secteur et quelle place occupent-ils
au sein de la communauté ?
L’annexe 1 de l’arrêté du 26 avril 2006 précise et élargit les principaux
établissements et services dans lesquels sont employés des AMP.
Mais la liste reste non exhaustive, puisque le métier est en constante
évolution. Ainsi, une présentation synthétique de « presque tous »
les établissements où travaillent les AMP permet de faire le point
sur cette profession littéralement disséminée dans le paysage
médico-social en France.
«Comment les AMP
s'intègrent-ils
dans un secteur,
quelle place
occupent-ils
au sein d'une
communauté ? »

• et toutes les activités de vie sociale dont le but est
de préserver et d’améliorer les acquis et d’éviter les
régressions.
L’établissement doit répondre à certains critères :
• être implanté en milieu urbain ou rural, à proximité
d’un centre urbain ou d’une structure de soins (hô-
pital général ou spécialisé) ;
• être desservi par des transports en commun, pour
favoriser la proximité de la famille ;
• et offrir une capacité optimale de 40 places.
Les Maisons d’accueil spécialisé sont entièrement fi-
nancées par les organismes de sécurité sociale, par
le biais d’un prix de journée.
Les Foyers d’accueil médicalisé (FAM) sont réactua-
lisés dans le cadre de la loi rénovant l’action sociale
et médico-sociale, du 2 janvier 2002. Ces anciens
Foyers à double tarification (FdT) acquièrent ainsi une
véritable existence juridique. Les FAM ont pour mis-
sion d’accueillir des personnes handicapées quel que
soit leur degré de handicap ou leur âge. En fait, ils fonc-
tionnent sur le même principe que les MAS (accueil-
lir des personnes handicapées ou polyhandicapées,
inaptes au travail, dans l’obligation de recourir à l’aide
d’une tierce personne…), à la différence :
• qu’ils accueillent des personnes un peu moins dé-
pendantes,
• que la notion de maladie psychiatrique s’y retrouve
plus fréquemment.
L’Aide sociale départementale assure le financement
de l’hébergement et de l’animation de l’établissement,
et l’Assurance maladie prend en charge, de manière
forfaitaire, l’ensemble des dépenses liées aux soins,
personnels, matériaux médicaux et paramédicaux. 550
sont recensés en 2008, où les AMP peuvent mener
des activités auprès de résidents, dans la continuité
d’un projet personnalisé.
Les Foyers occupationnels d’accueil (FOA), ou Foyers
de vie, accueillent, sur orientation de la CDAPH, des
personnes handicapées inaptes au travail (y compris
en milieu protégé) mais qui disposent d’une certaine
autonomie physique ou intellectuelle leur permettant
de se livrer à des activités d’occupation. En général,
ces foyers sont ouverts toute l’année, et peuvent of-
frir un accueil à la journée ou à temps complet. Ces
structures, créées dans les années 80 à l’initiative des
départements, sont à la charge de la personne hé-
bergée [selon les dispositions du décret n° 77-1547
du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des per-
sonnes handicapées aux frais de leur hébergement
et de leur entretien lorsqu’elles sont accueillies dans
des établissements] et de l’Aide sociale départementale
qui assure la prise en charge des frais de placement,
selon le code de l’Action sociale et des familles.
1400 établissements étaient recensés en 2008. Les
AMP peuvent y être amenés à rassurer les adultes han-
dicapés sur les tracas du quotidien, gérer les relations
lors d’activités…
Les Centres d’aide par le travail (CAT) sont désignés
sous l’appellation ESAT (Établissement et service d’aide
par le travail) depuis la loi du 11 février 2005 [Ren-
forcement de la loi de 1987 en matière d’emploi de
personnes handicapées.] Ils ont pour mission la mise
au travail, accompagné d’un soutien médical et so-
cial, des personnes handicapées :
• reconnues par la CDAPH ;
• d’au moins 18 ans (dérogation possible à 16 ans) ;
• qui présentent des difficultés d’adaptation en milieu
ordinaire ou en ateliers protégés, ou ont besoin d’un
soutien psychologique, médical…
Ces établissements, publics ou privés, relèvent pour
l’essentiel des dispositions :
• du Code de l’action sociale et des familles ;
• du Code du travail pour les questions d’hygiène, de
sécurité, congés payés, et médecine du travail (et
sur ces points uniquement).
Sous la responsabilité de la DDASS, leur création est
soumise à l’avis du CROSMS (Comité régional de l’or-
ganisation sociale et médico-sociale, qui remplace de-
puis 2004 le Comité régional de l’organisation sani-
Doc'AMP Hors-série n°1 Les champs d’intervention
50

taire et sociale (CROSS)). Dans ces établissements,
l’AMP travaille souvent en coordination avec les
moniteurs d’atelier et/ou un éducateur.
Les personnes prises en charge par les ESAT sont ac-
cueillies au sein de foyers d’hébergement, où l’AMP,
de manière plus fréquente, pourra :
• prendre en charge des activités de temps partiels ;
• collaborer à l’élaboration et à la réalisation des pro-
jets individualisés ;
• participer au travail en équipe, aux réunions de
services ;
• etc.
Il existe d’autres établissements dans lesquels de plus
en plus d’AMP peuvent envisager de travailler comme
les Centres de rééducation et de réadaptation fonc-
tionnelle, établissements de moyen séjour diversifiés
(spécialisés, polyvalents, public d’adultes/d’enfants,
hospitalisation complète/de jour) où ces profession-
nels seront intégrés dans un service infirmier pour réa-
liser, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’ensem-
ble des soins d’hygiène et de confort nécessaires à
la rééducation.
De l’enfant
Les Instituts médico-éducatifs (IME) prennent en
charge les enfants et adolescents de trois à dix-huit
ans atteints de déficiences intellectuelles. A la base,
ces établissements sont des fondations caritatives
créées à l’initiative de parents ou proches d’enfants tou-
chés par le handicap mental. Aujourd’hui ces IME sont
agréés par la DDASS, et sont en majorité à finance-
ment public et à gestion associative (par exemple, les
Papillons blancs, association loi 1901 reconnue d’uti-
lité publique). Il existe environ 1200 IME en France, ré-
gis par le Code de l’action sociale et des familles [Loi
311-1, L 312-1. Articles D 312-11 à D 312-59]. La cir-
culaire n°89-17 du 30 octobre 1989 et l’annexe XXIV
au décret n°89-798 du 27 octobre 1989 regroupent
sous l’appellation « IME » les institutions spécialisées
dans les soins et l’éducation (voir « IMP » et « IMPro »).
Les Instituts médico-pédagogiques (IMP) prennent en
charge des enfants handicapés de six à quatorze ans
(l’institut peut obtenir un agrément de la préfecture pour
accueillir des enfants dès l’âge de trois ans). Ils ont
pour principales missions :
• l’éducation générale et pratique adaptée aux pos-
sibilités intellectuelles de chacun ;
• une formation gestuelle pour développer l’habilité
manuelle ;
• une scolarité élémentaire selon les aptitudes de
chacun ;
• etc.
Ces établissements fonctionnent sur le principe de la
loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées ». Cette loi apporte un regard neuf
sur le handicap : la scolarisation en milieu ordinaire de-
vient la règle et non plus « une priorité », et la scola-
risation en établissement adapté n’intervient qu’en-
suite, en complément et en vue d’une intégration pos-
sible, au bénéfice de l’enfant.
Les Instituts médico-professionnels (IMPro) accueil-
lent des adolescents atteints de déficience mentale
et/ou motrice, orientés par la CDAPH, dès 14 ans et
jusqu’à 20 ans (les jeunes adultes handicapés peu-
vent être maintenus dans les établissements pour
adultes handicapés). Les IMPro assurent :
• une éducation générale et une formation profes-
sionnelle, en fonction du handicap ;
• des connaissances tendant à l’acquisition maximale
des éléments d’autonomie, au développement
des attitudes et au savoir-faire professionnel.
Les établissements sont soumis aux mêmes lois en
vigueur dans les IMP (loi du 11 février expliquée dans
« IMP »). La Sécurité sociale assure l’ensemble des
frais liés à la prise en charge médico-éducative
dans le cadre d’un « prix de journée ».
Les Instituts d’éducation motrice (IEM) accueillent des
enfants ou adolescents présentant une déficience mo-
51
Doc'AMP Hors-série n°1 Les champs d’intervention

trice importante, nécessitant des moyens spécifiques
pour le suivi médical, l’éducation spécialisée, la for-
mation générale et la profession. Ils sont financés par
l’Assurance maladie, gérés par des associations (par
exemple, l’Association des paralysés de France,
créée en 1933 et reconnue d’utilité publique en 1945,
la fondation Hopale…), et régis par le décret 89-798
du 27 octobre 1989 qui fixe « les conditions techniques
d’autorisation des établissements et services prenant
en charge des enfants ou adolescents handicapés mo-
teurs par les établissements et services d’éducation
spéciale ».
Cette prise en charge, qui varie en fonction de la na-
ture et du degré de la déficience, comporte en général :
• la surveillance médicale, les soins, le maternage et
l’appareillage ;
• l’éducation motrice ou les rééducations fonction-
nelles ;
• l’éveil et le développement de la relation entre l’en-
fant et son entourage ;
• l’enseignement et le soutien pour l’acquisition des
connaissances, du niveau culturel, l’éducation phy-
sique et sportive ;
• des actions d’éducation spécialisée tendant à dé-
velopper la personnalité et l’autonomie sociale ;
• l’accompagnement de la famille et de l’entourage
de l’enfant ou de l’adolescent ;
• etc.
Auprès de la personne âgée
Les Etablissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) sont des maisons de
retraite conventionnées (92 % des maisons de retraite
en 2008) qui peuvent accueillir des personnes âgées
dépendantes, et prendre en charge des handicaps et
des maladies « légères ».
Les EHPAD tiennent leur appellation de la réforme des
établissements hébergeant des personnes âgées dé-
pendantes, initiée par la loi du 24 janvier 1997, les dé-
crets d’application du 26 avril 1999 (n° 99-316 et 317),
du 4 mai 2001 (n° 2001-388) puis par la loi du 20 juil-
let 2001 et ses décrets d’application de novembre
2007. « La réforme de la tarification » a consisté à pas-
ser d’un mode binaire (prix de journée + forfait cure
maladie) à un mode ternaire (soins, hébergement, dé-
pendance), mais porte aussi sur d’autres domaines
comme la qualité des prestations offertes par les éta-
blissements.
De plus, ces établissements ne pourront accueillir des
personnes âgées dépendantes qu’après signature
d’une convention tripartite avec le président du
conseil général ou le département, l’Etat (ou la
DASS) et l’établissement, pour une durée de cinq ans
renouvelable. Dans ces établissements, les AMP peu-
vent accompagner les personnes dans les gestes de
la vie quotidienne (repas, toilette…), dans des activi-
tés, animations, tout en restant attentives à « l’indi-
vidualité » de la personne dont elles s’occupent (et
moins du « groupe »).
Les EHPAD sont à distinguer des EHPA, Etablissements
d’hébergement pour personnes âgées, qui accueillent
des personnes âgées non ou peu dépendantes
(c’est-à-dire les 8% des établissements restants).
Les Logements foyers, créés dans les années 60, pro-
posent une formule intermédiaire entre le domicile et
la maison de retraite, et permettent à la personne de
conserver une indépendance de vie. Certains sont mé-
dicalisés ou disposent d’une section de cure médi-
cale. Ces foyers constituent un groupe de logements
autonomes (de type F1 ou F2), et offrent l’accès à la
location voire à la propriété. En plus de ces logements
privatifs, la personne peut bénéficier d’espaces com-
muns (restaurant, salle à manger…) et de services col-
lectifs facturés et facultatifs (restauration, blanchis-
serie…).
L’hébergement est donc à la charge des personnes
âgées, qui peuvent bénéficier de différentes aides fi-
nancières :
• l’Aide sociale au logement (APL et AL), pour les frais
de loyer, financée par la caisse d’allocation familiale
[Formule mise en place dans le cadre des finance-
Doc'AMP Hors-série n°1 Les champs d’intervention
52

ments HLM, article R.351-55 du Code de la
construction et de l’habitation] ;
• l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) financée
par le Conseil général et admise à condition que la
résidence soit habilitée.
En 2008 on dénombre environ 2800 Logements
foyers.
Les Maisons d’accueil rural pour personnes âgées
(MARPA) ont été inaugurées dans les années 80 par
la Mutualité sociale agricole (MSA). La MSA, souhai-
tant réagir face à l’exil des personnes âgées vers les
maisons de retraite implantées en ville, offrait par ce
nouveau moyen d’hébergement une solution pour
continuer à vivre dans un environnement familier.
Aujourd’hui les MARPA proposent :
• de préserver au maximum l’autonomie de vie de leurs
résidents,
• à l’intérieur d’un lieu de vie incluant une dimension
et un fonctionnement de type communautaire,
voire familial,
• tout en proposant une polyvalence et une intervention
modulée des services, selon les besoins de la per-
sonne.
Nécessitant peu de personnel pour assurer leur
fonctionnement, les frais de séjour sont modérés et
la personne âgée s’acquitte mensuellement du paie-
ment de son loyer. Selon ses ressources, elle peut pré-
tendre à l’Allocation logement ou à une Aide per-
sonnalisée au logement (APL) ainsi qu’à l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA) du conseil général,
selon son degré de dépendance.
Les MARPA sont gérées soit par une association loi
1901 soit par une collectivité locale, et sont regrou-
pées au sein de la Fédération nationale des MARPA.
Les Maisons d’accueil pour personnes dépendantes
(MAPAD) : La fin des années 80 marque la montée
en puissance de la dépendance, le ministère de la
Santé et de la Sécurité sociale lance alors un
concours d’idées pour la conception d’une nouvelle
génération de maisons de retraite, donnant vie aux MA-
PAD. Ces établissements sont insérés en centre ville,
dans un environnement où l’aspect médical ne serait
pas trop apparent (rappelant ainsi le domicile). Ils
s’adressent en priorité aux personnes âgées dépen-
dantes, voire très dépendantes, ayant besoin de l’as-
sistance permanente d’un personnel spécialisé pour
les accompagner dans les gestes de la vie quotidienne
(se lever, se laver, se nourrir, s’habiller…). De plus, ils
sont équipés d’une section de cure médicale (qui peut
représenter les ¾ de la capacité de l’établissement).
Ces résidences de retraite médicalisées sont soumises
à autorisation administrative et structurées par la loi
du 2 janvier 2002. Les agréments, délivrés par le
conseil général après avis de la DDASS, sont renou-
velés chaque année après contrôle. La plupart des MA-
PAD comportent un Cantou (Centre d’activités na-
turelles tirées d’occupations utiles).
Les Maisons d’accueil pour personnes âgées (MAPA)
sont nées dans les années 80, dans le même
contexte qui a vu naître les Maisons d’accueil pour
personnes dépendantes (MAPAD). Les MAPA sont
conçues pour recevoir des personnes âgées qui, sans
relever d’une prise en charge médicale, sont dans l’in-
capacité de vivre à domicile. Dans les MAPA, le mode
de vie est collectif. Ces établissements sont situés à
proximité du centre ville pour que les résidents
conservent une vie sociale normale.
Le Centre d’activités naturelles tirées d’occupations
utiles ou Cantou, créé en 1977, fonctionne de manière
détachée : il s’agit de petites unités autonomes ou in-
tégrées dans des établissements médicalisés pour des
personnes âgées, et qui disposent d’un équipement
adapté à la surveillance des personnes âgées déso -
rientées (type Alzheimer). La personne sera appelée
à participer, selon ses possibilités, à la vie quotidienne
du Cantou : épluchage, vaisselle, mise du couvert…
Le personnel d’encadrement est formé à la prise en
charge des personnes âgées désorientées et partage
53
Doc'AMP Hors-série n°1 Les champs d’intervention
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%