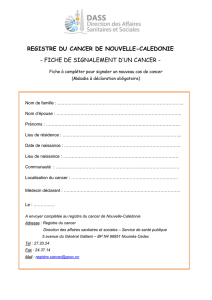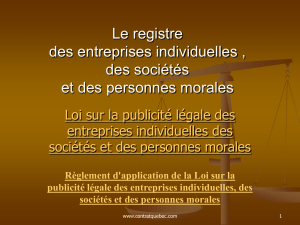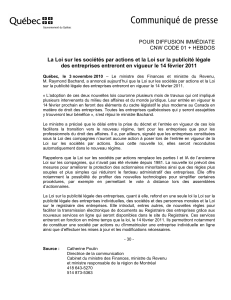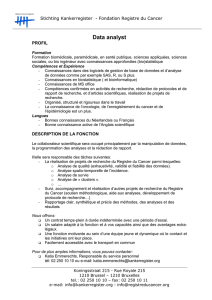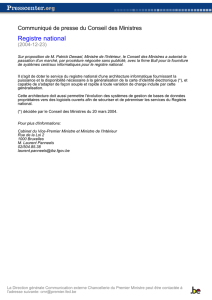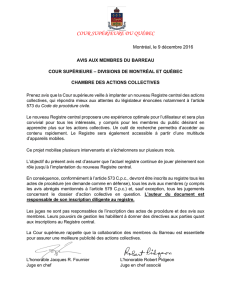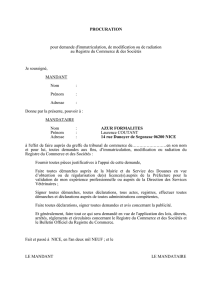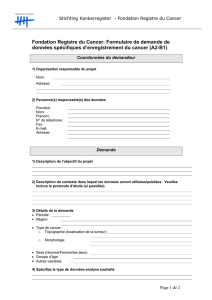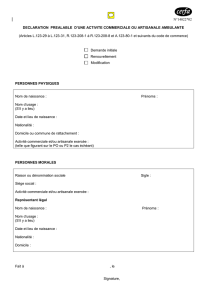télécharger ce document (74 ko)

Secret et transparence
Le Vice ou la Vertu ?
L’information sur les entreprises à la croisée des chemins
L’information légale, par qui et comment ?
À l’heure de l’Internet, faut-il repenser la diffusion de
l’information légale dans un contexte international?
TABLE RONDE introduite et animée par Jacques DRAGNE,
Président de chambre à la Cour d’appel de Douai, ancien
Directeur général adjoint de l’INPI
Jacques DRAGNE.– L’information légale, par qui ? À quelques exceptions près – dont la
plus connue est sans doute l’obligation faite aux commerçants et sociétés de mentionner, sur
certaines pièces, leur numéro unique d’identification d’entreprise et le lieu de leur
immatriculation –, l’information légale sur les entreprises met en œuvre des supports qui leur
sont extérieurs. Ces supports consistent essentiellement en des journaux et registres publics,
définis par la loi. Ils présentent la particularité de faire intervenir une pluralité de gestionnaires,
soumis à une grande variété de statuts. En effet, des opérateurs privés (les journaux habilités à
recevoir les annonces légales) côtoient à la fois des officiers publics titulaires de charges (les
greffiers des tribunaux de commerce chargés de la tenue du registre du commerce pour le
ressort de leur tribunal), un établissement public (l’Institut national de la propriété industrielle,
qui, notamment, centralise un second original des registres locaux) et, enfin, une administration
centrale (les journaux officiels en charge de l’édition du Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales, c’est-à-dire le BODACC).
Une autre originalité du dispositif tient à ce que, à côté de missions et d’informations qui
leur sont propres, ces intervenants vont assurer la diffusion d’informations portant sur les
mêmes entreprises et qui, souvent, se recoupent, sauf à avoir été conçus pour l’être selon des
modalités différentes. L’observation vaut pour les commerçants, personnes physiques (registre
du commerce et des sociétés dans sa double composante greffe et INPI ; BODACC) comme
pour les sociétés (annonce légale dans un journal habilité ; registre du commerce dans sa
double composante ; BODACC).
Cette superposition a été voulue. Elle est apparue comme le moyen de donner aux
informations concernées une diffusion à la mesure de l’enjeu. Un enjeu qui était, à l’origine,
d’ordre essentiellement juridique. Il s’agissait d’assurer la sécurité des transactions : ce qui
explique, d’ailleurs, certains effets de droit qui s’attachent souvent aux formalités de publicité.
On pense par exemple à l’inopposabilité des faits et actes non publiés, c’est-à-dire la faculté
pour les tiers qui y ont intérêt à tenir ces faits et actes pour inexistants lorsqu’ils n’ont pas été
publiés. Il faut bien reconnaître que, pendant longtemps, l’efficacité voulue par le législateur
restait très imparfaite. Exception faite de quelques institutionnels, rares étaient les opérateurs
de l’économie qui avaient directement recours à l’information légale – sauf peut-être par le biais
des annonces publiées dans les journaux d’annonces légales – pour s’informer sur leur
environnement, soit qu’ils en ignoraient même la possibilité, soit que la piètre commodité
d’accès les avait dissuadés.
Dans la pratique, c’est surtout a posteriori, au moment du procès, que leur avocat s’avisait
d’y chercher quelques failles susceptibles de fonder un de ces providentiels moyens de
Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr.
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 1

Secret et transparence
Le Vice ou la Vertu ?
L’information sur les entreprises à la croisée des chemins
procédure qui vient parfois au secours du plaideur en difficulté. Et quel merveilleux magicien
que cet avocat qui peut expliquer à son client, fournisseur impayé d’un commerçant insolvable
ou parti sans laisser d’adresse, qu’il va pouvoir rechercher le précédent exploitant ou
propriétaire du fonds parce que la cession n’a pas été publiée et lui est donc inopposable.
Les quinze dernières années ont marqué un profond changement. La loi n’y est pas pour
grand chose. On doit le changement aux nouvelles techniques de traitement et de diffusion de
l’information dont les gestionnaires de la publicité légale ont très tôt tiré parti en s’engageant,
soit directement dans la constitution de banques de données accessibles en ligne par voie
télématique – et je pense notamment à Infogreffe pour les greffes et à Euridile pour l’INPI –, soit
en favorisant la constitution de telles bases de données par des opérateurs privés auxquels
étaient cédées les informations sur support électronique, comme tel a été le cas des journaux
officiels.
Assez rapidement l’interrogation de ces bases de données a pris le pas sur les modes
classiques d’accès à l’information légale, c’est-à-dire les demandes d’extraits ou de copie
papier des registres ou le dépouillement des journaux ou des bulletins. Elle est devenue l’acte
réflexe des opérateurs de la vie économique intervenant, non plus a posteriori au stade du
contentieux comme je l’évoquais tout à l’heure, mais souvent avant toute décision et avant toute
action. Et, par là même, la publicité légale a, je crois, pris sa pleine signification, en même
temps qu’était conférée plus de légitimité aux effets de droit qui s’y attachent. La facilité d’accès
à la publicité légale, s’ajoutant d’ailleurs à l’extension de l’information obligatoire aux comptes
annuels des sociétés, a conféré à la publicité légale une autre dimension, d’ordre plus
économique : l’établissement d’une transparence minimale dans la vie des affaires.
Mais, parallèlement, la technique des banques de données accessibles en ligne à tout
moment, sans déplacement, a transformé en une certaine redondance ce qui avait été conçu
en termes de complémentarité. Le regroupement des greffiers au sein d’Infogreffe donne à leur
système informatique quelques effets de registre national. Les bases Infogreffe et Euridile
offrent des prestations de publicité portable, empiétant alors quelque peu sur l’objet des
bulletins et des journaux d’annonces légales. Le regroupement des annonces légales autour de
la désignation de l’entreprise, auquel procèdent les opérateurs privés, conduit à établir d’une
certaine façon des registres, au moins partiels.
L’ensemble de ces problèmes avait été abordé il y a dix ans, à l’initiative du CREDA, lors
du colloque déjà évoqué, de 1994 ( )1 . La demi-journée d’aujourd’hui doit conduire à nous
interroger sur le point de savoir si quelque chose à changé depuis dix ans. À titre personnel, je
ne le pense pas. Ceci étant, je suis désormais un observateur extérieur et, peut-être, mon
propos est-il un peu abrupt.
Cette table ronde devrait être l’occasion de faire le point de la question en abordant
successivement : la présentation des institutions et organismes gestionnaires de l’information
légale, afin de préciser les enjeux juridiques de leurs interventions ; l’impact des nouvelles
techniques de traitement, de stockage et de diffusion de cette information ; la question de
savoir si, notamment dans la perspective de l’application de la directive du 15 juillet 2003,
d’autres aspects de l’information légale ne doivent pas évoluer.
(1) CREDA, L’information légale dans les affaires, préc.
Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr.
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 2

Secret et transparence
Le Vice ou la Vertu ?
L’information sur les entreprises à la croisée des chemins
Je ne voudrais cependant pas laisser la parole aux intervenants sans saluer la présence de
Monsieur Assayag, qui en sa qualité de « registraire des entreprises » au Québec, pourra nous
indiquer quelle est son expérience et, peut-être, porter un jugement sur ce qui se fait dans notre
pays. Interviendront également au débat, outre les gestionnaires français du système de
publicités légales, un conservateur des hypothèques, qui nous rappellera quels sont les
principes régissant ce dispositif particulier d’information légale, un représentant des entreprises
privées, un représentant en quelque sorte des usagers de l’information légale.
Jean-Gaston MOORE, Président du Syndicat national de la presse judiciaire, Directeur
honoraire de la Gazette du Palais.– La table ronde à laquelle je participe dans le prolongement
du précédent colloque organisé par le CREDA le 1er mars 1994 et dont les travaux ont été
publiés par la Semaine Juridique, édition entreprises ( )2 .
Celui du 8 décembre 2004 tente, dix ans après, de faire le point sur l’actuelle position de
l’information légale dans les affaires : Quels enjeux ? Quelle évolution ? En 2004, comme en
1994, la conclusion de ces réunions a été assurée par le Professeur Catala avec le talent, la
maîtrise et l’intelligence que nous lui connaissons. L’information ou la publicité légale concerne
les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales, le Registre du commerce et
le Journal officiel. Ils sont complémentaires : les journaux habilités diffusent l’information par
leur publication au moins une fois par semaine tandis que le Registre du Commerce et l’INPI
sont la mémoire permanente de l’information de l’entreprise. Si on y ajoute les inscriptions du
Trésor et de la Sécurité Sociale, l’information sur l’entreprise et sa transparence sont ainsi
assurées par :
− Ceux qui portent à connaissances (les journaux habilités) ;
− Ceux qui la mémorisent, que l’on peut consulter par tous moteurs de recherche, qu’ils
soient traditionnels ou numériques.
Une étude portant sur les pays de l’Europe réalisée par Madame Régnard et Monsieur
Béder, Greffiers du Tribunal de commerce de Paris, confirme que la France est à l’avant-garde
de la transparence et de l’information des tiers. Nous appliquons cette obligation
magistralement, voire même au-delà des exigences de la directive communautaire de 1978 en
la matière.
La question posée par le colloque du 8 décembre était donc de savoir quelle était
l’évolution de l’information légale depuis dix ans, en présence de l’ère du numérique et de
l’Internet ? Nous pensons qu’il y a été répondu.
Globalement celle-ci était d’ores et déjà amorcée en 1994 ; les nouvelles technologies par
le biais des moteurs de recherche en sont en effet un vecteur idéal à condition que la sécurité
juridique de l’information recueillie soit garantie quant à son contenu et ses sources.
Pour en comprendre les enjeux, il faut préalablement rappeler les fondamentaux suivants :
− Il convient de distinguer les informations portées à connaissance (apportées), de celles
recherchées. Sans celles « apportées » hebdomadairement par les journaux habilités,
(2) Colloque précité, note 5.
Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr.
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 3

Secret et transparence
Le Vice ou la Vertu ?
L’information sur les entreprises à la croisée des chemins
responsables de leur contenu, de leur validité et de leurs sources, il n’y a pas de sécurité
juridique dans le domaine de l’information au quotidien et notamment dans celui de sa
mise en mémoire.
− Cette sécurité est la condition de la fiabilité de l’information des entreprises : par suite,
elle ne pourrait être laissée à la discrétion d’organes non reconnus et non responsables.
Certes, depuis 1994, les modes d’accès à l’information se sont perfectionnés et il est à
noter que les greffes, mémoire de la transparence, ont suivi sur ce point. Ceci étant, une
évolution tenant compte de ces nouvelles technologies doit être envisagée dans le mode des
« portés à connaissance ».
Arnaud Reygrobellet a soulevé ce point. Une entreprise tenue d’effectuer une publicité dans
un journal habilité, en vertu de la loi, ne pourrait-elle pas éditer celle-ci et la mettre en ligne sur
son site Internet ou par le biais d’un site spécifique ayant pour objet même cette diffusion ? La
publicité des « portés à connaissance » serait reprise par les greffes et la mise en mémoire.
Réponse : cette suggestion d’une évolution est séduisante mais deux objections peuvent
être avancées :
1) D’une part, elle installerait l’insécurité juridique de l’information et ses conséquences.
En effet, des informations fausses ou inexactes portées à connaissance pourraient être
de nature à mettre en péril ou à nuire aux entreprises.
2) D’autre part, même si l’origine de l’information ainsi diffusée n’est pas contestée,
subsisterait néanmoins la question de la validité de son contenu et de la fiabilité de ses
sources, difficultés à ce jour résolues par la responsabilité qui incombe aux journaux
d’annonces légales de garantir ces aspects.
C’est pourquoi, en conclusion, l’intervenant écarte cette solution peu fiable d’évolution du
porté à connaissance.
Cette problématique n’est pas propre à notre matière. Elle en préoccupe d’autres. Il en va
ainsi de la dématérialisation des marchés publics qui prévoit qu’à partir du 1er janvier 2000, les
collectivités territoriales seraient dans la capacité de recevoir des offres présentées sous forme
électronique : présomption obligatoire, notamment en matière d’appel d’offre. « Mais s’assurer
de la confidentialité de ces données, de l’identification de leurs sources, de l’intégralité de leur
contenu et de la longévité des données d’archivage ne peut se faire que par l’utilisation d’un
site Internet sécurisé et fiable, organisé par un professionnel spécialisé ». Cette
recommandation préfectorale aux collectivités territoriales rejoint nos préoccupations.
L’évolution du porté à connaissance par les journaux habilités qui assurent la fiabilité des
sources et la validité du contenu des informations, peut avoir un prolongement par le biais de
l’outil Internet à condition que celui-ci se fasse au moyen d’un site sécurisé et fiable, organisé
par les journaux habilités et hébergé sous notre responsabilité.
Telle est pour nous la condition nécessaire d’une publicité légale que nous souhaitons
élargie, prenant en compte l’évolution des contrats affectant les entreprises – la liste en est
longue à titre énonciatif et non limitatif.
Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr.
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 4

Secret et transparence
Le Vice ou la Vertu ?
L’information sur les entreprises à la croisée des chemins
Il en va ainsi des cessions de marques ou de brevets, certes publiées à l’INPI mais non au
registre du commerce (or la cession d’une marque équivaut généralement à celle d’un fonds) ;
des cautionnements donnés par les chefs d’entreprise qui devraient être inscrits, telles les
inscriptions du Trésor ou de la Sécurité Sociale, au registre du commerce ; des nantissement
de parts sociales ou d’actions (qui devraient à tout le moins être inscrits au registre du
commerce) ; des contrats de leasing ; des ventes avec réserve de propriété ; ou mieux encore,
les hypothèques portant sur les biens immobiliers d’une entreprise qui ne sont ni inscrites ni
mentionnées au registre du commerce. N’était-ce pas une des lectures dénoncées en 1991 au
Congrès des greffiers des Tribunaux de commerce d’Angoulême par les éminents Professeurs
Beauchard et Croze () 3?
La clandestinité nuit à la transparence, à la sécurité juridique et à la protection des tiers.
Voici donc une évolution souhaitée vers une meilleure transparence en raison de l’évolution
des modes de crédit de l’entreprise.
La publicité destinée aux tiers est insuffisamment adaptée à la réalité économique
d’aujourd’hui, elle méconnaît les nouveaux contrats comme la réserve de propriété ou le
leasing ignorés autrefois, sans oublier la généralisation du cautionnement. Rien n’a bougé de
cette situation depuis 1994.
Cette regrettable constatation mériterait d’être prise en compte pour l’avenir, dans l’intérêt
de la sécurité juridique des entreprise et des tiers.
Mariette SERRES, Conseiller juridique, Direction générale, INPI, Membre du Comité de
coordination du RCS.– Le président Jacques Dragne vient de rappeler la permanence des
acteurs. Quoi de plus naturel pour une institution qui remonte au Moyen Âge et qui s’est
constituée à partir de l’organisation corporatiste des marchands pour aboutir au milieu du
XXe siècle au registre tel qu’on le connaît.
Cette permanence, c’est un registre local tenu par les 191 greffes des tribunaux de
commerce auxquels s’ajoutent les 35 tribunaux d’instance, tribunaux de grande instance et
tribunaux mixtes statuant commercialement. On peut souligner la coexistence de greffiers,
officiers publics et ministériels et de greffiers fonctionnaires. Les informations de ces
226 greffes sont centralisées à l’Institut national de la propriété industrielle qui assure la tenue
du registre national du commerce et des sociétés.
Les informations que l’on trouve au registre concernent quelque 3 772 000 entreprises
dont : 1 000 000 de personnes physiques commerçantes ; 1 600 000 sociétés commerciales ;
1 150 000 sociétés civiles et d’exercice libéral.
L’ensemble de ces données correspond à 65 kms d’archives vivantes consultées tant au
niveau national qu’au niveau local. Ces archives, mises à jour de manière permanente,
représentent plus de 5 000 mises à jour quotidiennes.
La sécurité de cet instrument déclaratif est assurée par le contrôle qu’exerce le greffier.
(3)La publicité des garanties : Gaz. Pal., 30 mai 1993, p. 4.
Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr.
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%