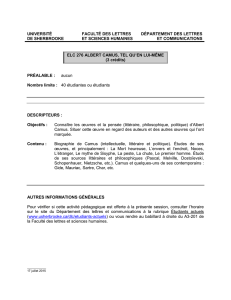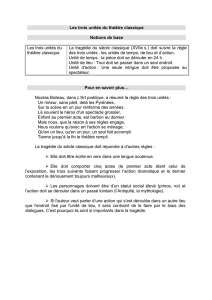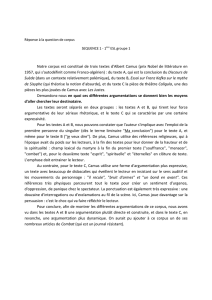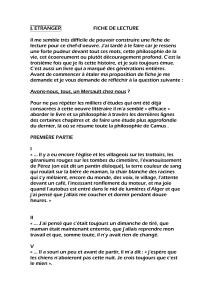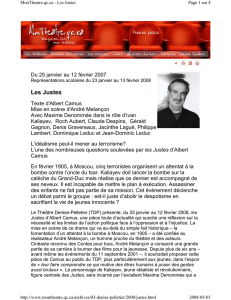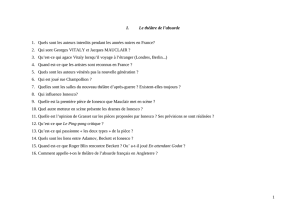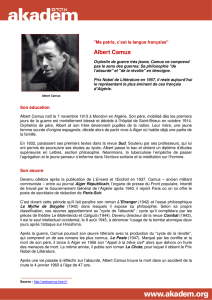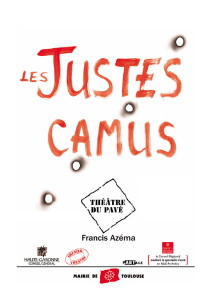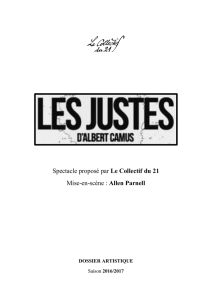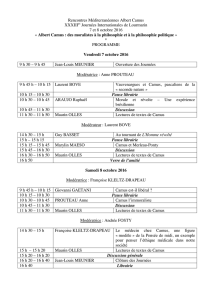Théâtre Essai sur Les justes, d`Albert Camus, 15 décembre 1949

Théâtre
Essai sur Les justes, d’Albert Camus, 15 décembre 1949
Camus présente différentes conceptions de la révolution :
• L’idéalisme : Yaneck ne veut pas tuer les enfants ; il incarne la sagesse
• L’anarchie : Stepan qui veut détruire au nom d’une idéologie
Ils n’ont pas les mêmes motivations ; elles sont en fonction de leur vécu
La pièce est dominée par l’opposition entre ces deux personnages
➢ Stépan incarne le terrorisme radical ; il a connu le bagne durant plusieurs
années pendant lesquelles il a vu ses camarades se suicider à ses côtés. Le
territoire de ses pertes est infini. Il est cet homme « perdu pour la société »
que décrit le cathéchisme révolutionnaire de Bakounine : toutes les cibles
servent la cause de son organisation dès lors qu’elles symbolisent l’adversaire.
Qu’importe s’il faut sacrifier un enfant dès lors que la cible, à travers lui, sera
atteint ! Déshumanisée, la victime n’est que le support d’un message de
terreur. Stepan est un messager de la mort ! Humilié, il est habité par le
ressentiment ; persécuté, il devient un persécuteur !
➢ Kaliayev est son inverse : il hésite avant de lancer la bombe dans la calèche du
Grand Duc. Il confie à ses amis qu’il n’a pu détacher son regard des deux
enfants qui s’y trouvaient. Il vit un conflit entre le dévouement à la cause et
son humanité qui lui interdit de tuer un enfant !
Contrairement à Stepan, Kalayev et Dora, sa compagne, gardent la mémoire
d’un monde de relations humaines. Ils savent que l’anéantissement de tout
lien humain ruine à terme toute action politique digne de ce nom. Une
commune mesure d’humanité se superpose à l’acte terroriste. Leur geste
demeure partie prenante non pas d’une communauté imaginée mais d’un
monde réel et commun à tous !
A l’image de l’Organisation de Stépan, un terrorisme mondialisé comme celui d’Al-Quaida
est radicalement nihiliste ! C’est un terrorisme qui sacralise la mort de l’adversaire par tous
les moyens et celle du martyre ! Pour lui la violence n’a aucune finalité politique ! Quel
monde pourrait renaître après un tel embrasement sanglant ? Pourtant le le jugement moral
ne disparaît pas totalement dans certaines formes plus politiques et territorialisées de
terrorisme, par exemple au Moyen-Orient. On a vu le conflit moral qui est au centre des
Justes traverser une jeune Palestinienne qui n’a pu se résoudre à faire exploser sa bombe en
plein centre de Jérusalem ! On l’a vu aussi chez certains objecteurs de consciences de
l’armée israélienne qui refusent des pratiques de l’armée qui s’apparentent à « un
terrorisme d’occupation ». Il est vrai que sans excuser cette violence, il faut aussi en
comprendre le sens pour mieux la comprendre !
Camus suggère que la violence ne doit pas tenir lieu de ligne politique ; elle doit
rester un moyen de lutte, à la fois provisoire et contrôlé.
Nous retrouvons dans cette pièce le style du dialogue d’idées et le sujet est pris dans
l’histoire, le terrorisme sous les tsars et l’assassinat réel du grand Duc Serge.
Trois personnages principaux : Stepan, Kalayev et Dora.
• Pour Stepan, « la bombe seule est révolutionnaire » : la révolution légitime le crime,
TOUS les crimes ; il a appris et compris au bagne qu’une discipline est nécessaire
pour abattre la tyrannie ; il n’hésiterait pas à tuer un enfant si l’Organisation le lui
commandait ; il « n’aime pas la vie mais la justice qui est au-dessus de la vie ».

• Kalayev, lui, a soif d’une justification plus humaine. Il aime la beauté, le Bonheur, il
est « poète ». « La révolution bien sûr, s’écrie-t-il, mais la révolution pour la vie, pour
donner une chance à la vie ». S’il accepte d’être criminel, c’est pour que « la terre se
couvre enfin d’innocents ». Ainsi, au moment de jeter la bombe sur la calèche du
grand Duc, il recule car il a vu des enfants dans la voiture, qu’il ne se résout pas à
tuer, et les conjurés dans l’ensemble l’approuvent.
A Stépan qui l’insulte, Kalayev répond : » Moi, j’aime ceux qui vivent aujourd’hui sur
la même terre que moi. C’est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Et
pour une cité lointaine dont je ne suis pas sûr, je n’irai pas frapper le visage de mes
frères. Je n’irai pas ajouter à l’injustice vivante pour une justice morte…Tuer des
enfants est contraire à l’honneur. Et si…la révolution devait se séparer de l’honneur,
je m’en détournerais…J’ai choisi d’être innocent. »
• Mais le personnage central et significatif est Dora : elle réclame « les êtres, les
visages…l’amour plutôt que la justice », elle demande pitié pour les justes
condamnés à se retrancher de ce monde.
Kalayev finira par accomplir sa tâche, et Stépan lui rendra justice. Et dans sa cellule,
comme Meursault, dans l’attente de la dernière nuit, après avoir refusé « les
consolations de la religion », il mourra réconcilié avec ses frères d’armes comme avec
lui-même : « mourir en homme comme un Juste ».
G. P.
Les Justes, une tragédie moderne
« J’ai beaucoup réfléchi au problème de la tragédie moderne. Le malentendu, l’Etat de
siège, et les Justes sont des tentatives, dans des voies chaque fois différentes et des styles
dissemblables, pour approcher de cette tragédie moderne. » A. Camus, 1958
Et dans ses carnets Camus désigne les Justes comme une tragédie.
• « Ils ont tous raison », Camus.
Une conférence donnée par Camus à Athènes en 1955, donne une idée de ce qu’il entend
par tragédie classique tout en laissant dans le vague ses possibilités de renouvellement
contemporain. Pour Camus, le sentiment tragique ne peut s’exprimer que dans un équilibre
déchirant : le moment tragique est ce point limite où personne n’a raison ni tort.
Camus : « Autrement dit, la tragédie est ambigue, le drame simpliste. (…) La formule du
mélodrame serait en somme : »un seul est juste et justifiable » et la formule tragique par
excellence : « tous sont justifiable et personne n’est juste ».
Les acteurs sont là, prêts à s’affronter. Le Destin n’a pas déserté l’époque moderne mais il a
juste changé de visage et pris les traits de l’Histoire ! Quant aux héros tragiques, il faut aller
les chercher moins hauts qu’au dix-septième siècle, là où vivent et meurent les créatures,
auprès des chiens qui accompagnent de leurs aboiements l’exécution de Kalayev.
• Pitié pour les Justes ?
La tension tragique provient de l’affrontement d’idées contradictoires ou comme l’explique
Camus en 1955, de «personnages égaux en force et en raison ». La construction de la trame
des Justes repose sur des conflits successifs qui donnent progressivement de l’ampleur
dramatique à la pièce. Le dilemme revient à choisir l’individu ou le groupe en sacrifiant tout
le reste : les enfants ou le peuple, l’amour d’un seul ou l’amour de tous, le bonheur
individuel ou collectif et, finalement, la Liberté ou la Justice ! tout cela en cinq actes…

Les Justes est donc une tragédie moderne parce que, faisant entendre la douleur de
chacun, la pièce dresse les hommes et leur raison les uns contre les autres en
éclairant la complexité de tout choix social ou métaphysique. Parce que les
personnages, incapables finalement de se dévoiler à celui à qui, seul, pourrait les
entendre et les comprendre, font du spectateur le témoin de la fatalité d’un
malentendu. Parce que broyés par l’Histoire, les Justes sont condamnés à
éternellement recommencer, comme Sisyphe : recommencer à tuer, « recommencer,
Dora… ». Et ils n’ont pour seule porte de sortie que d’aller avec lucidité, une fois
encore, jusqu’au bout du drame et de leurs contradictions pour en faire le récit.
Le spectateur peut alors admirer des hommes et des femmes qui vivent leurs
déchirements jusqu’à la mort, mais il aura surtout affronté ses propres doutes et
peut-être perdu quelques certitudes. Camus disait :
« Le théâtre laisse entendre par exemple que chacun porte en lui une part d’illusion et
de malentendu qui est destinée à être tuée. »
Une véritable tragédie :
➢ Respect des règles de bienséance propre à la tragédie classique : la mort n’est
pas montrée sur scène pour ne pas choquer le spectateur d’où l’idée de
raconter la scène par Stepan et Kalayev. Le récit se supplante à la scène de de
mise à mort
➢ Respect de la structure : pièce en cinq actes
➢ Respect du thème : l’homme face à ses passions, ses ambitions, son destin.
Thème de la révolte.
➢ Inspiration de la crainte et de la compassion par la mise en scène d’un héros
pris dans un conflit, un héros qui souffre d’amour pour raison d’état, raison
politique. Héros confronté à un dilemme insoluble, un choix à faire entre son
bonheur d’homme privé et ses responsabilités d’homme juste et public. :
Amour personnel impossible à vivre pleinement/ Amour sacrifié à une cause
plus grande.
➢ Tonalité tragique et pathétique : cris, souffrance, émotions, doutes…
➢ Un dénouement malheureux : mort du héros inéluctable (Dora et Kalayev)
➢ Générosité en lutte avec le désespoir : pièce où règne le combat entre
l’Amour de la vie et le désir de la mort ! d’où ce côté calme et serein parfois !
➢ Les retrouvailles des amants dans la mort : (fin) Echec à l’épigraphe de la mort
de Roméo et Juliette « O love ! O life ! – not life, but love in death ! »…Dora
elle, veut poursuivre l’action en lançant la prochaine bombe et souhaite ainsi
indirectement sacrifier sa vie comme Kalayev et ainsi le rejoindre dans la mort
tout en servant l’Organisation.
La mort pour une juste cause :
➢ « Etre juste » : l’idée de la justification ; ils tuent certes pour une idée mais ne
mettent pas l’idée au-dessus de la vie humaine. Ils vivent à la hauteur de
l’idée et ils la justifient pour finir en l’incarnant jusqu’à la mort. Ce qu’appelait

A. Camus, « les meurtres délicats ». Vision juste et humaine du monde : un
idéal révolutionnaire au nom d’un Bonheur universel !
➢ Fonction morale de la tragédie classique : réfléchir sur son destin, sur soi-
même, sur le fait que l’homme se justifie par et à travers ses actes. L’homme
agit et devient lui-même !
➢ Les Justes : personnages désespérés qui veulent être capturés pour justifier
leur geste et leur combat !
➢ La mort comme seule issue et comme seule justification possible !
➢ Le sacrifice et le don de soi : mourir pour une cause noble et juste ; ils se
battent pour faire cesser leur asservissement, le despotisme et l’hypocrisie. Ils
veulent le bonheur du genre humain.
➢ Mourir pour ses idées : acte d’héroisme et de résistance (CF : sens classique
du terme de « juste » qui désigne celui qui accomplit les actes vertueux que
lui indique sa raison délibérative. Aristote en donnait cette définition : « Nous
appelons juste ce qui est susceptible de créer ou sauvegarder en totalité ou
en partie, le bonheur de la communauté politique ». Le Juste connaît le Bien
et s’applique à le protéger.
➢ Mourir dans l’honneur : et pas dans la compromission, refus du chantage,
même affectif !
➢ Ils tuent pour que d’autres vivent et ils se tuent pour que d’autres naissent
dans des temps meilleurs qu’ils savent qu’ils ne verront jamais, en justifiant
leur meurtre par leur propre mort, inéluctable et nécessaire !
« Acte de Désespérance », comme dit le critique Couleau.
Le projet de Camus pour le théâtre de son époque, pourrait donc être aussi celui de la
nôtre ! « Les absences, les manques et les rêves des hommes de théâtre se ressemblent
génération après génération : « je veux montrer que le théâtre d’aujourd’hui n’est pas celui
de l’alcôve ni du placard. Qu’il n’est pas non plus un tréteau de patronage, moralisant ou
politique. Qu’il n’est pas une école de haine mais de réunion. Notre époque a sa grandeur
qui peut être celle de notre théâtre. Mais à la condition que nous mettions sur scène de
grandes actions où tous puissent se retrouver, que la générosité y soit en lutte avec le
désespoir, que s’y affrontent, comme dans toute vraie tragédie, des forces égales en raison
et en malheur, que batte enfin sur nos scènes le vrai cœur de l’époque, espérant et
déchiré. » Albert Camus.
G. P.
1
/
4
100%