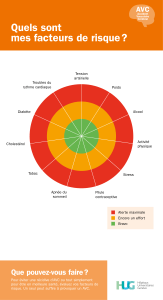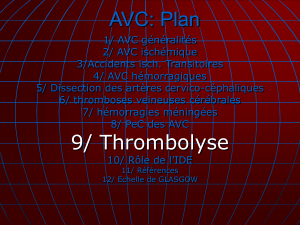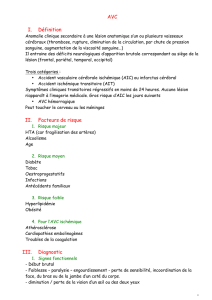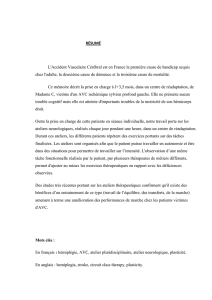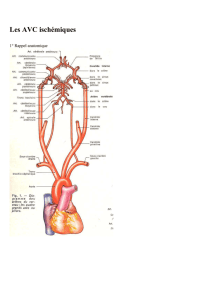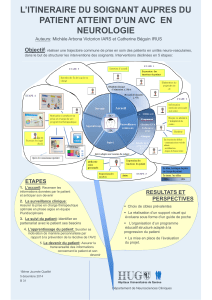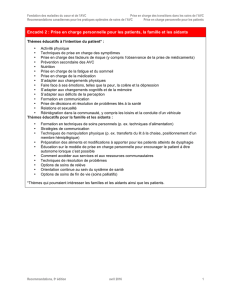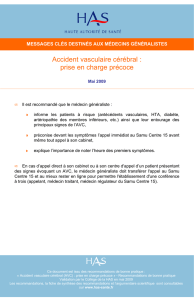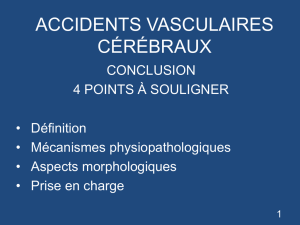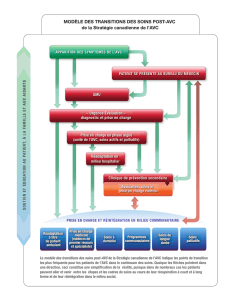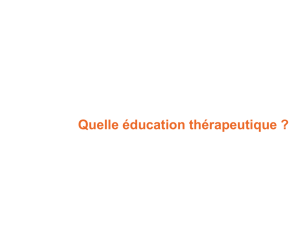Prise en charge initiale des accidents vasculaires cérébraux

Isabelle MOURAND - Didier MILHAUD
Prise en charge initiale des
accidents vasculaires
cérébraux
Le pronostic des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) demeure,
actuellement en France, sévère avec 50.000 décès par an. Parmi les
survivants, plus de la moitié présentent des séquelles, physiques,
cognitives ou psychologiques.
Les progrès récemment réalisés dans le diagnostic des AVC (scanner, IRM, explorations
ultrasonographiques vasculaires et cardiaques) doivent conduire les médecins à passer
d'une attitude, bien souvent, attentiste à une attitude active. En effet, il est indispensable
de porter rapidement un diagnostic le plus précis possible face à un AVC, quant à sa
nature et à sa cause, afin de mettre en œuvre des mesures de prise en charge et de
thérapeutiques générales adaptées et, d'envisager la prévention secondaire.
Ces patients doivent donc être identifiés, évalués et, acheminés à l'hôpital dans les
meilleures conditions de sécurité et, sans délai.
Huit à 10% des AVC ischémiques aigus nécessiteront une hospitalisation dans une unité
de soins intensifs (1).
RAPPELS CLINIQUES
DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES :
Les accidents vasculaires cérébraux représentent actuellement en France la 3ème cause
de mortalité, après la pathologie cardio-vasculaire et les cancers, avec une incidence
annuelle de 125.000 nouveaux cas (1,5/100.000/an).
Le risque de récidive après un AVC Ischémique (AVCI) est élevé, surtout la première
année. A 5 ans ce risque est évalué à 30%.
Après un AVCI, la mortalité est doublée par rapport à la population générale. Prés de
50% de ces patients décèderont au cours de la première année, le plus souvent de
cause cardio-vasculaire. Un quart garderont un handicap sévère nécessitant une prise
en charge lourde. Les séquelles secondaires aux infarctus cérébraux représentent en
France la première cause de dépendance.
Le retentissement socio-économique des AVC est donc considérable d'autant plus que
l'incidence, en régression durant les trente dernières années, est actuellement en
augmentation. Celle-ci est notamment à corréler au vieillissement de la population.
Outre les moyens de prévention primaire et secondaire, il apparaît nécessaire de
développer des systèmes de prise en charge en réseaux et/ou en filières concernant tout
à la fois l'alerte, le transport primaire, la prise en charge hospitalière, la rééducation et la
réinsertion. A ce titre les "Stroke centers" devraient se développer. En effet, il est
1 sur 12

maintenant bien admis qu'ils permettent une réduction significative de la mortalité,
du
taux de mauvais pronostic et de la durée de séjour (2,3).
AVC ISCHÉMIQUE ET HÉMORRAGIQUE : DÉFINITION, GÉNÉRALITÉS :
Selon la définition internationale(4) un AVC correspond à un "déficit neurologique
soudain d'origine vasculaire présumée". Cette définition, apparemment simple,
implique d'une part une lésion parenchymateuse responsable du déficit neurologique, et
d'autre part une lésion vasculaire causale.
Parmi les AVC, 80% sont d'origine ischémique, contre 20% en rapport avec une
hémorragie.
Les accidents ischémiques résultent d'une réduction de l'apport sanguin global ou focal
au parenchyme. Selon le profil évolutif, on distingue, les accidents transitoires, en
évolution, ou constitués.
Les accidents hémorragiques incluent les hémorragies cérébrales (5 à 10%), méningées
(5 à 10%) ou cérébro-méningées, avec ou sans inondation ventriculaire.
Les lésions vasculaires responsables intéressent les artères ou, beaucoup moins
fréquemment, les veines. Pour ces dernières il s'agit le plus souvent d'une thrombose,
pourvoyeuse d'infarctus veineux, volontiers hémorragiques.
Les lésions artérielles responsables d'hémorragies sont essentiellement de trois types :
les malformations (anévrismes, angiomes caverneux, fistules artério-veineuses), les
altérations de la paroi artérielle au cours de l'hypertension artérielle, l'angiopathie
amyloïde (surtout chez le sujet âgé). En fonction de la lésion, le type d'hémorragie sera
différent.
Les lésions artérielles responsables d'accidents ischémiques sont presque toujours en
rapport avec une occlusion de mécanisme embolique (d'origine cardiaque ou artérielle),
thrombotique (avant tout athéromateux) ou lié à une anomalie de la paroi (artérites,
dissections...). Malgré la multiplicité des mécanismes en cause trois anomalies rendent
compte de plus de 90% des ischémies : l'athérosclérose (60 à 70%), l'embolie d'origine
cardiaque (10 à 20%), la lipohyalinose des artérioles perforantes responsable des
accidents lacunaires.
ZONE DE PÉNOMBRE ISCHÉMIQUE :
Autour de la zone de nécrose ischémique irréversible, territoire d'hypoperfusion sévère
constitué rapidement, il existe des régions dans lesquelles le débit sanguin est moins
diminué, se maintenant à des valeurs juste supérieures au seuil de nécrose (10
ml/100g/mn). Dans cette zone les cellules ne fonctionnent plus mais elles ne meurent
pas, c'est la zone dite de pénombre ischémique. Le tissu cérébral peut-être sauvé par la
restauration du flux sanguin. Cette notion a d'importantes implications dans la
thérapeutique à adopter à la phase aiguë de l'AVC. Le premier objectif doit donc être de
restaurer un débit sanguin cérébral normal. Toutefois, la viabilité de cette zone est
limitée et la pénombre ischémique se transforme en majorité en nécrose dans les 6
premières heures.
PRISE EN CHARGE INITIALE EXTRA-HOSPITALIÈRE
Etablir un diagnostic clinique précoce constitue une étape essentielle dans la prise en
charge des patients victimes d'un AVC. Cette évaluation doit permettre de répondre à
différentes questions d'ordre général et neurologique : un traitement vital doit-il être mis
en route ? La fonction respiratoire et l'état hémodynamique et tensionnel sont-ils
satisfaisants ? Existe-t-il des signes d'hypertension intracrânienne ? Existe-t-il une
affection sévère sous-jacente ? Quel sont les antécédents et les facteurs de risque
vasculaire du patient ? Quel délai s'est-il écoulé depuis le début des symptômes ? Le
2 sur 12

tableau clinique apporte-t-il des arguments en faveur d'un AVC ? Quel est son type,
le
territoire atteint, l'étiologie suspectée ? Quel est le pronostic et, vers quel type d'unité le
patient doit-il être adressé ?
Il est préférable que l'évaluation et le transport de ces patients soient réalisés par une
équipe médicale et paramédicale préhospitalière. Cela permet une approche
diagnostique plus précise, la possibilité de recourir à des moyens de réanimation et
l'administration plus rapide de thérapeutiques générales ou plus spécifiques (5).
LES MESURES GENERALES :
La prise en charge initiale du patient doit être focalisée sur des mesures d'ordre général
de réanimation que sont la respiration et la circulation.
Evaluation et surveillance respiratoire (5,6) :
Les problèmes respiratoires sont très communément présents chez les patients victimes
d'un accident hémorragique cérébral et/ou méningé, particulièrement en cas d'altération
de la conscience. Au cours des accidents ischémiques, la ventilation est habituellement
respectée sauf si coexistent des crises d'épilepsie, ou en cas d'infarctus du tronc
cérébral.
Lors de la prise en charge préhospitalière, il convient de veiller à établir, puis à maintenir,
une ventilation et une oxygénation adéquates, surtout s'il existe des troubles de la
conscience. En effet, l'hypoxie provoque la formation de métabolites anaérobies et une
déplétion des réserves énergétiques dans les tissus lésés, responsables de l'extension
lésionnelle. Les causes les plus communes d'hypoxie sont représentées par l'obstruction
des voies aériennes, l'inhalation pulmonaire, l'hypoventilation et l'atélectasie.
Pour éviter l'obstruction des voies respiratoires, notamment en cas d'altération de la
conscience, le patient doit être placé en position latérale de sécurité, la nuque en légère
extension et le visage tourné vers le matelas.
Si la ventilation est jugée instable, non satisfaisante ou en cas de sécrétions abondantes
non contrôlables, une assistance respiratoire doit être mise en route par ventilation au
masque voire, dans les cas plus sévères, par intubation endo-trachéale. La mise en
place d'une sonde naso-gastrique et l'évacuation gastrique sont nécessaires pour
améliorer la ventilation et prévenir l'inhalation. L'existence d'une hypoxie, éventuellement
confirmée par les gaz du sang, justifie une supplémentation en oxygène.
A la phase précoce des AVC, il existe fréquemment des troubles hydro-électrolytiques, le
plus souvent une déshydratation, notamment chez les sujets âgés, par défaut d'apport
et/ou perte d'eau et d'électrolytes. Cette déshydratation peut aggraver le processus
ischémique (élévation de la viscosité sanguine et réduction de la pression artérielle) (6).
Le maniement du sérum glucosé est délicat car, l'hypoglycémie, de même que
l'hyperglycémie, peuvent aggraver la souffrance cérébrale et augmenter la Pression
IntraCrânienne (PIC) (1). Aussi est-il conseillé de maintenir la glycémie entre 1,40 et 1,80
g/l (1).
Evaluation et surveillance de l'état hémodynamique et tensionel :
Tout patient susceptible de constituer un AVC doit bénéficier immédiatement d'une
surveillance de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et de l'état
hémodynamique (5,6).
Un collapsus circulatoire est inhabituel en cas d'AVC isolé. De même, l'hypotension
artérielle est peu commune, en préhospitalier. Si elle existe-elle doit être traitée
d'urgence, sous couvert d'une surveillance clinique et biologique rigoureuse (1). La
correction d'une hypovolémie ou la restauration d'une fonction cardiaque normale sont
des mesures prioritaires.
L'hypertension est fréquente (environ 70%, (1)) à la phase initiale des AVC. Les
traitements anti-hypertenseurs influencent toujours le débit sanguin cérébral. Ils peuvent
le plus souvent être différés, notamment en cas d'ischémie (1). Ainsi, chez la plupart des
3 sur 12

patients, la pression artérielle ne doit pas être abaissée sauf si la pression sangu
ine
moyenne dépasse 130 mm de Hg ou si la pression systolique dépasse 220 mm de Hg.
En effet, l'autorégulation de la circulation cérébrale au niveau et autour (pénombre
ischémique) de la zone d'ischémie est altérée et le flux sanguin régional varie
passivement avec les changements de la pression de perfusion. Il en résulte, en cas de
baisse intempestive de la tension artérielle, un risque d'extension de la lésion cérébrale.
Dans la plupart des cas, la pression artérielle se normalise en 1 à 2 semaines. Enfin,
l'abaissement de la pression sanguine au sein de la zone infarcie est délétère, tout
particulièrement chez les patients présentant des chiffres tensionnels élevés de façon
chronique, chez qui l'autorégulation du débit sanguin cérébral est totalement modifiée.
En urgence, le choix de l'anti-hypertenseur est important (cf tableau n°1). Les agents
anti-adrénergique comme la clonidine ou les alpha ou bêta-bloquants de courte durée
d'action comme le labétalol ou l'urapidil, sont préférables. Par contre, il faut éviter le
nitroprussiate de sodium, la dihydralazine et les inhibiteurs calciques dont l'effet
vasodilatateur cérébral tend à augmenter la PIC. De même, on évitera les inhibiteurs de
l'enzyme de conversion (1).
Pression systolique < 220
Pression diastolique < 120 Pas de traitement
Pression diastolique > 120,
Pression systolique légèrement augmentée lors de
mesures répétées à 15 mn d'intervalle Nitroprussiate de Sodium 10 mg PO
Pression systolique > 220 ou
diastolique de 110-120 ou
les 2 à des mesures répétées
Nifedipine 10 mg SL
Clonidine 0,075 mg SL
Urapidil 12,5 mg IV
Tableau n° 1 : Traitement anti-hypertenseur à la phase aiguë de l'ischémie cérébrale (1).
Pression mesurée en mm Hg. IV : intraveineux; PO : per os; SL : sublinguale.
Dépister et lutter contre l'Hypertension Intra-Cranienne (HIC) (1) :
Des signes d'HIC surviennent, habituellement, chez des patients présentant un AVC
ischémique ou hémorragique hémisphérique étendu. En général, en cas d'infarctus
cérébral, l'œdème cytotoxique est retardé, survenant dans un délai de 24 à 96 heures.
Toutefois, des signes d'HTIC peuvent être présents à la phase précoce. Ils justifient, dès
leur authentification, la mise en œuvre de mesures spécifiques.
Les patients doivent avoir la tête positionnée avec une pro-clivité de 30° et ne doivent
pas être placés en décubitus latéral pendant les premières 24 heures. Le niveau de
sédation doit être ajusté, si nécessaire, pour lutter contre la douleur et l'anxiété.
La prise en charge inclue aussi une hyperventilation modérée, afin de maintenir la
PaCO2 autour de 35 mm de Hg (elle ne concerne que les patients sous assistance
respiratoire). Malheureusement ses effets sont limités entre 12 et 36 heures au
maximum. Les hautes pressions positives expiratoires doivent être évitées puisqu'elles
élèvent la PIC.
La perfusion intraveineuse de substances hyperosmotiques créée un gradient osmotique
via la barrière hémato-encéphalique. Pour éviter un rebond à l'arrêt de la perfusion, il est
nécessaire que cette barrière soit intacte. Différentes substances peuvent être
administrées telles que le glycérol per os à 10% (1,5g/kg) ou le Mannitol intraveineux à
20% (4 fois 100 ml par jour) dans les cas plus sévères, pendant au maximum 48 heures
4 sur 12

ou, en situation d'urgence
(1)
. Attention, la perfusion de solutés hypo-osmolaires tend à
augmenter l'œdème cérébral et l'HIC (6).
En présence d'une HIC rebelle l'utilisation intraveineuse de barbituriques, voir de
thiopental, peut être justifiée, sous couvert d'une ventilation assistée.
Enfin, une décompression chirurgicale peut-être envisagée en cas d'AVC hémisphérique
expansif ou d'AVC cérébelleux. L'heure de la chirurgie doit être déterminée précisément
par une surveillance clinique et scannographique rigoureuse.
Apprécier le terrain et les facteurs de risque vasculaire :
L'interrogatoire du patient ou de l'entourage doit permettre de connaître les antécédents
médico-chirurgicaux du patient, notamment cardio-vasculaires et neurologiques, les
facteurs de co-morbidité ainsi que les Facteurs de Risque Vasculaire (FRV).
Globalement, les FRV se confondent avec ceux de l'athérome.
Trois types peuvent être distingués : non modifiables (âge, sexe, race, climat...),
facteurs classiques (HTA, tabac, diabète, dyslipidémie...). Leur risque relatif est évalué
séparément entre 1,2 et 2, sauf pour l'HTA (> 4). Pour le tabac le risque attribuable est
très élevé compte tenu de la fréquence de ce facteur dans la population. Autres facteurs
cliniques (AIT, migraine, diffusion de la maladie athéromateuse), biologiques (dont les
troubles de l'hémostase acquis et congénitaux) et morphologiques ultra-sonographiques
(épaisseur de l'intima, HITS) et radiologiques (infarctus anciens, leucoaraïose).
N.B. :
HITS = High Intensity Transient Signal, perceptibles en doppler trans-crânien, témoignant
du passage d'embolies, le plus souvent "silencieuses".
Leucoaraïose : raréfaction de la substance blanche, principalement dans les régions
centrales des hémisphères se révélant sous forme d'une hypodensité diffuse, hétérogène,
mal limitée au scanner.
ÉVALUATION NEUROLOGIQUE :
Aujourd'hui, il apparaît nécessaire de reconnaître l'AVC, d'en préciser la nature
(ischémique, hémorragique) et la cause, afin d'envisager une prise en charge
thérapeutique cohérente.
La suspicion diagnostique de l'AVC est faite le plus souvent par le patient ou son
entourage. Cependant l'information du public est souvent limitée. Il ignore que
l'altération de la vigilance, de la parole ou du langage, des fonctions motrices ou
sensitives et de la coordination indiquent souvent un AVC. Des campagnes de
sensibilisation, notamment par voie audiovisuelle, seraient souhaitables.
Evaluation des délais de prise en charge :
L'appréciation du délai écoulé entre le début des symptômes et le moment de la prise en
charge médicale pré puis hospitalière est importante à considérer. Cela est rendu
indispensable par les essais thérapeutiques pratiqués à la phase précoce des AVCI
(neuroprotection, fibrinolyse). En cas d'administration de traitement fibrinolytique les
délais d'inclusion tendent à être ramenés à 3 heures, afin d'améliorer les résultats
cliniques et de réduire les risques de transformations hémorragiques. Tout retard
compromet donc la réponse thérapeutique.
Reconnaître l'AVC et son profil évolutif (4) :
La présentation clinique varie considérablement en fonction du siège et de la taille de la
lésion, allant de symptômes très fugaces, parfois négligés par le patient, au coma
hémiplégique mortel en quelques heures.
La principale caractéristique des AVC est la brutalité du mode de constitution du déficit
(quelques secondes ou minutes, le plus souvent). Le territoire en cause, carotidien, avant
tout sylvien, ou vertébro-basialire, modifie l'expression clinique : hémiplégie ou
hémiparésie, hémianesthésie, hémiparesthésie, aphasie, pour le premier, ataxie,
5 sur 12
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%