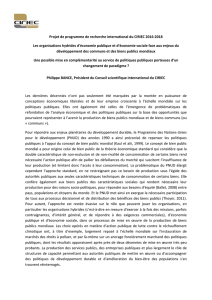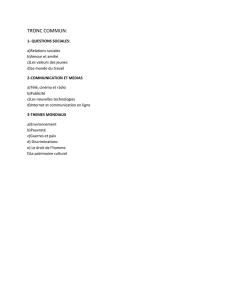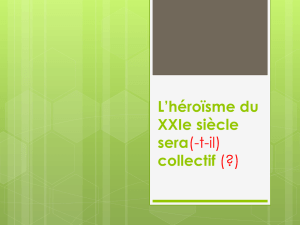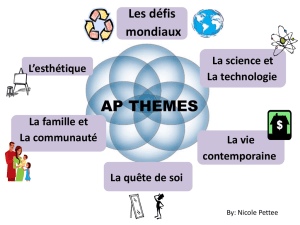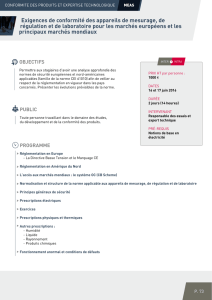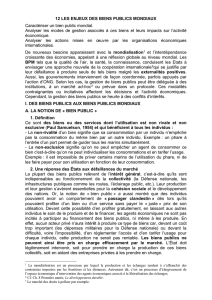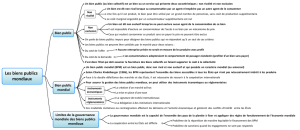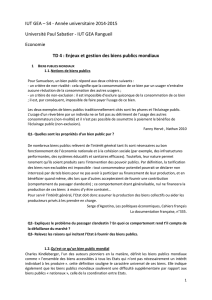2015 06 | Etopia | Biens publics mondiaux et biens communs

ANALYSES
ETOPIA
JUIN
2015
ETOPIA
CENTRE D'ANIMATION
ET DE RECHERCHE
EN ÉCOLOGIE POLITIQUE
ÉCONOMIE (SCIENCE) ÉCONOMIE SOLIDAIRE BIENS COMMUNS ANALYSE
BIENS PUBLICSBIENS PUBLICS
BIENS PUBLICS
MONDIAUX ETMONDIAUX ET
MONDIAUX ET
BIENS COMMUNSBIENS COMMUNS
BIENS COMMUNS
MONDIAUXMONDIAUX
MONDIAUX
SAMUEL COGOLATISAMUEL COGOLATI
SAMUEL COGOLATI

Samuel Cogolati
Chercheur associé Etopia et doctorant au Leuven
Centre for Global Governance Studies, Institute
for International Law (KU Leuven)
BIENS PUBLICS MONDIAUX ET BIENS COMMUNS
MONDIAUX
Attention aux faux amis !
Là où les biens communs mondiaux sont sur les lèvres de tous
les acteurs de la transition écologique et de l’économie du
partage, les biens publics mondiaux représentent de plus en
plus aux yeux des altermondialistes un « nouveau gadget du
néolibéralisme ». Cette analyse explique pourquoi ces deux
notions – à première vue si semblables – s’affrontent.
INTRODUCTION

En 1999, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) publiait
un ouvrage majeur sur les « biens publics mondiaux » (
global public goods
) censé
révolutionner notre manière de concevoir la coopération internationale et l’aide
au développement dans le contexte de la mondialisation. Mais depuis quelques
années, les voix s’élèvent contre ce nouveau concept. Certains l’opposent
aujourd’hui au phénomène des « biens communs mondiaux » (
global
commons
). [1] Cette analyse tente de faire la lumière sur la distinction politique et
idéologique entre deux notions du vocable politique international certes encore
très floues et multiformes, mais néanmoins concurrentes.
Le concept de bien public mondial trouve son origine dans une série de trois livres
publiés en 1999, [2] 2003, [3] et 2006, [4] par le PNUD. Leurs auteurs, Inge Kaul et
ses collègues, empruntent le terme de bien public mondial au vocabulaire
économique néoclassique. Il n’est donc pas tout à fait nouveau. En effet, selon
les critères stricts de la théorie économique, les biens publics évoluent sur deux
continuums : la non-rivalité et la non-exclusion. Seuls ces biens qui présentent la
double caractéristique de non-rivalité (son usage n’entraîne aucune diminution de
la quantité disponible pour les autres usagers)
et de non-exclusion (il est
impossible d’exclure quiconque de son usage) sont purement publics. Le meilleur
exemple est le phare d’un port de pêcheurs. L’usage par un navire de la lumière du
phare n’empêchera jamais un autre navire de l’utiliser également comme guide
(non-rivalité) ; et il est extrêmement difficile d’empêcher certains navires de
profiter de la lumière du phare, même pas ceux qui n’ont pas contribué à la
construction du phare, par exemple en refusant de payer des taxes (non-
exclusion). Il en va de même pour la sécurité, la paix, la santé publique.
Là où ça coince avec les biens publics, c’est qu’aucun individu n’a intérêt à en
supporter le coût puisqu’il est impossible de lui en faire payer l’usage en l’excluant
(non-exclusion). Ainsi, chaque agent privé a tendance à plutôt se conduire tel un
« passager clandestin » (
free rider
), c’est-à-dire à profiter des efforts des autres
pour bénéficier du bien public sans en supporter le coût. Résultat des courses :
ces biens publics ne peuvent être délaissés au marché, puisqu’ils seront
inévitablement produits en quantité nettement insuffisante. Le bien public est
l’exemple type d’une défaillance du marché. Voilà pourquoi les économistes, tels
Paul Samuelson, [5] considèrent l’état comme le fournisseur idéal de ces biens
publics au niveau national puisqu’il est le seul à détenir le monopole de la
violence légitime pour obliger ses citoyens à en payer le coût.
L’observation que fait maintenant le PNUD est qu’au niveau mondial, il n’existe
pas de gouvernement capable de fournir ces biens publics mondiaux qui
dépassent les frontières des états-nations. Or, la mondialisation a multiplié ces
enjeux planétaires – comme les maladies contagieuses, les trous dans la couche
d’ozone, le réchauffement climatique – pour lesquels le cadre étatique ne suffit
plus, et la coopération de toute la communauté internationale est exigée. Selon
Inge Kaul et ses collègues du PNUD, la mondialisation requiert ainsi de penser la
fourniture des biens publics sur une étendue beaucoup plus vaste dans l’espace –
à travers tous les pays – et le temps – à travers toutes les générations. En effet,
dans un ordre juridique international qui repose sur la souveraineté de chaque
état-nation, la production des biens publics mondiaux – c’est-à-dire toute avancée
dans le traitement du SIDA, toute réduction de la pollution par le soufre et les
oxydes d’azote, toute lutte contre le changement climatique – dépend de l’action
collective de toute la communauté internationale.
En théorie économique, les biens publics sont à différencier des biens privés qui
sont rivaux et excluables (par exemple, une part de gâteau) ; des biens de club qui
restent non-rivaux mais dont on peut toutefois exclure certains utilisateurs (par
exemple, une autoroute à péage) ; et des biens communs qui restent en principe
accessibles à tous, mais dont l’usage est rival (par exemple : les ressources
naturelles). Le risque est qu’en exploitant ces biens communs, les usagers
l’épuisent complètement. Ainsi, il est difficile d’empêcher les pêcheurs d’avoir
accès aux stocks de cabillaud en mer du Nord (non-exclusion) ; en revanche, sa
INTRODUCTION
LES BIENS PUBLICS MONDIAUX
BIENS COMMUNS MONDIAUX

surpêche entraînera la disparition de l’espèce (rivalité).
Rivalité Biens privés Biens communs
Non-rivalité Biens de club Biens publics
C’est sur base de cette caractéristique de rivalité que le socio-biologiste Garrett
Hardin évoquait «
The Tragedy of the Commons
» (« La Tragédie des Communs »)
dans un article majeur de 1968. [6] Pour lui, laisser des ressources limitées telles
un pâturage en libre accès mène inévitablement à leur ruine. Il en va de même
pour la déforestation, la perte de la biodiversité animale ou végétale, ou
l’affaiblissement des ressources naturelles en eau. Seules la privatisation ou la
nationalisation par l’état peuvent à son sens éviter la disparition des biens
communs mondiaux. La métaphore de Hardin et son modèle binaire de
privatisation ou de recours à la puissance publique ont longtemps dominé toute
idée de gestion des biens communs mondiaux.
Cependant, une troisième voie pour résoudre ce dilemme de surexploitation des
biens communs fut avancée par la politologue américaine Elinor Ostrom dans un
livre emblématique de 1990 – qui lui valut d’ailleurs le Prix Nobel d’Economie en
2009. Au-delà de la marchandisation et de la régulation par l’état, Ostrom propose
un modèle de gestion collaborative capable de protéger durablement l’usage des
biens communs pour en éviter leur extinction. [7] Dans son livre, Ostrom analyse
une série d’arrangements institutionnels dans lesquels les citoyens se
réapproprient le bien commun en devenant codécideurs de leur mode
d’exploitation et de gestion.
Venons-en alors à la question principale qui nous occupe ici : devrions-nous
opposer, ou à tout le moins différencier, les notions de biens publics et de biens
communs ? On pourrait évidemment simplement opposer les deux définitions
économiques traditionnelles exposées ci-dessus qui renvoient aux
caractéristiques d’usage non-exclusif et non-rival. Il est toujours bon de
rappeler que les deux notions s’attellent à des dilemmes économiques et
sociologiques bien différents, mais il existe aussi en réalité une distinction plus
idéologique, plus politique, entre les deux courants de pensée.
D’une part, l’approche collaborative des biens communs mondiaux est aujourd’hui
promue par les acteurs de la transition écologique, souvent à un niveau très local,
comme un nouveau paradigme pour réinventer la prospérité. Elle s’étend à
présent bien au-delà des seules ressources naturelles pour couvrir des nouvelles
communautés de partage comme les logiciels libres, Wikipédia, les monnaies
alternatives ou l’échange de semences. [8] D’autre part, le concept de bien public
mondial s’est imposé durant la dernière décennie comme le nouveau discours
politique d’une série d’organisations internationales comme la Banque mondiale
et l’OCDE. ATTAC compare aujourd’hui cette propagande à un « rouleau
compresseur idéologique » et aux « béquilles du capital ». [9]
Mais que peuvent bien reprocher les altermondialistes aux biens publics
mondiaux ? Les écrits du PNUD sont pourtant loin d’émaner de milieux
exclusivement « néo-libéraux ». La première édition du PNUD compte d’ailleurs
Amartya Sen [10] et Joseph E. Stiglitz [11] parmi ses coauteurs, deux prix Nobel
d’économie biens connus pour leurs critiques des théories néoclassiques. Après
tout, le point de départ de la démarche du PNUD est justement l’urgence de
répondre aux crises économiques, sociales et environnementales engendrées par
la mondialisation. L’effort du PNUD est louable à cet égard. Alors, pourquoi biens
publics mondiaux et biens communs mondiaux devraient-ils s’affronter ?
D’abord, la rhétorique des organisations internationales sur les biens publics
mondiaux ne se borne pas à une qualification objective, réelle, et figée d’un bien
donné, mais se traduit surtout en prescriptions politiques. En effet, le caractère
public d’un bien est avant tout un construit social qui dépend de visions politiques
potentiellement très différentes. Par exemple, quand la Banque mondiale décide
EXCLUSION NON-EXCLUSION
BIENS PUBLICS MONDIAUX, BIENS COMMUNS MONDIAUX : DEUX NOTIONS
VOISINES OU CONCURRENTES ?

de labelliser le libre-échange comme un bien public mondial dans son discours de
développement économique, [12] il va de soi qu’il s’agit là avant tout d’une priorité
politique propre à l’institution en question, et non d’une qualification scientifique
basée sur les seuls critères de non-rivalité et de non-exclusion (d’ailleurs, il est
aisé d’imaginer une zone de libre-échange telle le NAFTA qui exclut certains états
de son club). Le risque est donc que le nouveau discours des biens publics
mondiaux vienne légitimer tout type de coopération intergouvernementale ou
action des organisations internationales, en particulier du système onusien, sous
couvert de critères pseudo-scientifiques et apolitiques.
Ensuite, le discours du PNUD se borne à constater que la production des biens
publics mondiaux par les organisations internationales et la coopération
intergouvernementale est une nécessité au vu des choix économiques rationnels
des états qui agiront toujours de manière individualiste et utilitariste comme dans
le dilemme du prisonnier. Les livres du PNUD n’avancent pas de modèle de
production et/ou de gestion alternatif à la marchandisation et à la puissance
publique du modèle capitaliste dominant. Finalement, le prisme des biens publics
mondiaux nous impose une vision très étriquée de la vie en commun : soit
l’individu, soit l’État, et, au niveau mondial, une gouvernance globale encore mal
définie.
Au contraire, l’approche des biens communs propose un nouveau système social
de coproduction et de cogouvernance qui rejette la dichotomie
propriétarisation/régulation publique de la théorie économique conventionnelle.
Elle se détache radicalement de la culture de marchandisation et prône la non-
appropriation des richesses partagées comme l’eau, les terres agricoles, les
connaissances et les cultures. Plus fondamentalement encore, les adeptes des
biens communs nous invitent à dépasser la grille de lecture économique
traditionnelle des biens exposée ci-dessus pour redéfinir la prospérité sur base de
critères alternatifs sociaux, écologiques, et mêmes philosophiques.
La dichotomie biens privés/biens publics a longtemps dominé l’économie de
marché. Les différences entre biens communs et biens publics, elles, sont bien
plus difficiles à cerner. Or, les « biens communs mondiaux » (
global commons
) et
les « biens publics mondiaux » (
global public goods
) sont bel et bien devenus
des concepts fort mobilisateurs du vocable politique international. Il devient dès
lors capital de distinguer les logiques politiques sous-jacentes aux deux notions.
Distinguer les biens communs mondiaux de la notion faussement voisine des
biens publics mondiaux, c’est en effet insister sur le potentiel d’un nouveau
paradigme de réappropriation collective pour repenser notre rapport aux autres et
à la planète.
[1] Voy. par exemple, J. Ballet, « Propriété, biens publics mondiaux, bien(s) commun(s) : Une lecture des
concepts économiques »,
Développement durable et territoires
, nr. 10, mars 2008, para. 67 ; F. Lille et J.
Cossart, « Les biens publics mondiaux », ATTAC, Juin 2008 ; J. Quilligan, « Why distinguish common goods
from public goods », in D. Bollier et S. Helfrich (eds.),
The Wealth of the Commons : A World Beyond
Market & State
, The Commons Strategy Group, http://wealthofthecommons.org/.
[2] I. Kaul, I. Grunberg et M. A. Stern (eds.),
Global Public Goods : International Cooperation in the 21st
Century
, New York/Oxford, Oxford University Press, 1999, 546 p.
[3] I. Kaul, P. Conceição, K. Le Goulven et R. U. Mendoza (eds.),
Providing Global Public Goods : Managing
Globalization
, New York/Oxford, Oxford University Press, 2003, 672 p.
[4] I. Kaul et P. Conceição (eds.),
The New Public Finance : Responding to Global Challenges
, New
York/Oxford, Oxford University Press, 2006, 664 p.
[5] Voy. l’article fondateur de la théorie des biens publics : P. Samuelson, « The Pure Theory of Public
Expenditure »,
The Review of Economics and Statistics
, vol. 36, nr. 4, Novembre 1954, pp. 387-389.
[6] G. Hardin, « The Tragedy of the Commons »,
Science
, vol. 162, nr. 3859, Décembre 1968, pp. 1243-
1248.
[7] E. Ostrom,
Governing the Commons : The Evolution of Institutions for Collective Action
, Cambridge,
Cambridge University Press, 1990, 298 p.
[8] Voy. par exemple : D. Bollier et al.,
Biens communs : comment (co)gérer ce qui est à tous
, Octobre
2012, 53 p. ; E. Verhaegen, « Vive la Transition ?! La révolution des ‘communs’ »,
Politique
, nr. 90, Mai-Juin
2015, pp. 41-45.
[9] Voy. par exemple le document de travail du Conseil scientifique d’Attac : F. Lille et J. Cossart, « Les
biens publics mondiaux », ATTAC, Juin 2008, pp. 2-3.
[10] A. Sen, « Global Justice : Beyond International Equity » in I. Kaul, I. Grunberg et M. A. Stern (eds.),
EN GUISE DE CONCLUSION
 6
6
1
/
6
100%