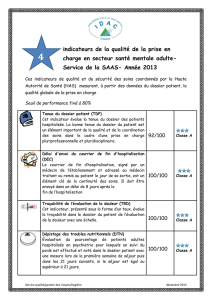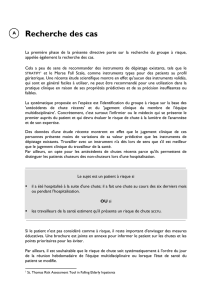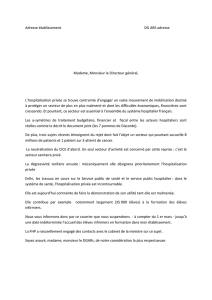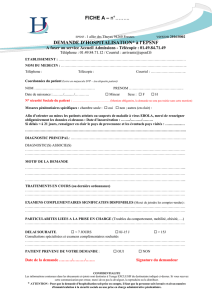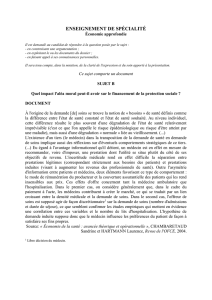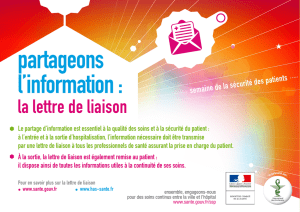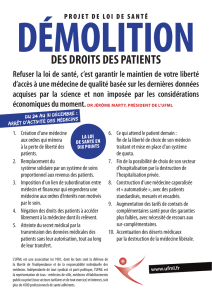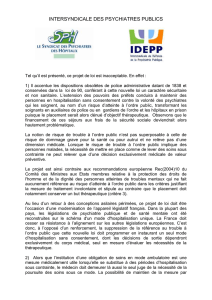L`enfant et l`hôpital, un espace temps à l`épreuve de l`humanisation

L'enfant et l'hôpital, un espace temps à l'épreuve de l'humanisation
Extrait du Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique
http://www.systemique.be/spip/article.php3?id_article=151
L'enfant et l'hôpital, un espace
temps à l'épreuve de
l'humanisation
- SAVOIR THÉORIQUE - Échanges à partir d'articles , bibliothèque, dictionnaire et concepts de la systémique - Article donné par son auteur
pour stimuler des échanges -
Date de mise en ligne : mercredi 24 mai 2006
Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique
Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 1/27

L'enfant et l'hôpital, un espace temps à l'épreuve de l'humanisation
Sommaire
• L'enfant et l'hôpital, un espace-temps à (...)
• Argument : hospice, hôtel, hospital, hôpital
• L'hôpital pédiatrique : lieu de protection, de (...)
• Les équipes soignantes et les enfants hospitalisés
• L'intégration des familles des enfants (...)
• Adaptation du contexte aux spécificités des (...)
• Les alternatives à l'hospitalisation
• Les partenaires de l'hospitalisation
• L'hôpital, un espace protecteur, transitionnel (...)
• Conclusion : l'hôpital, une « plaque tournante (...)
L'enfant et l'hôpital, un espace-temps à l'épreuve de
l'humanisation
Yves-Hiram Haesevoets*
Argument : hospice, hôtel, hospital, hôpital,...
évolution d'un concept
Comme espace-temps institutionnalisé, l'hôpital n'a pas toujours été un lieu d'hospitalité, d'accueil, de protection, de
soins ou de convivialité. A l'image de la société dans lequel il est bâtit, l'hôpital connaît de nombreuses épreuves,
traversant des périodes d'obscurantisme et de lumière.
Révélatrices des temps obscurs et des crises sociales, la mise à l'écart des malades, répond à des croyances où la
misère, l'angoisse, la violence, l'incertitude, l'ignorance et la souffrance dominent le monde. Depuis sa création au
bas Moyen Age, l'institution hospitalière a évolué et s'est adaptée aux contingences relatives aux nombreux
changements sociétaux et culturels. Selon les époques, son concept a recouvert différentes significations.
L'étymologie d'un mot lui restitue une signification fondamentale et montre à quel point le concept contient
intrinsèquement son véritable sens.
Ainsi, « hôpital » (XIIème siècle, ospital) est un terme emprunté au latin tardif hospitalis (domus) qui désigne un «
lieu de refuge, d'accueil », en concurrence avec l'ancien français de ostel (hôtel), pour désigner un lieu d'accueil,
généralement dépendant d'un monastère, où l'on soigne et reçoit malades, pauvres, vieillards.
Le terme Hôpital n'a été distingué de hospice qu'à partir du XVIIIème siècle. Hospitalier (XIIème siècle), emprunté
au latin médiéval hospitalarius, dérivé du latin tardif hospitale, de hospitalis , « de l'hôte », désigne d'abord en
français un religieux de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, spécialisé dans les soins aux malades. Hospitalité
(XIIIème siècle), emprunté au latin hospitalitas « hospitalité », d'où proviennent hospitaliser, hospitalisation ,
formations savantes du XIXème siècle.
Au service d'une théocratie absolue et obscurantiste, l'institution hospitalière se retrouve entre les mains d'une Eglise
Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 2/27

L'enfant et l'hôpital, un espace temps à l'épreuve de l'humanisation
omnipotente qui tente de gérer un mal pour un bien.
Médecine et Eglise ne font pas bon ménage. Sur fond d'incompréhension, de superstition et de peur, la maladie
relève du mystère, son traitement de la sorcellerie. Un climat de méfiance et de diabolisation entoure les malades. La
médecine relève pourtant des défis depuis l'Antiquité mais les inquisiteurs et les intégristes médiévaux y perçoivent
une concurrence qu'ils qualifient d'hérésie ou de blasphème.
Entre le Moyen Age et l'époque contemporaine, l'évolution du monde hospitalier va connaître diverses péripéties et
de nombreux bouleversements. A partir du moment où l'influence de la foi religieuse, des superstitions et des
fausses croyances décroît progressivement, le champ de la médecine hospitalière connaît un essor de plus en plus
affirmé. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les connaissances médicales, la pédiatrie et les traitements
pédiatriques en particulier, ont fait des progrès considérables. Les maladies infectieuses et les négligences graves,
responsables d'une large partie de la mortalité infantile, y compris intra-hospitalière, sont mieux reconnues et traitées
de manière efficace.
L'apparition des antibiotiques, la prophylaxie obligatoire les campagnes de vaccination, le dépistage des maladies
métaboliques et endocriniennes, la recherche des maladies héréditaires,... diminuent fortement le taux de mortalité
infantile.
Les mesures sociosanitaires visant à l'amélioration des conditions de vie ont aussi contribué à réduire la survenue et
la gravité des maladies infantiles.
Les progrès de la réanimation vont permettre de sauver de nombreux nourrissons en détresse respiratoire. La
chirurgie pédiatrique, soutenue par la recherche en anesthésie et en chimiothérapie, va connaître un élan
considérable. Les personnels soignants, y compris les médecins, sont de mieux en mieux formés dans le champ de
la pédiatrie.
La pédiatrisation de la médecine devient une spécialité à part entière. Au XXème siècle, la pédiatrie moderne est
constituée de spécialités pédiatriques dans tous les domaines de la médecine. Les hôpitaux pédiatriques et les
unités de pédiatrie, en particulier universitaires, développent des services hautement spécialisés.
Autour du foetus, du nouveau-né, du nourrisson et de l'enfant, la pluridisciplinarité des services pédiatriques est
désormais incontournable. Il n'est pas rare de voir se pencher sur un même cas, l'obstétricien, le généticien, le
kinésithérapeute, le psychologue, le chirurgien, l'échographiste, etc. Chemin faisant, les découvertes biomédicales et
les progrès techniques révolutionnent la médecine de l'enfant,les connaissances sur le développement
psychomoteur du nourrisson et la psychologie de l'enfant, ses besoins affectifs, ouvrent notamment le champ sur la
problématique des séparations précoces avec le milieu familial, sur la psychopathologie des transactions
intra-familiales, les troubles du lien et de l'attachement, etc.
Les travaux d'Anna Freud et Dorothy Burlingham (1944), de Donald Winnicott (1950) , de John Bowlby (1951) de
Mélanie Klein (1955), de René Spitz (1945 & 1965), Françoise Dolto (1965 & 1986), ... auront une portée
internationale tant dans le domaine de la psychanalyse de l'enfant, que dans l'approche thérapeutique (systémique)
des relations parent/enfants.
Enfin, avec les travaux du pédiatre américain T.B. Brazelton (1962 & 1973), la prise de conscience des compétences
du nourrisson et de l'importance des interactions entre le nouveau-né et ses partenaires connaît un rayonnement
international et des implications pour l'ensemble des professionnels de la petite enfance. Le regard porté sur
l'évolution du nourrisson et du jeune enfant amènent de nombreux psychologues et pédopsychiatres à s'impliquer
Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 3/27

L'enfant et l'hôpital, un espace temps à l'épreuve de l'humanisation
dans une approche systématique de l'enfant en tant que « partenaire » relationnel. Dans un esprit pluridisciplinaire,
l'observation du nouveau-né, l'intérêt pour le développement psychoaffectif du jeune enfant et la compréhension des
transactions intra-familiales font désormais partie du travail des équipes soignantes à l'hôpital et des consultations
infanto-juvéniles. De nombreux travaux scientifiques concernent cette évolution (J-Y. Hayez, 1991).
De sa création à son institutionnalisation progressive, en passant par la question de son humanisation actuelle,
l'hôpital s'est confronté à une remise en question permanente, en particulier lorsqu'il s'agit de réfléchir à
l'hospitalisation de l'enfant et à ses conséquences.
L'enfant hospitalisé évoque toute une série de réflexions à propos des conditions de vie à l'hôpital, de ses droits
fondamentaux, de la réalité quotidienne de son vécu en tant que jeune patient, des relations patient/soignants,... et
soulève de nombreux problèmes d'ordre éthique et déontologique.
L'hôpital pédiatrique : lieu de protection, de soins, de
crise et de passage ?
Qu'il soit malade, handicapé, accidenté ou victime de maltraitance, l'enfant qui est hospitalisé exprime des besoins
spécifiques auxquels les intervenants tendent de répondre.
A ce niveau, tous les hôpitaux ne sont pas suffisamment équipés en personnel spécialisé que pour offrir un service
et un accueil adaptés aux enfants hospitalisés. Plusieurs enquêtes démontrent que même si de nombreux efforts
sont consentis dans ce domaine, les droits fondamentaux des enfants hospitalisés ne sont pas toujours pris en
considération par certains établissements hospitaliers.
Selon les circonstances et le degré d'urgence, que l'hospitalisation soit librement choisie par les parents, consentie
après coup, décidée ou imposée par une instance, l'enfant a besoin d'être rassuré et doit si possible garder des
contacts avec les personnes de son entourage. Dans la plupart des situations, l'hospitalisation est discutée et
décidée avec l'accord des parents, dont l'implication et la coopération sont fondamentales à la recherche de
solutions adaptées, au traitement et à la prise en charge de l'enfant.
Dans quelques cas, l'angoisse, l'irrationalité et la réticence des parents exigent une négociation et des explications
plus didactiques,... les parents ont par exemple besoin d'entendre qu'un bilan médical complet est nécessaire et que
l'hospitalisation rend plus efficace ce type d'intervention,... ou que la situation psychosociale de la famille exige la
mise à l'écart de l'enfant.
Le service de pédiatrie d'un hôpital général nous paraît être un lieu d'accueil privilégié, en cas de problème médical à
investiguer, d'un accident (domestique ou de la route) ou d'une suspicion de sévices. Lieu de sécurité et de soins,
l'hôpital permet ainsi de traiter l'enfant, d'autant si son état paraît avoir des conséquences somatiques ou
psychologiques sévères.
Plusieurs services spécialisés sont implantés au coeur d'un hôpital général. Il découle de cette intégration une
capacité particulière de diagnostiquer et de traiter les situations de manière rapide et intensive, de coordonner
étroitement les soins physiques et psychologiques et de traiter d'éventuelles situations de crise nécessitant de
multiples niveaux d'investigation et d'intervention. L'unité de temps et de lieu de l'intervention, la sécurisation de
l'enfant hospitalisé, la multiplicité des ressources et compétences offertes par l'hôpital sont des atouts considérables.
Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 4/27

L'enfant et l'hôpital, un espace temps à l'épreuve de l'humanisation
Etant donné la vulnérabilité particulière de l'enfant, son hospitalisation implique le respect de ses droits personnels.
Au regard de la législation et des conventions reconnaissant les droits de l'enfant hospitalisé, l'éthique et l'équité
dans les relations humaines, ainsi que la déontologie professionnelle doivent prévaloir, en termes de liberté de
parole, de confidentialité, de responsabilité parentale conjointe, de consentement éclairé du patient, de qualité dans
les soins,...
La prise en considération de la parole de l'enfant et son droit à l'information restituent au jeune patient sa position de
sujet. L'autonomie et le consentement prennent à l'hôpital une importance particulière. L'enfant doit être associé
pleinement, dès qu'il en est capable, aux informations et/ou aux décisions qui touchent sa personne, son devenir, sa
dignité. L'autonomie personnelle est à la fois une obligation déontologique mais aussi le moyen de faire adhérer le
mineur aux soins.
La confidentialité dans les soins repose sur des dispositions légales récentes qui viennent renforcer le devoir de
confidentialité. Cette innovation législative renvoie au discernement des médecins dans toute une série de
circonstances délicates. La loi prévoit, lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé
d'une personne mineure, que le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du titulaire de l'autorité
parentale sur les décisions médicales à prendre. Si le mineur s'oppose à la consultation du titulaire de l'autorité
parentale pour garder le secret sur son état de santé, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention
et le mineur doit alors se faire accompagner d'une personne majeure de son choix.
L'autorité parentale est instituée dans l'intérêt exclusif de l'enfant, elle vise avant tout à sa protection. Cette autorité
évolue et accompagne le développement (capacité de décision et de discernement) de l'enfant jusqu'à sa majorité.
Les évolutions légales récentes visent à ce qu'en toutes circonstances « le couple parental survive au couple
conjugal », notamment dans les situations de séparation parentale. Les décisions de soins font donc partie des
responsabilités essentielles que les parents doivent exercer dans la durée et de manière conjointe.
L'hôpital doit s'assurer que l'exercice de l'autorité parentale soit respectée dans les décisions médicales. Le mineur
isolé et non accompagné a également droit aux soins de toute nature. Aujourd'hui, les services d'urgence accueillent
de plus en plus d'enfants en rupture familiale et d'enfants migrants isolés qui arrivent seuls.
Bénéficient-ils d'une protection particulière, dès lors que leur statut est précaire ? Peut-on les soigner sans
consentement ? Peut-on les laisser repartir sans instaurer un follow-up ?
De nombreuses questions d'éthiques confrontent les personnels soignants à des réalités de plus en plus débattues
dans nos sociétés occidentales : le traitement de la douleur chez le nouveau-né ou le jeune enfant, le droit à
l'euthanasie des mineurs atteints d'une maladie incurable en stade terminal, lorsqu'un enfant confronté à une
maladie incurable réclame des soins palliatifs, etc.
Non seulement l'accès aux demandes spécifiques des enfants en cours d'hospitalisation continue à poser différents
problèmes, mais la reconnaissance de leur souffrance psychique et physique fait encore l'objet de nombreux débats.
Tels sont posés les jalons d'une réflexion à propos des droits de l'enfant hospitalisé et d'un questionnement sur
l'humanisation de l'hospitalisation des patients, en particulier des enfants. Un regard critique sur les exigences d'une
telle pratique ouvre de meilleures perspectives en termes d'accueil, de qualité de soins, de communication, de
relations humaines et de prise en charge ambulatoire.
L'humanisation de l'hospitalisation des enfants Entre la Charte européenne des droits de l'enfant hospitalisé et la
réalité actuelle, il existe un écart considérable suivant les régions et les équipements dont disposent les hôpitaux. En
Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 5/27
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%