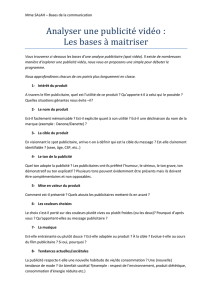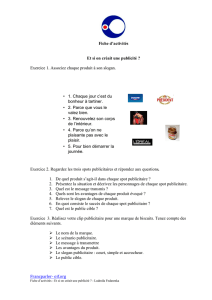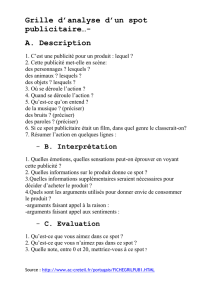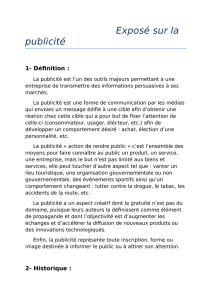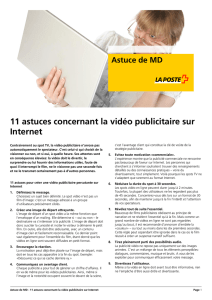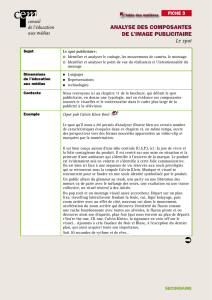Inter-Ateliers Histoire, archives et publicité 24 octobre 2003

Inter-Ateliers
Histoire, archives et publicité
24 octobre 2003
Institut national de l’audiovisuel
4 avenue de l’Europe
94366 Bry-sur-Marne Cedex
Tél. : 01 49 83 30 11
Mél : inatheque-[email protected]
Site : www.ina.fr

Inter-Atelier du 24/10/03 : Histoire, archives et publicité
Institut national de l’audiovisuel - www.ina.fr
2
Interventions de :
Chantal DUCHET, Université Paris III
Heidi WITTING, Université de Ratisbonne, Allemagne
Dominique COLOMB, Université Grenoble III
PRÉSENTS :
BAHUAUD Myriam IUT, Le Havre
COLOMB Dominique Université Grenoble III
DROUET Maxime EHESS
DRUCKER Corinne Université Paris X
DUCHET Chantal Université Paris III
ESNEAU Aurélie Université Paris III
FAUVEAU Benjamin Université Paris I
FAVES Cachoux Université Paris VIII
GODON Johanna Université Paris III
JULIEN Aline Université Paris III
LAMBERT Charlotte Université de Versailles
LEBAUT Geneviève Cinémathèque universitaire
MIGET Sylvestre
MINOT Françoise IUFM Poitou-Charentes
PICARD Camille Université Paris I
PINEAU Guy Université Paris III
POINSAC Josette Université Paris II, IMAC
ROSTIN Charlotte Université Paris III
SAINT-DREUX Anne La maison de la Publicité
SOULAGES Jean-Claude CAD, CUEJ
SOULEZ Guillaume Université de Metz
VASSALLO Aude Université Paris VII
WITTING Heidi Université de Ratisbonne (Allemagne)
Ina Inathèque de France
CHAMMING’S Louis, DRE BARBIER-BOUVET Christine
BERAHOU Foued
FEGAR Sylvie
MARÉCHAL Denis
PLAS Emmanuèle
YARED Geneviève

Inter-Atelier du 24/10/03 : Histoire, archives et publicité
Institut national de l’audiovisuel - www.ina.fr
3
Guillaume SOULEZ : Nous recevons aujourd’hui Chantal Duchet de Paris III, qui va
prochainement soutenir son habilitation qui porte sur la publicité, plus précisément sur « les
images, les applications industrielles, l’histoire de l’appropriation ». Nous recevons
également Heidi Witting de l’université de Ratisbonne en Allemagne, qui a séjourné deux
ans en France et a travaillé sur l’histoire de la publicité française. Elle nous présentera
aujourd’hui l’état de ses travaux. Interviendra aussi, Dominique Colomb du Gresec à
l’université de Grenoble III, qui travaille sur la publicité chinoise depuis de nombreuses
années.
Il va être intéressant de comparer les corpus, la dimension géographique et historique des
ancrages des publicités dans des contextes forts différents. Je laisse la parole à Chantal
Duchet pour qu’elle nous présente brièvement cette séance, puis Heidi Witting interviendra
la première.
Chantal DUCHET : Ce qui m’a semblé intéressant, c’était de voir la publicité en tant que
publicitaire, mais aussi, quelles étaient les façons de l’appréhender dans les différents
milieux. Il était intéressant de présenter les discours via les acteurs, ou au contraire, via la
réception. Quelle part peut-on accorder à l’un ou à l’autre ? Quels sont les problèmes
documentaires qui se posent pour étudier cette publicité ? Car il n’est pas toujours évident
d’avoir accès à la documentation publicitaire à proprement parler, d’autant plus que cette
publicité est considérée comme de la culture quotidienne, éphémère, sans grande valeur….
Les programmes télévisés n’ont déjà pas de réelle reconnaissance, alors la publicité… !
Pourquoi ai-je demandé à Heidi et à Dominique d’intervenir ? Car ils allaient avoir un autre
discours que celui qui est tenu habituellement car nous allons aborder la question par le côté
interculturel : par exemple, lorsqu’on a un corpus aussi éloigné – en l’occurrence un corpus
chinois – il était intéressant de voir comment se posaient les problèmes en recherches
documentaires. Avec Heidi, il s’agit de voir comme elle appréhende une histoire de la
publicité française alors qu’elle est Allemande. Il faut toujours savoir d’où on parle : mon
intervention se fera du côté des acteurs, en tant que publicitaire.
Heidi WITTING : Bonjour à tous. Ma thèse s’intitule – mais c’est un titre provisoire – « Entre
mensonge et manipulation, la créativité, l’évolution narratologique et esthétique du
spot et du film publicitaire français au XX
ème
siècle ». J’ai choisi ce titre parce que j’ai
constaté un paradoxe : d’un côté, on a un mouvement anti-pub – « la pub te manipule »
(slogan inscrit sur les murs de La Sorbonne en 1968) qui est symptomatique de ce
mouvement dès les débuts du spot publicitaire à la télévision française. Ce souci a peut-être
aussi été à l’origine de la création du Bureau de Vérification de Publicité en 1953.

Inter-Atelier du 24/10/03 : Histoire, archives et publicité
Institut national de l’audiovisuel - www.ina.fr
4
Aujourd’hui, on publie des livres tel Le livre noir de la publicité de Florence Amalou qui
critique vivement la publicité. Et en même temps, nous assistons à une certaine « publi-
folie », comme Marie Bertherat l’appelle dans son livre 100 ans de pub. Ces tendances se
font remarquer dès 1957, à l’époque du cinéma, avec la création du festival international du
film publicitaire de Cannes par Jean Mineur. Dans les années 70, le fossé entre publiphobes
et publiphiles se creuse. Aujourd’hui, le taux de jeunes gens qui consomment volontiers et
pendant des heures des spots publicitaires augmente. « La nuit des publivores », qui existe
depuis les années 80, fait salle comble, et cette « nuit » dure le temps d’un week-end… De
plus, l’émission « Culture Pub » compte à elle seule 3 millions de téléspectateurs, ce sont les
chiffres de 2002. Depuis les années 80, il y a une ou plusieurs émissions consacrées à la
publicité française. Les animateurs ou les journalistes discutent sur les spots dans
l’émission, ils font aussi intervenir des consommateurs, par exemple comme sur le site
Internet de la chaîne M6.
Ainsi, aujourd’hui, se posent les questions suivantes : la publicité manipule-t-elle depuis ses
débuts jusqu’à ce jour ? Comment communique-t-elle ? Comment réagit-elle aux reproches
de mensonge et de manipulation ?
Si je parle du spot – qui existe à la télévision depuis 1968 – je parlerai aussi du film
publicitaire, c'est-à-dire du cinéma. Le spot et le film réagissent sur cette perception
changeante d’une société de média, ils restent en contact avec les consommateurs, avec sa
propre histoire et avec d’autres genres artistiques.
A partir des années 80, le spot réfléchit sur son propre code et se distancie des reproches de
mensonge en démontrant le système publicitaire. Si on veut résumer mon projet de thèse en
une phrase, je dirais que je cherche à démontrer trois étapes dans l’histoire du spot
publicitaire français, tendant de manière paradigmatique à la dissolution d’une
communication publicitaire classique et susceptible de mentir. Quant à mes réflexions
méthodologiques, je m’appuie d’un côté sur des sémiologues comme Barthes, Eco et Pierce.
Barthes a notamment travaillé sur la publicité dans ses Mythologies et dans La rhétorique de
l’image, mais il a également eu des réflexions sur le récit. Il y aussi Metz, qui évoque dans
son dernier ouvrage le problème d’énonciation. Il y a aussi Jost, dont j’ai adapté le point de
vue auditif et visuel. Quand on parle de Jost, il faut bien sûr penser à la narratologie, et
lorsqu’on veut réfléchir sur ce sujet, on commence par Gérard Genette. La littérature
publicitaire est diversifiée. J’ai aussi travaillé sur des monographies publiées par les créatifs
comme Séguéla ou Nicolas Riou, mais aussi avec des articles et des livres publiés par les
sémiologues comme Chantal Duchet, et les littéraires tel Klumfer.
Un point important dans mon travail était la recherche et le visionnage des films et
des spots ; ceci a été fait à la Maison de la publicité, au Musée de la publicité et à
l’Inathèque de France. Pourquoi dans ces trois maisons ? Les spots publicitaires démarrent

Inter-Atelier du 24/10/03 : Histoire, archives et publicité
Institut national de l’audiovisuel - www.ina.fr
5
avec les frères Lumière, ces documents se trouvent à la Maison de la publicité. Puis les
documents réalisés à partir des années 70 se trouvent au Musée de la publicité ; et enfin,
toutes les publicités diffusées à partir de 1995 se situent à l’Inathèque de France.
Au cours des analyses de plan, j’ai surtout observé la mise en scène, les moyens
techniques et esthétiques, le point de vue visuel et auditif, le verrouillage, le pack-shot, les
instances narratives, la voix et la caméra, le message explicite et le message implicite.
Trois points d’observation ont été importants pendant ma recherche. Je me suis
interrogée sur : 1/ Y a-t-il des intentions esthétiques entre les instances narratives de la voix
extra ou intradiagétique et celles de la caméra ? 2/ Est-ce le message implicite ou le
message explicite qui domine ? 3/ Y a-t-il une plus-value esthétique ? La plus-value
esthétique se comprend comme un indice de codage complexe et polyvalent qui demande
au spectateur un décodage actif et nouveau. Je m’appuie là sur Umberto Eco.
Ces points d’observation en tête, j’ai donc analysé les films publicitaires des années
30 aux années 90. On part de l’hypothèse que la voix extradiagétique du présentateur – très
présent dans les premières années de la publicité – a une fonction de compensation par
rapport au vendeur : on suppose que la caméra n’a qu’une fonction d’illustration de la voix.
Cette relation évolue vers une caméra au rôle plus important dans la transmission du
message explicite et implicite. La question qui se pose reste de savoir par quels moyens
esthétiques et narratologiques, le spot publicitaire opère pour atteindre le but escompté, et
de quelle manière il instrumentalise les moyens des nouveaux médias et ceux de la
narration. Le fait-il par une voix off – omniprésente et autoritaire – qui vante le produit ? Ou
bien le fait-il grâce au présentateur, ou bien encore à travers un personnage ?
Il faut partir du produit, ou plutôt de l’histoire à laquelle on associe une marque.
J’ai groupé ensemble les années 30, 40 et 50 et j’ai divisé en genres : « art de narration » et
« fonction de vente ».
Les 3 spots publicitaires que je vais vous montrer sont classiques parce que j’ai remarqué
que la voix et la caméra s’utilisent d’une manière redondante. Les qualités du produit sont
montrées de façon hyperbolique, on cherche à convaincre le consommateur par une
publicité appellative ; la véracité du contenu du spot est douteuse.
Diffusion d’un film publicitaire
Lessive OMO – 1948
Heidi WITTING : Faisons quelques commentaires. Dès le départ, on sait qu’il s’agit d’une
publicité car on est immédiatement placé au cœur du problème : le linge n’est pas propre. Il
s’agit ici d’une stratégie tout à fait classique. Le produit est très visible. Il y a le problème,
puis la solution, puis la preuve que le spectateur est amené à constater. Il y a deux femmes
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
1
/
35
100%