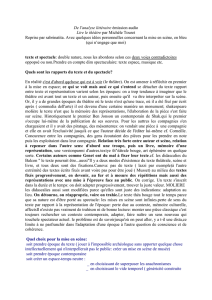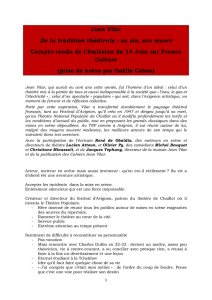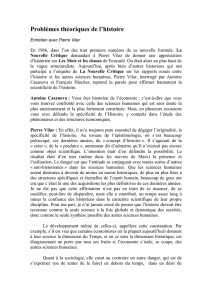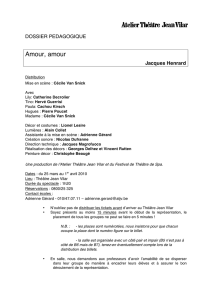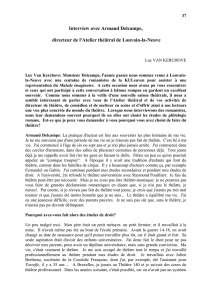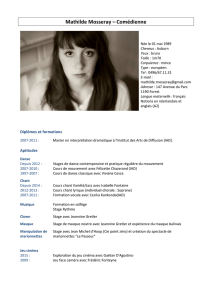Les Cahiers de la Maison Jean Vilar

9
Les Cahiers de la Maison Jean Vilar
N° 109 - JANVIER - FEVRIER - MARS 2010
Il y a les morts, il y a les vivants,
et ceux qui vont sur la mer...

SOMMAIRE
Présence des morts par Emmanuel Berl 3
NosMorts.com par Jacques Téphany et Rodolphe Fouano 4
D’âge en âge, Roger Mollien par Jacques Lassalle 6
Jean-Paul Roussillon : propre à rien par Alain Françon 10
André Benedetto
Un homme libre par Bertrand Hurault 12
Mon premier maître par Philippe Caubère 15
Pina Bausch
L’éternelle voyageuse par Bernard Faivre d’Arcier 18
Pour Pina par Wim Wenders 21
Alain Crombecque
66, Chaussée d’Antin par Jacques Téphany 22
Une passion par Jacques Montaignac 26
L’oreille absolue par Valère Novarina 27
Christian Dupeyron par Armelle Héliot 28
Catherine Le Couey par Jacques Téphany 30
Andrée Vilar par Jacques Téphany 32
La question posée à...
Philippe Avron, Jacques Frantz, Victor Haïm, Joël Huthwohl,
Joël Jouanneau, Jorge Lavelli, Jean-Pierre Léonardini,
Muriel Mayette, Roland Monod, Pierre Notte, Jack Ralite,
Rufus, Michel Vinaver, Frédéric Vitoux. 41
Les morts parlent des morts :
Charles Dullin et Louis Jouvet par Jean Vilar 50
Albert Camus par Jean-Paul Sartre 51
Balzac par Victor Hugo 52
Florilège :
Montaigne, Kant, Pascal, Sartre, Freud, Bacon,
Schopenhauer, Leibniz, Nietzsche, Jules Renard, Heidegger,
Jankélévitch, Epicure, Spinoza. 54
La mort n’a rien de tragique par René de Obaldia 63
Couverture : citation attribuée à Homère. Illustration : tapisserie (Aubusson) d’après un carton d’Andrée Vilar.

3
Présence des morts
!"#$%"&'(&')*#$'+&,$&-'."/'0*-1$'&1'2&'$.#$3'
+*"-%"*#')*,4'4&'0.2.#$&3')5$'%"&'(&'+&,$&'6'&"/'7'
8&',9.#'+.$'0*#,$'0.":.#$&'4*,$4#&,4&3'%".,)'(&'0&'
1*"-,&':&-$'&"/'%"&'%".,)'(&'09&,');1*"-,&<
=0+#&$3')5$'%"&',*"$'2&$',;>2#>&*,$3'$"$+&41$'
)5$'%"&',*"$'2&$'?*,*-*,$<'@*,,&"-$');-#$*#-&$3'
,*"$A0B0&$',9&,'$*00&$'+.$')"+&$3'."/'0*0&,1$'
0B0&$'*C',*"$'2&$'2&"-'-&,)*,$'D'E&$'>&-F&$3'4&$'
4*"-*,,&$3'2&$'0*-1$'$*,1'F#&,'2&"-$')&$1#,.1.#-&$'
,*0#,."/3'+-&$%"&'1*"(*"-$3'2&"-$')&$1#,.1.#-&$'-;&2$'
$*,1':#:.,1$'G'2.':&":&3',*,'+.$'2&');4;);<'H.,$'2&$'
4#0&1#5-&$3'."1*"-')&$'1*0F&$3'4*00&,1')#$4&-,&-'
2.'!');2#1;')&'29*$1&,1.1#*,3'2.'1-#$1&$$&')&'29&$+*#-3'2&'
-&4"&0&,1')&'29#0+.1#&,4&3'2.'+#;1;')"'$.4-#25>&'7'
I*#A0B0&3')5$'%"&'(&'09J'1-*":&3'(&'0&'$&,$'F.22*11;3'
1#-.#22;'&,'$&,$'4*,1-.#-&$'+.-'2&'$4-"+"2&'&1'+.-'2&'
-&0*-)$<
8&'$.#$'1-*+'%"&'0.'0;0*#-&'&$1'#,!')52&',*,'0*#,$'
%"9*"F2#&"$&'G'2.'+2"+.-1')&'0&$'$*":&,#-$3'&22&'2&$'
.'+&-)"$'K'4&"/'%"9&22&'.'>.-);$3'&22&'2&$'.'4?.,>;$<'
!.-&'."/'4*,$&-:.1&"-$')&'0"$;&$'%"&'L&,*#-'
);,*,M.#13'&1'%"#3'$*"$'4*"2&"-')&'2&$'$.":&-3'
>N4?&,1'2&$'1.F2&."/'%"9*,'2&"-'4*,!'&'O<<<P
@;2.$'D'Q*"$'1-.?#$$*,$'2&$'0*-1$'&,'2&$'*"F2#.,13'
&1',*"$',&'+*":*,$'+.$'+&,$&-'6'&"/'$.,$'2&$'1-.?#-'D'
Q*$'!');2#1;$'$9.:5-&,1')9."1.,1'+2"$'.F"$#:&$'%"9&22&$'
$*,1'+2"$'R&-:&,1&$<'S&'$"-:#:.,1'!',#1'+.-'4-*#-&'
%"9*,':#*2&'2&$':*2*,1;$')"'0*-13'%".,)'*,'-;$#$1&'
."/'$#&,,&$<'T.'+#;1;'1*"-,&'&,'#)*2N1-#&'K'#2'$&'!'>"-&'
.)*-&-'",')#$+.-"3'%".,)'#2'$&'+-*$1&-,&')&:.,1'$&$'
+-*+-&$'+.$$#*,$<
Emmanuel Berl
Présence des morts (1936)
Collection L’Imaginaire, Gallimard.
La chute d’Icare, pastel d’Andrée Vilar, s.d.
Collection Famille Vilar.
V

LES CAHIERS DE LA MAISON JEAN VILAR – N° 109
4
nosmorts.com
Au cours des mois derniers, nos métiers ont déploré la disparition de nombreuses personnalités.
Certaines d’entre elles touchaient si particulièrement Avignon, le Festival, la Maison Jean Vilar, que
notre revue se devait de leur rendre hommage. Le lecteur ira à leur rencontre au fi l de ces pages
mélancoliques…
Mais comment ne pas risquer de voir nos Cahiers transformés en bulletin nécrologique ? Sans doute en
ouvrant notre réfl exion à la question de la mort au théâtre : comment le monde du spectacle affronte-
t-il cette absurdité ?
Nous avons déjà abordé cette problématique l’été dernier à l’occasion de l’hommage rendu à Gérard
Philipe lors du cinquantenaire de sa disparition. Nous rappelions qu’en matière musicale ou littéraire,
les « tombeaux » sont des hommages à des maîtres sans obligation à l’expression du deuil ou de la
douleur. L’un des poèmes les plus inspirés de Mallarmé, Le Tombeau d’Edgar Poe, fait écho à celui de
Baudelaire par Pierre-Jean Jouve, à celui de Claude Debussy par Manuel de Falla, ou encore au Tombeau
de François Couperin de Maurice Ravel. Et Henri Pichette, poète de Nucléa et ami du comédien, n’a-t-il
pas écrit un Tombeau de Gérard Philipe ?
De l’oraison funèbre au « tombeau », des rites d’enterrement ou de crémation à l’érection de monuments
et aux célébrations des anniversaires, l’hommage aux morts est une réponse à l’éternelle interrogation
devant notre fi nitude. Et notre Maison, qui porte le nom d’un grand mort dont on ne sait plus si la patrie
lui est reconnaissante, est souvent prise entre les deux
pinces d’un étrange paradoxe : mémoire et/ou/contre
modernité. Du moins essaie-t-elle d’apporter sa contri-
bution à la question tellement inscrite dans l’air du temps
des attachements au passé, eux aussi écartelés entre
affection sincère et calcul égoïste.
«Le spectacle continue» est une règle spécifi que au métier.
En cas d’accident, l’acteur n’est guère remplaçable au
pied levé : quoi qu’il lui arrive, jambe cassée ou perte d’un
proche, il doit jouer parce qu’il est une partie d’un tout.
Les exemples abondent… Mais surtout, l’acteur n’existe
pas sans l’acte de la représentation. C’est ainsi que le jour
de la mort de Gérard Philipe, Vilar n’a pas trouvé meilleur
moyen de lui rendre hommage que de jouer quand même
– ce que certains lui reprochèrent. Vilar n’envisageait pas
que son théâtre fût en berne : c’eût été tuer l’acteur une
deuxième fois.
Si dans les sociétés modernes, la mort est souvent
évacuée (on meurt seul et le convoi du citoyen anonyme
n’est plus suivi par les voisins du quartier…), la mise en
scène de celle des grandes personnalités, dernièrement
de Philippe Séguin à Mickaël Jackson, atteint toujours
des proportions littéralement spectaculaires. C’est que
les morts sont aussi des enjeux pour les vivants, et la
»

5
panthéonisation d’Albert Camus, qui sert à la fois des intérêts politiques et commerciaux, permet un
retour, voire une libération du refoulé au cœur du débat sur l’identité nationale : Amédée, ou comment
s’en débarrasser…
Au-delà du deuil et de la tristesse, il est peut-être d’abord question de séparation d’avec nous-mêmes,
les vivants : n’est-ce pas cette angoisse qui nous hante lorsque nous « fêtons » nos anniversaires, qu’il
s’agisse de nos années enfuies dans notre corps, nos entreprises, ou nos théâtres ? Célébrer, un an ou
vingt ans après, la naissance du 104 ou celle du centre dramatique national de Limoges, le centenaire
de la naissance de Ionesco ou le cent-cinquantième d’Anton Tchékhov, cela a-t-il plus de sens que de
fêter les non-anniversaires du Lapin d’Alice lorsqu’elle se promenait au pays des merveilles ? Notre
cher Hugo lui-même pratiquait un véritable culte des anniversaires quelle qu’en fût l’origine : amours,
deuils, événements politiques, comme s’il s’agissait de borner le temps, de se l’approprier… Notre
époque n’a donc pas inventé ce rite, mais comment ne pas en observer l’infl ation ?
La célébration est même aujourd’hui en libre-
service sur internet. Le site JeSuisMort.com
invite à « se recueillir sur les tombes des
hommes et des femmes les plus célèbres ».
La consultation des biographies permet de
« savourer l’histoire de chacun » et par un
système de vote de faire « évoluer leur score de
popularité ». On trouve un « top 50 » des morts
en ligne ! Le site invite à souffl er les bougies de
leurs anniversaires. Le webmaster recommande
« silence et bonne promenade », proposant le
classement des morts les plus vus la veille sur
le site, ou au cours du mois précédent. En ce
mois de janvier 2010, Mickaël Jackson est « le
plus visité », devant Jésus (4e) ou Adolf Hitler (6e). On serait presque rassuré de voir Victor Hugo pointer
à la dix-huitième place – après Marilyn Monroe, certes, mais devant Mike Brant ! On peut aussi écrire
une lettre posthume même si « personne ne vous répondra » ! Molière en a reçu 12, Shakespeare 9,
Musset 3, mais Gérard Philipe 11. Elles émanent souvent de potaches en mal d’exposés ou de mise
en scène de soi sur le Net… Un autre site anglophone, fi ndagrave.com, invite à se rendre sur la tombe
choisie et à y déposer des messages, des fl eurs, des bougies virtuelles.
Au-delà de ces formes de comédie macabre, au-delà des apparences – excès de théâtralisation là-bas,
d’intériorisation ici –, notre conversation avec l’absence nous conduit-elle à parler d’abord de nous-
mêmes, l’Autre ne pouvant plus répondre ? Dans ces conditions, et pour rester dans notre domaine,
comment rendre hommage à un auteur ou à un compositeur ? à un comédien ? à un metteur en scène ?
à un directeur de théâtre ou de festival ? à un producteur ? à un éditeur ? Comment ne pas sombrer dans
la contemplation du passé et la nostalgie ? Visiter les vies révolues, autrement dit se souvenir, est-ce
« moderne » ? Là est la question que nous avons posée à tous ceux qui ont si généreusement participé
à ce numéro.
À ces couronnes de contributions, nous avons ajouté un fl orilège de sagesses, d’Épicure à Jankélévitch
en passant par Paul Valéry : « La mort nous parle d’une voix profonde pour ne rien dire ».
Et ce numéro ne prétendra pas vous en dire davantage.
Jacques Téphany et Rodolphe Fouano
»
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
1
/
68
100%