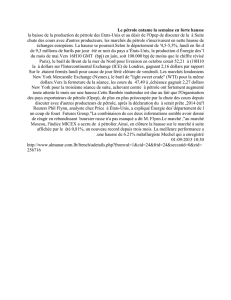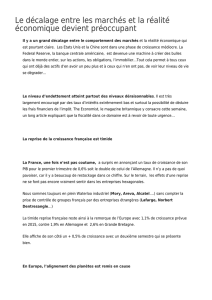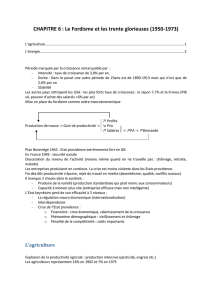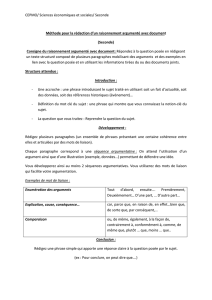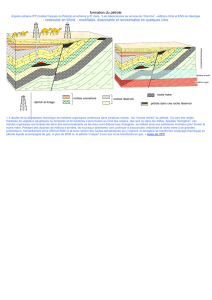La crise pétrolière :

Université de Fribourg, CH – Département de Géosciences – Géographie Humaine
Port pétrolier de Southampton (S. Joux, Septembre 2008)
TRP 2
La crise pétrolière :
Quel discours dans l’ombre
du réchauffement climatique ?
Éléments d’analyse discursive
1er Décembre 2008
Stéphane Joux
Route des Cliniques 4
1700 Fribourg
stephan[email protected]
Professeur :
Olivier Graefe

Tables des Matières
Introduction
I. Les Articulations du Discours
I.A. Un Réveil Brut
I.B. Un discours de dépendance
I.B.1. La drogue indispensable de la croissance………………………………………………………........ p. 4
I.B.2. Le pétrole : un bien géostratégique ………………………………………………………………. p. 6
I.B.3. Vers un sevrage abrupt : le discours de catastrophe imminente…………………………………... p. 6
I.C. La déplétion : un événement historique.
I.C.1. Le secret et la manipulation autour des capacités et des réserves ……………………………….. p. 8
I.C.2. Le jeu des devinettes ………………………………………………………………. p. 9
I.C.3. Les mystères du prix ………………………………………………………………. p. 10
I.C.4. Le discours de l’inévitable pic mondial ………………………………………………………………. p. 11
I.D Déplétion pétrolière et changement climatique : un même combat ?
I.D.1. La déplétion pétrolière dans l’ombre du réchauffement climatique ……………………………….. p. 11
I.D.2. La déplétion pétrolière : une bénédiction cachée? …………………………………………………. p. 14
II. La Construction du Discours
II.A. Émergence dans l’histoire
II.A.1. Le discours de la pénurie de pétrole aux Etats-Unis au début du siècle ………………………… p. 15
II.A.2. La théorie de Hubbert : la déplétion américaine ……………………………………………………. p. 15
II.A.3. Les chocs pétroliers de 1973 et 1979 ………………………………………………………………. p. 16
II.A.4. L’ASPO et la crise du pétrole ………………………………………………………………. p. 17
II.A.5. La déconstruction du mythe américain ………………………………………………………………. p. 18
II.B. Les Acteurs et les Intérêts
II.B.1. Pour un prix fort ………………………………………………………………. p. 20
II.B.2. Pour les énergies renouvelables ………………………………………………………………. p. 20
II.B.3. Pour la taxation et la régulation ………………………………………………………………. p. 21
II.B.4. Pour une pédagogie des catastrophes ………………………………………………………………. p. 21
II.C Les mythes fondateurs
II.C.1 Mythe de l’énergie bon marché et abondante ……………………………………………………….. p. 22
II.C.2. Le mythe de la croissance éternelle ………………………………………………………………. p. 23
II.C.3. Le mythe du déclin ………………………………………………………………. p. 24
II.C.4. Le mythe de la cohésion scientifique ………………………………………………………………. p. 25
II.D. Les peurs en jeu
II.D.1. Le grand complot de la technique ………………………………………………………………. p. 25
II.D.2. L’impuissance et l’inaction ………………………………………………………………. p. 26
II.D.3. La fin de la civilisation ………………………………………………………………. p. 28
II.D.4. Une crise de sécurité : la peur de l’inconnu ………………………………………………………… p. 29

TRP2 Géographie Humaine Le Pic de Pétrole : Elements d’analyse discursive
III. L’enveloppement du Discours
III.A La Polarisation
III.A.1. Le secret des initiés et le déni public ………………………………………………………………. p. 30
III.A.2 Optimisme et pessimisme ………………………………………………………………. p. 32
III.A.3. Consommation et sobriété ………………………………………………………………. p. 33
III.A.4. Anticipation et réaction ………………………………………………………………. p. 35
III.A.5. Géologie et économie ………………………………………………………………. p. 36
III.B. L’irruption du bon sens
III.B.1. L’impact de la finitude ………………………………………………………………. p. 38
III.B.2. L’instinct ancestral des équilibres ………………………………………………………………. p. 40
III.B.3. L’argent ne fait pas le bonheur ………………………………………………………………. p. 41
III.C. La pulsion de changement
III.C.1. La frustration démocratique ………………………………………………………………. p. 42
III.C.2 Une nouvelle évaluation économique de l’énergie …………………………………………………. p. 43
III.C.3. Une alternative au développement ………………………………………………………………. p. 45
III.C.4. Le changement par le prix ………………………………………………………………. p. 46
Conclusion
Les leçons du discours de déplétion ………………………………………………………………. p. 47
Conclusion du travail ………………………………………………………………. p. 47
Bibliographie
Annexe

TRP2 Géographie Humaine Le Pic de Pétrole : Elements d’analyse discursive
- page 1 -
Introduction
Le 19 février 2008, pour la première fois de l’histoire, le baril de pétrole a dépassé à New York le seuil symbolique
des 100 dollars américains, ce qui représente un record absolu. En juillet 2008, le prix du même brut atteignait 145
dollars le baril, avant de s’effondrer aux alentours de 50 dollars le baril après les krachs boursiers de l’Automne.
La tension est forte sur l’offre qui risque de ne plus suffire à la demande, d’autant plus que pour certains
spécialistes, la perspective prochaine de voir se tarir les gisements de cette ressource stratégique renforce la
probabilité d’un pétrole moins abondant et durablement cher.
La croissance de la demande énergétique dans le monde, due à l’essor économique fulgurant des économies en
transition combinée à la saturation des capacités de production des pays producteurs, en plus de l’insuffisance
des industries de raffinage dans certains pays consommateurs, constituent différents facteurs qui, pris dans leur
ensemble, expliquent en partie la tension sur l’offre des hydrocarbures. Pour d’autres analystes, ce sont plutôt les
tensions géopolitiques qui sont au centre des inquiétudes sur l’offre pétrolière. La volatilité du marché des cours
du pétrole est certainement amplifiée par de fortes spéculations induites par des incertitudes à la fois
géopolitiques, financières, techniques et environnementales. Contrairement aux deux chocs pétroliers précédents
(1973, 1979), cette flambée des prix depuis 2004 n’est pas corrélée à une crise internationale géopolitique
majeure.
Cette situation inédite réveille dans l’opinion publique un discours de crise, de déplétion et de pic de production
autour d’une spéculation sur les réserves réelles. La parution du film documentaire « The Oil Crash » (McCormack
Ray et Basil Gelpke, 2006), qui fait écho au documentaire « An Inconvenient Truth » (Guggenheim 2006) présenté
par Al Gore pourrait révéler l’émergence d’un discours de pénurie et de crise imminente dans le grand public qui
prendrait sa place aux côtés du discours climatique.
Mais il apparaît que le discours de crise pétrolière reste, dans le discours public et vulgarisé, relativement discret
par rapport à la thématique du réchauffement climatique, à tel point que j’ai découvert ce problème par hasard en
parcourant un article du professeur Gérard Stampfli de l’université de Lausanne (Uniscoop, no. 526 / 2007).
Dès lors je me suis posé la question de savoir pourquoi le sujet restait à ce point discret alors que le discours
d’une crise énergétique semble indiquer un danger beaucoup plus imminent et menaçant pour le fonctionnement
de nos sociétés qu’un réchauffement climatique à long terme soumis à de nombreuses incertitudes. La découverte
des ouvrages de vulgarisation autour de la crise énergétique et une analyse du discours sous-jacent me parut un
bon moyen de trouver des éléments de réponse à la question posée précédemment.
C’est pourquoi j’ai commencé par dégager du documentaire « The Oil Crash » (McCormack Ray et Basil Gelpke,
2006) les principales articulations du discours avant de le rattacher au contexte des nombreuses parutions
récentes, qui déclinent le même discours sous des formes variées avec des interprétations, des explications et
des tentatives de faire la part des choses assez récurrentes.
Après cette synthèse du discours, je me dégagerai de l’ambitieuse entreprise d’en restituer la vérité factuelle qui
ressort de la géologie, de la géographie politique et économique pour me consacrer à une étude plus
herméneutique propre à la géographie humaine. En effet, les affirmations pertinentes restent difficiles d’accès
dans un contexte politique, commercial et technique vecteur de secret et de dissimulation. Je laisserai aux
spécialistes des sciences pétrolières la tâche ardue de séparer le bon grain de l’ivraie et de juger de la pertinence
des avertissements de pénurie et de l’impact probable des crises économiques et sociales résultantes.
La première partie du travail consistera à étudier les phénomènes discursifs qui interviennent dans la
problématique. Je tenterai de préciser le discours et ses enjeux. Quelle vérité se déploie dans quel contexte ?
Quel environnement rend des idées importantes qui passeraient inaperçues le cas échéant ? Quels sont les
arguments en jeu ?
La seconde partie de ce travail sera consacrée à la construction sociale et politique du discours. Par qui la vérité
du discours a-t-elle été construite ? Comment s’est-elle formée puis développée ? Pourquoi ce type de discours et
pas un autre ? Qui a le droit de construire le discours ? Il s’agira d’explorer les régularités du discours au cours de
l’histoire, les intérêts qui le promeuvent, les mythes qui lui donnent vie et les symboles qui lui confèrent sa prolixité
actuelle, symboles qui sont nourris de leviers culturels bien plus anciens que l’exploitation industrielle du pétrole.
Dans une troisième partie, j’examinerai l’enveloppe du discours c’est-à-dire ce qui le contient, le contraint, le limite
et le raréfie, mais aussi l’emballe et le propulse.

TRP2 Géographie Humaine Le Pic de Pétrole : Elements d’analyse discursive
- page 2 -
Je m’attacherai à la contrainte de polarisation qui stérilise le discours, à l’irruption du bon sens commun qui le
simplifie, le radicalise tout en le rendant plus lisible, donc plus accessible.
Enfin, je me pencherai sur la pulsion de changement qui porte le discours et lui confère toute son incision dans les
consciences et dans les perspectives d’avenir.
Parallèlement, cette étude conduira à examiner ce que révèle le discours sur le fonctionnement de nos sociétés.
La recherche des démarches herméneutiques adéquates et l’élaboration d’une méthode d’analyse pertinente
constituent une partie importante de ce travail et s’avère bien antérieure à la construction et au déploiement de
l’argumentation introduite précédemment. Ce travail préalable fait l’objet d’un résumé méthodologique qui explique
le choix du plan.
Au cours du travail d’exploration méthodologique mené parallèlement aux lectures des ouvrages sur le sujet, les
pistes et les perspectives d’analyses se sont développées et étoffées.
J’ai alors pris conscience que le travail mènerait à un volume d’étude largement supérieur au cadre d’un travail de
Bachelor (TRP2). Un choix difficile s’imposait : réduire le champ d’étude, quitte à se limiter à une seule analyse
particulière ou en diminuer la voilure globale.
Pour ne pas nuire à la cohérence du travail, j’ai choisi la seconde alternative : garder l’articulation du plan initial en
respectant tous les niveaux d’analyse pour rester fidèle à la méthodologie choisie.
Il s’agit donc ici d’un travail certes très ambitieux, mais contraint et limité dans son expansion par le cadre du
travail de Bachelor, qui présente néanmoins l’avantage de se prêter à un développement futur.
Ce travail s’étend de mai 2008 à novembre 2008. Il s’est déroulé dans le même temps que la crise financière qui a
touché l’économie à l’automne 2008. Certaines réflexions ont été rattrapées par l’actualité. Cela rend le sujet
particulièrement sensible aux développements de l’actualité, il s’agit donc d’une opération « à cœur ouvert ».
Méthodologie
Aborder l’analyse discursive de la problématique pétrolière pose d’importantes difficultés. En effet, si la littérature
thématique est abondante dans les milieux économiques, politiques et alternatifs, les parutions scientifiques en
géographie humaine sont maigres, pour ne pas dire inexistantes, contrairement à la problématique climatique, qui
intéresse beaucoup plus les géographes et les médias. Après recherche, j’ai n’ai trouvé qu’une poignée d’articles
spécifiques consacrés à la construction sociale sur les réserves de pétrole aux Etats Unis (Bowden 1985 ; Dennis
1985 ; Jung 1994 ; Olien 1993).
La difficulté de l’entreprise tient à l’extrême interdépendance des faits liés aux questions énergétiques, l’impact
énorme dans toutes les composantes de notre vie quotidienne ainsi que l’interdisciplinarité de la thématique qui
touche à la fois l’économie, la politique, la géologie, la géographie physique et humaine ainsi que la sociologie et
la philosophie.
Prendre la distance nécessaire pour échapper à la tentation de pétrir la substance du discours sans que cette
distance soit trop grande pour échapper au champ d’étude de la géographie représente un défi de taille.
J’essaierai de le relever, mais ne pourrai guère éviter des allers-retours dans la substance du discours, tant est
dense le maillage entre signifiant et signifié. Il s’agit donc de suivre une méthode d’analyse qui prenne en compte
ce maillage complexe tout en gardant l’altitude ainsi qu’une vue dégagée sur ses méandres.
Autrement dit, comment analyser l’échelle collective de production, de circulation et d’intervention du discours
sans tomber dans le piège d’un idéalisme abstrait trop éloigné de la symbolique des événements ou dans le piège
d’un matérialisme réducteur collé aux éléments du discours ?
La tradition herméneutique offre différentes méthodes pour interpréter un discours donné. Après l’étude des
principaux développements historiques de l’herméneutique traditionnelle dans la littérature classique, j’en
retiendrai les éléments qui me semblent pertinents pour procéder au travail d’analyse sur la problématique
pétrolière.
Il s’agira d’abord de suivre la piste herméneutique traditionnelle et de remonter du discours à la pensée, du signifié
au signifiant. L’opération fondamentale de la compréhension prendra donc la forme de la reconstruction d’un
discours, en considérant des horizons de sens de plus en plus englobants comme des cercles
concentriques (Wernet 2006).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
1
/
65
100%