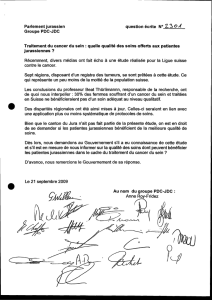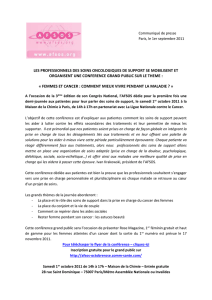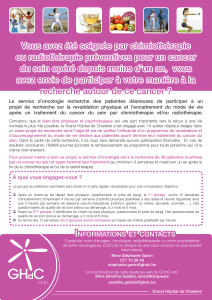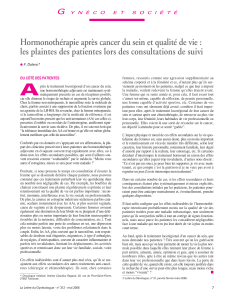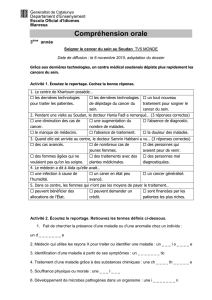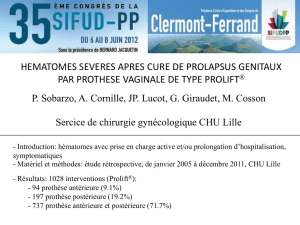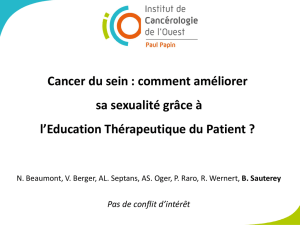La promontofixation par prothèse sous coelioscopie dans le

La Lettre du Gynécologue - n° 326 - novembre 2007
Dossier
Dossier
32
La promontofixation par prothèse sous cœlioscopie
dans le traitement du prolapsus des organes pelviens :
résultats d’une série de 138 patientes
Laparoscopic promontory in pelvic organ prolapse treatment
IP R. Botchorishvili, C. Rivoire, M. Canis, A. Wattiez, K. Jardon, B. Rabischong, G. Mage*
* Service de gynécologie obstétrique et reproduction humaine, polyclinique de l’Hôtel Dieu,
63000 Clermont-Ferrand.
Le prolapsus génital est une affection fréquente. Ainsi,
42,6 % des femmes entre 15 et 97 ans présenteront un
trouble de la statique pelvienne, dont le traitement reste
essentiellement chirurgical (1). À l’âge de 80 ans, 11,1 % des
femmes ont bénéficié d’un geste chirurgical pour prolapsus ou
incontinence urinaire, dont 29,2 % avec des interventions à ré-
pétition (2). Les techniques chirurgicales sont nombreuses et
utilisent diverses voies d’abord (3, 4).
Une des techniques de référence est la promontofixation,
décrite par Ameline, Huguier et Scali en 1957, mais semble-t-
il déjà réalisée à la fin du XIXe siècle (5). Son principe repose
sur une fixation forte en arrière, du fait du rôle essentiel des
ligaments utéro-sacrés (6).
La fixation est initialement assurée par des fils, puis utilise des
prothèses à partir des années 1970. Fixées sur le fond vaginal lors
des premières interventions, ces prothèses ont ensuite été pla-
cées sur toute la hauteur du vagin pour permettre une meilleure
distribution de la tension et une amélioration des résultats à long
terme (7-10). En 1993, Dorsey et al. décrivent pour la première
fois une promontofixation sous cœlioscopie (11).
Nous utilisons cette technique depuis 1992 (12). Le but de ce
travail est l’évaluation des résultats à long terme d’une série
de malades ayant bénéficié d’une cure de prolapsus avec mise
en place d’une prothèse inter-vésicovaginale et inter-rectova-
ginale sans ouverture peropératoire du vagin.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Notre étude porte sur une série rétrospective continue unicen-
trique de 138 patientes ayant été opérées pour un prolapsus
urogénital par promontofixation sous cœlioscopie entre le 1er
janvier 1998 et le 31 décembre 2003 dans le service de gyné-
cologie obstétrique de la polyclinique (Pr Mage, Hôtel Dieu,
CHU Clermont-Ferrand). Ont été exclues les patientes opé-
rées d’un prolapsus par une autre voie d’abord, les patientes
ayant eu une hystérectomie totale dans le même temps opé-
ratoire, les patientes n’ayant pas eu de fixation de la prothèse
postérieure sur les muscles releveurs de l’anus.
En préopératoire, un interrogatoire et un examen clinique
urogynécologique sont pratiqués, afin de déterminer le type
et le degré de prolapsus (échelle allant de stade 0 à 4) et les
signes associés, en particulier l’incontinence urinaire d’effort
selon la classification MHU : stade 0 absente, stade 1 efforts
violents (sport, course), stade 2 efforts moyens (quinte toux,
éternuement, soulèvement, rire), stade 3 efforts faibles (toux
isolée, marche, accroupissement, mouvement brusque), stade
4 moindre changement de position (13). Un examen urodyna-
mique est demandé chez les patientes présentant des signes
urologiques ou une suspicion d’incontinence masquée.
L’installation opératoire est habituelle : sous anesthésie
générale, décubitus dorsal, jambes en position semi-fléchie,
sondage urinaire à demeure, canulateur utérin pour la mani-
pulation de l’utérus, position de Trendelenburg et utilisation
de quatre trocarts (deux de 10 mm au niveau ombilical et
sus-pubien et deux de 5 mm en latéral droit et gauche). Une
antibioprophylaxie est réalisée en peropératoire. Pour faciliter
l’exposition de la région, nous utilisons une fixation du sig-
moïde peropératoire à la paroi abdominale à l’aide d’un fil fixé
par un bourdonnet.
L’abord du promontoire nécessite un repérage de L5-S1, de la
bifurcation aortique, de l’uretère droit, de la limite inférieure
de la veine iliaque primitive gauche et des vaisseaux sacrés
médians. L’incision verticale du péritoine prévertébral est pro-
longée vers l’incision de l’espace rectovaginal, laissant l’uretère
droit latéralement et respectant les vaisseaux sacrés médians.
La dissection de la cloison rectovaginale est réalisée après inci-
sion du péritoine sous la jonction des ligaments utéro-sacrés
et dissection au contact de la paroi vaginale, jusqu’au cap anal
et aux muscles releveurs de l’anus.
Une hystérectomie subtotale, avec ou sans annexectomie est
réalisée avec suture du moignon cervical restant. L’utérus est
morcelé avec un morcellateur cœlioscopique en fin d’interven-
tion. En cas d’hystérectomie antérieure, l’exposition du fond
vaginal est obtenue grâce à une compresse montée sur pince
longuette insérée dans le vagin pour faciliter les dissections.
En cas de conservation utérine, une dissection et fenestration
bilatérale du ligament large sont effectuées.
La dissection de l’espace vésicovaginal est obtenue par incision
du péritoine et poursuivie sur la ligne médiane en refoulant la
vessie jusqu’au col vésical.

La Lettre du Gynécologue - n° 326 - novembre 2007
Dossier
Dossier
33
Les prothèses sont introduites par un trocart de 10 mm. Il
s’agit soit de deux prothèses, une prothèse postérieure en
forme de U, une prothèse antérieure en forme de pointe (de
type Gynemesh
®
(40 mm x 150 mm x 2), soit d’une prothèse
prédécoupée avec positionnement antéropostérieur (de type
Parietex
®
40 mm x 300 mm).
La prothèse postérieure est fixée de chaque côté sur les rele-
veurs de l’anus puis aux ligaments utéro-sacrés et à la partie
postérieure du col par des points non transfixiants sans ten-
sion. La prothèse antérieure est placée entre la vessie et le
vagin antérieur, et fixée par un point à la face antérieure du
vagin non transfixiant puis au niveau du moignon cervical. Les
prothèses sont ensuite attachées entre elles et au ligament pré
vertébral. Les sutures sont réalisées par des fils non résorba-
bles (Ethibond
®
25 ch). Un geste de culdoplastie est associé
dans quelques cas par suture des ligaments utéro-sacrés.
La péritonisation est faite par un surjet aller retour en deux
temps : tout d’abord une péritonisation antérieure au niveau
du moignon cervical en prenant le péritoine antérieur et pos-
térieur avant la fixation de la prothèse au promontoire, puis
achevée par la péritonisation postérieure jusqu’au niveau du
promontoire après fixation de la prothèse au promontoire. Ce
geste est réalisé à l’aide de fils résorbables. La péritonisation
permet ainsi de recouvrir la prothèse sur tout son trajet.
La fixation au promontoire est obtenue en fixant les deux bre-
telles de la prothèse au ligament vertébral commun antérieur
par un point ou deux passé par transparence, sous contrôle
visuel superficiel pour éviter une lésion discale. La prothèse
est posée sur le promontoire sans tension.
L’espace de Retzius est ouvert par une incision du péritoine au
dessus du dôme vésical, après traction du péritoine vers le bas.
Le fascia ombilico-prévésical est disséqué, l’espace avasculaire
est ouvert permettant l’identification du ligament de Cooper,
du muscle obturateur interne, de la cystocèle latérale et de
l’arc tendineux du fascia pelvien. Un à trois points sont passés
de chaque côté entre le ligament de Cooper et la paroi vaginale
latérale. Un renfort prothétique flottant est parfois placé en
dehors et en dedans des fils de colposuspension pour réaliser
une réparation paravaginale. Dans d’autres cas, une réparation
paravaginale est réalisée par un surjet entre le vagin et l’arc
tendineux du fascia pelvien. L’espace de Retzius est ensuite
fermé par un surjet.
Le suivi postopératoire des patientes est effectué par une
consultation systématique à un mois, puis une convocation
pour une consultation à distance de l’intervention par un
des auteurs (CR) avec un recul minimum d’un an. Un ques-
tionnaire sur les symptômes urogynécologiques et digestifs
est réalisé lors de la consultation ou par téléphone pour les
patientes n’ayant pas pu venir en consultation.
Nous avons utilisé une analyse statistique univariée par test de
Mac Némar (p < 0,05). Ce test est complété par le coefficient
de kappa. Une analyse de survie est également effectuée par la
courbe de Kaplan-Meier.
RÉSULTATS
Notre étude concerne 138 patientes opérées d’une promon-
tofixation par cœlioscopie entre le 1er janvier 1998 et le 31
décembre 2003. L’analyse porte sur 131 patientes, sept ont
été perdues de vue (trois vivants à l’étranger et trois dont les
coordonnées n’ont pu être retrouvés, une patiente ayant refusé
de répondre au téléphone). Parmi les 131 patientes, 91 ont
répondu à la convocation pour une consultation, 40 ont été
interrogées par téléphone dont 17 ayant eu un examen clini-
que récent par leur chirurgien.
L’âge moyen est de 60,4 ± 9,5 ans (IC95 : 58,8-62). La parité
moyenne est de 2,5 ± 1,4 (IC95 : 2,3-2,7), et le poids moyen du
plus gros bébé est de 3 532,3 ± 531 g (IC95 : 3 441,4-3 623,2).
L’indice de masse corporel (IMC) moyen est de 24,6 ± 3,4
(IC95 : 24,1-25,1). Soixante-quinze patientes (58 %) ont un
poids normal (IMC < 25), 49 patientes (37 %) sont en surpoids
(IMC entre 25 et 29) et sept (5 %) sont obèses (IMC ≥ 30).
Quarante-trois patientes (32 %) présentent des antécédents de
chirurgie pelvienne : vingt-trois hystérectomies par voie basse
ou haute (17 %), douze cures d’incontinence par Burch (9 %),
quatre cures de prolapsus par voie basse (3 %), quatre cures de
prolapsus par voie haute (3 %).
Un prolapsus génital symptomatique est présent chez 127
patientes (96,9 %), les quatre patientes non gênées ayant
consulté pour incontinence urinaire d’effort ou dysurie. Un
prolapsus génital de stade 3 ou 4 est présent chez 99 % des
patientes avec un prolapsus maximal intéressant, le plus sou-
vent dans les étages antérieur et moyen (tableau I).
Une incontinence urinaire d’effort est présente chez soixante-
trois patientes (48 %) en préopératoire, des stades 1 et 2 pour
34 d’entre elles (70 %). Quarante-six patientes (35 %) ont une
constipation habituelle avant l’intervention. Une activité
sexuelle est rapportée par soixante-dix-huit patientes (60 %) en
préopératoire. Un bilan urodynamique est demandé pour qua-
tre-vingt-seize patientes (73 %). La capacité vésicale moyenne
est de 434,1 ± 141,1 ml (IC95 : 409,9-458,3), la pression de clô-
ture urétrale moyenne de 47,5 ± 18,5 cm H2O (IC95 : 44,4-50,6)
avec une longueur fonctionnelle urétrale de 25,4 ± 4,6 mm
(IC95 : 24,6-26,2). On constate une hypotonie avec une pression
inférieure à 30 cm H2O chez seize patientes (1 %), une hypoto-
nie sévère avec pression inférieure à 20 cm H2O chez quatre
patientes (4 %) et une instabilité chez douze patientes (9 %).
Figure 1.
Prothèse prédécoupée Parietex® (Sofradim).

La Lettre du Gynécologue - n° 326 - novembre 2007
Dossier
Dossier
34
Cinq chirurgiens ont effectué les interventions, trois séniors
et deux juniors. La technique chirurgicale est décrite dans le
tableau II.
Les prothèses utilisées sont : soixante et une Mersuture
®
(polyester multifilament) (47 %), cinquante-trois Parietex
®
(polyester multifilament) (40 %), douze Gynemesh
®
(polypro-
pylène monofilament) (9 %), cinq Surgipromesh
®
(polypro-
pylène multifilament) (4 %). La fixation au promontoire est
effectuée par du fil non résorbable chez 118 patientes (90 %),
par agrafes métalliques type Tacker
®
chez quatorze (10 %). La
durée opératoire moyenne totale est de 190,6 ± 50 mn (IC95 :
182,1-199,1).
Les complications peropératoires sont peu fréquentes (hémor-
ragie : un cas (1 %), plaie de vessie : deux cas (1,5 %), plaie de
vagin : trois cas (2 %), emphysème sous-cutané : deux cas
(1,5 %), conversion en laparotomie : 0 cas. La durée d’hospi-
talisation moyenne est de 4,7 ± 2,1 jours (IC95 : 4,4-5), avec
une médiane à quatre jours. La durée moyenne du sondage
est de 2 ± 0,6 jours (IC95 : 1,9-2,1). Vingt-six patientes (10 %)
ressentent des difficultés mictionnelles à l’ablation de la sonde
et vingt-deux (17 %) ont une infection urinaire dans la période
postopératoire immédiate. Le délai moyen de reprise du tran-
sit est de 1,3 ± 0,5 jours (IC95 : 1,21-1,39), pour la première
selle, il est de 3,7 ± 1,6 jours (IC95 : 3,5-3,9). Un réintervention
dans la période postopératoire immédiate est nécessaire dans
trois cas (2 %) : deux pour hémopéritoine (1,5 %) et
une pour dilatation pyélocalicielle et ablation d’un
point de Burch (1 %). Une évaluation de la douleur
dans la période postopératoire est effectuée par
échelle visuelle analogique : EVA moyenne à six
heures : 1,3 ± 1,4 (IC95 : 1,1-1,5), EVA moyenne à
12 heures : 0,6 ± 1,1 (IC95 : 0,5-0,7), EVA moyenne
à 24 heures : 0,8 ± 1,2 (IC95 : 0,6-1). Le recul moyen
est de 33,7 ± 17,4 mois (IC95 : 30,8-36,6).
La présence d’une récidive de gêne liée au prolap-
sus est retrouvée chez seize patientes (12%) à dis-
tance de l’intervention, avec un délai d’apparition
moyen de 26,6 ± 10,8 mois (IC95 : 20,5-32,7). Parmi
elles, sept (5 %) ont été réopérés, cinq (4 %) pour
remise en tension de la bandelette ou lâchage de
la promontofixation et deux (1,5 %) pour cure de
prolapsus par voie basse. Parmi les sept patientes
réopérées, quatre (3 %) ne présentent plus de gêne
à distance et trois (2 %) ont une gêne persistante (deux ayant
été réopérés par voie basse et une après nouvelle fixation au
promontoire). L’analyse des données de survie permet de
montrer qu’après 40 mois de suivie, la probabilité de ne pas
présenter de récidive reste stable à 0,8018, avec un intervalle
de confiance (IC95) entre 0,6689 et 0,8857 (figure 2).
Les résultats anatomiques sont étudiés en définissant deux
sous-groupes : absence de récidive : stades 0, 1, 2, récidive : sta-
des 3, 4. Il existe une différence significative pour tous les étages
du prolapsus et pour le prolapsus maximal, entre les périodes
préopératoire et postopératoire à distance (tableau I).
Une incontinence urinaire d’effort est retrouvée en postopé-
ratoire chez 57 patientes (46 %), avec une incontinence légère
(stade 1 ou 2) dans 86 % des cas et 68 % des patientes qui pré-
sentaient une incontinence préopératoire. Parmi les récidives,
neuf patientes (16 %) n’ont pas eu de geste de cure d’inconti-
nence urinaire par Burch. Sept (5 %) présentaient une inconti-
nence postopératoire sévère et ont été réopérées par TVT-O.
Une constipation persiste chez 62 patientes (47 %) à distance de
Figure 2.
Courbe de Kaplan-Meier des récidives de symptômes.
Tableau 1.
Stades de prolapsus préopératoire et postopératoire.
* Les résultats anatomiques sont séparés et évalués en deux groupes : pas de récidive grade 0-1-2, récidive grade 3-4. L’analyse statistique est
réalisée par test de McNemar (p < 0,05) complétée par le coecient de Kappa.
Stade 0 Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4
Cystocèle
préopératoire
postopératoire
2 (1 %)
45 (42 %)
5 (4 %)
40 (37 %)
19 (14 %)
14 (13 %)
62 (47 %)
8 (7%)
43 (34 %)
1 (1 %)
p < 0,001*
kappa = 0,0316
Prolapsus apical
préopératoire
postopératoire
1 (1 %)
77 (72 %)
3 (2 %)
13 (12 %)
39 (31 %)
10 (9 %)
62 (47 %)
8 (7 %)
26 (19 %)
0
p < 0,001*
kappa = 0,0101
Rectocèle
préopératoire
postopératoire
6 (5 %)
70 (65 %)
61 (47 %)
27 (25 %)
37 (28 %)
10 (9 %)
23 (17 %)
1 (1 %)
4 (3 %)
0
p < 0,001*
kappa = 0,0686
Prolapsus maximal
préopératoire
postopératoire
0
27 (25 %)
0
40 (37 %)
2 (1 %)
26 (24 %)
66 (50 %)
14 (13 %)
63 (49 %)
1 (1 %)
p < 0,001*
kappa = 0,0019
Tableau II.
Technique chirurgicale employée.
Hystérectomie subtotale
Conservation utérine
Antécédent d’hystérectomie
101 patientes (77%)
4 patientes (3%)
26 patientes (20%)
Annexectomie bilatérale 97 patientes (74%)
Traitement étage antérieur : TVT-O seul
Colpopexie selon Burch
Réparation paravaginale
Prothèse dans le Retzius
4 patientes (3%)
109 patientes (83%)
40 patientes (31%)
24 patientes (18%)
Culdoplastie 35 patientes (27%)

La Lettre du Gynécologue - n° 326 - novembre 2007
Dossier
Dossier
35
l’intervention. Une activité sexuelle est rapportée par quatre-
vingt patientes (61 %), avec treize (16 %) présentant une dyspa-
reunie persistante postopératoire.
Des problèmes de cicatrisation vaginale sont retrouvés chez
sept patientes (5 %), représentés par des érosions vaginales sur
prothèse. Une érosion survient chez 3,8 % des patientes en cas
de fixation sur le col et chez 12 % lors des promontofixations
du fond vaginal (trois cas sur sept, dont deux avec plaie de
vagin en peropératoire). Aucun cas d’érosion n’est constaté
avec des prothèses de polypropylène, toutes les érosions cor-
respondent à l’utilisation de polyester multifilament. Le traite-
ment est effectué localement par parage simple avec un délai
de reprise allant de un à vingt-quatre mois. Deux patientes
(2 %) ont eu une ablation de prothèse pour problème infec-
tieux (spondylodiscite et fistule vésicovaginale).
Les patientes sont interrogées sur leur satisfaction globale vis-
à-vis de l’intervention et cent-cinq (80 %) se sont déclarées très
satisfaites, vingt-trois (18 %) moyennement satisfaites et trois
(2 %) non satisfaites.
DISCUSSION
Notre étude réalise l’évaluation d’une technique homogène sur
une série importante de promontofixation cœlioscopique sans
ouverture vaginale en peropératoire. Cette technique apparaît
comme réalisable avec peu de complications lors de l’analyse
objective à moyen terme, réalisée par un observateur différent
de l’opérateur.
Avec un recul moyen de 33,7 mois (11-79), notre série per-
met une évaluation intéressante, aucune ne combinant une
population supérieure à 100 patientes et un recul supérieur
à 15 mois (14, 15). La technique chirurgicale semble applica-
ble à une large population. L’âge moyen est élevé, avec une
proportion non négligeable (22 %) de patientes âgées de 70
ans et plus, et l’indice de masse corporelle moyen élevé avec
une forte proportion de patientes en surpoids ou obèse. Les
contre-indications absolues sont devenues rares grâce à une
meilleure connaissance des répercussions circulatoires et une
adaptation de la prise en charge. Dans notre expérience, nous
avons dû renoncer à la voie d’abord cœlioscopique dans peu de
cas (rein pelvien, antécédents de chirurgie colique complexe).
Le temps opératoire varie en fonction des gestes effectués, varia-
tion qui est retrouvée dans la littérature (97 à 276 mn) avec des
techniques opératoires variables selon les études (14, 16). Cepen-
dant, le temps opératoire est actuellement, dans notre expérience,
acceptable, inférieur à trois heures et peut être réduit par l’utilisa-
tion d’agrafes, la conservation utérine et l’entraînement.
La cœlioscopie présente des avantages en termes de confort
postopératoire et de délai de récupération pour les patien-
tes. La douleur semble faible avec des EVA moyennes dans
notre étude ne dépassant pas “1”. Une reprise du transit rapide,
une durée de sondage de deux jours, un taux de réinterven-
tion immédiate faible de 3 % et une durée d’hospitalisation
moyenne de 4,7 jours sont constatés dans notre série. La
durée d’hospitalisation dépend essentiellement des habitu-
des du service et de la présence d’un suivi approprié après la
sortie d’hospitalisation avec organisation d’un réseau de soins
en ambulatoire. Elle est significativement inférieure pour une
promontofixation par cœlioscopie (1,8 jours) en comparaison
à la laparotomie (quatre jours) (17). Elle pourrait certainement
être réduite, à l’image des études récentes montrant la possi-
bilité de réaliser les hystérectomies par voie cœlioscopique en
ambulatoire (18).
Une amélioration significative de tous les étages du prolapsus
urogénital après la chirurgie est constatée dans notre série.
Aucune patiente ne présente une récidive stade 3 ou 4 après
un mois, et quinze patientes lors de l’évaluation à distance. La
récidive apparaît plus fréquente sur l’étage antérieur. Aucune
récidive de stade 4 n’est constatée au niveau apical ou rectal.
Les résultats anatomiques sont assez variables dans la littéra-
ture allant de 0 à 17 % de récidives selon les études (19, 20). La
cure de prolapsus par cœlioscopie permet d’obtenir de bons
résultats anatomiques qui se maintiennent avec le temps, l’uti-
lisation d’une double prothèse avec fixation sur les muscles
releveurs semble efficace sur la récidive de rectocèle.
Après 40 mois, aucune récidive n’a été constatée et 91 % des
patientes ne décrivent plus de gêne liée au prolapsus à dis-
tance de l’intervention. Ce délai paraît nécessaire pour juger
de l’efficacité d’une cure de prolapsus. Ainsi, 98 % des patientes
se déclarent assez à très satisfaites de leur intervention. Les
résultats fonctionnels ne sont pas strictement superposables
aux résultats anatomiques. Huit patientes présentant un bon
résultat anatomique se déclarent gênées tandis qu’aucune
gêne n’est ressentie par sept patientes présentant une récidive
anatomique. Nous retrouvons dans la littérature de 0 à 38 %
de récidive de la gêne selon les études (15, 16, 21). Higgs et al.
rencontrent le taux le plus fort d’insatisfaction avec 16 %. Mais
le résultat anatomique est satisfaisant dans 94 % des cas. Ainsi,
quatre patientes sur dix ayant un bon résultat anatomique
déclarent ressentir toujours des symptômes de prolapsus (15).
Les complications peropératoires sont assez rares dans notre
étude ainsi que dans la littérature. Le taux de conversion en
laparotomie est très variable, allant de 0 à 11 % selon les étu-
des (20, 21). La lésion des vaisseaux présacrés ou de la veine
iliaque primitive gauche lors de l’abord du promontoire n’est
retrouvée dans aucune série de promontofixation par cœlios-
copie. Une meilleure vision des éléments anatomiques, et en
particulier du promontoire et de ses vaisseaux en cœlioscopie,
permet de limiter le risque de blessure. Une complication spé-
cifique de la cœlioscopie est l’hypercapnie liée à la présence
d’un emphysème sous-cutané. Il est nécessaire d’être prudent
lors de la mise en place et du maintien des trocarts, en particu-
lier lors des gestes longs avec de nombreuses manipulations,
comme la chirurgie du prolapsus.
Le taux de réinterventions en postopératoire immédiat est
faible, sans identification de complications majeures digesti-
ves ou urinaires. Les résultats dans la littérature font état de
peu de complications en postopératoire immédiat également
(16, 19). À distance, les réinterventions sont principalement

La Lettre du Gynécologue - n° 326 - novembre 2007
Dossier
Dossier
36
effectuées pour des problèmes d’incontinence urinaire ou de
remise en tension de la prothèse. Deux complications majeu-
res sont survenues : un cas de spondylodiscite et un cas de
fistule vésicovaginale. Nous n’avons pas retrouvé de facteur de
risque particulier pour ces deux patientes. La spondylodiscite
est une complication connue et rare de la promontofixation.
Par cœlioscopie, quelques cas sont décrits (14, 27, 28).
La promontofixation est décrite avec des techniques différen-
tes en ce qui concernent le niveau de fixation des prothèses, la
présence de deux prothèses ou d’une seule prothèse antérieure
ou postérieure, et l’association à un Burch. Le plus souvent, la
promontofixation est assurée par deux prothèses, une anté-
rieure et une postérieure sur toute la hauteur du vagin avec
fixation sur le fond vaginal et colposuspension de Burch. Il
s’agit de la technique la plus communément décrite par lapa-
rotomie, parfois associée à un geste de myorraphie par voie
basse (22). Les séries présentant une cure de prolapsus par
prothèse antérieure ou postérieure seule présentent des taux
de récidives importants allant jusqu’à 32 % (23, 24).
Dans notre série, une technique de réparation paravaginale est
associée chez quarante patientes. Trois d’entre elles présen-
tent une récidive de cystocèle alors qu’aucune des vingt-qua-
tre patientes ayant bénéficié d’une mise en place de prothèse
dans le Retzius ne présente de récidive de cystocèle. La mise en
place de prothèses dans le Retzius pourrait diminuer le risque
de récidive de cystocèle, en particulier latérale. Il s’agit d’une
hypothèse à confirmer sur une plus large population. Actuel-
lement, la technique est employée de façon systématique dans
le service.
La correction de l’incontinence urinaire d’effort dans notre série
est insuffisante. En préopératoire, 51 % des patientes étaient
incontinentes et 46 % en postopératoire. Il semble qu’il faille trai-
ter préventivement l’incontinence urinaire dans tous les cas, la
fréquence de l’incontinence postopératoire en l’absence de geste
préventif étant très élevée. La promontofixation est connue pour
être un facteur de risque d’échec de la cure d’incontinence uri-
naire par colposuspension (25). Le résultat d’une cure d’incon-
tinence par TVT semble moins influencé par l’association avec
une promontofixation. En cas d’incontinence préopératoire mar-
quée, il semble donc justifié de réaliser un TVT, c’est l’attitude
que nous adoptons actuellement dans le service, la colposuspen-
sion de Burch pouvant garder une place à titre prophylactique ou
dans la réparation du paravagin et de la cystocèle latérale avec
mise en place de prothèse dans l’espace de Retzius. La réalisation
d’une réparation paravaginale ne semble pas être un traitement
satisfaisant de l’incontinence urinaire, elle gêne la réalisation d’un
Burch et en limite l’efficacité.
Une forte proportion de patientes ont des problèmes de
constipation en préopératoire, qui semble peu amélioré par
l’intervention. La cœlioscopie a l”avantage sur le temps posté-
rieur de diminuer le traumatisme de la dissection pararectale,
qui peut être la cause d’une dénervation du rectum et donc de
difficultés d’exonérations par la suite.
Une activité sexuelle peut être conservée, voire améliorée chez
nos patientes. Seize pour cent signalaient une dyspareunie
non consécutive à l’intervention, alors que des taux de dyspa-
reunies de novo postpromontofixation par laparotomie allant
jusqu’à 17,8 % sont notés (26). La promontofixation semble
permettre la conservation d’une activité sexuelle, mais l’ab-
sence de relation entre la chirurgie et la survenue d’une dyspa-
reunie reste à démontrer.
Les érosions vaginales postopératoires sont des complications
bien connues des cures de prolapsus avec la mise en place de
prothèses. Dans notre série, elles concernent 5 % des patien-
tes et sont toutes traitées par parage simple de l’érosion par
voie vaginale avec ablation partielle de la bandelette ainsi
qu’un traitement local à base d’estrogènes pour améliorer la
trophicité. Le risque d’érosion semble influencé par la voie
d’insertion de la prothèse, le taux étant bien supérieur en cas
d’insertion par voie vaginale pour une promontofixation sous
cœlioscopie qu’en cas de voie cœlioscopique exclusive (15).
Le risque d’érosion vaginale pourrait donc bien être limité par
l’utilisation d’une technique évitant l’ouverture vaginale dans le
même temps opératoire que lors de la pose d’une prothèse.
Certains matériaux prothétiques semblent plus augmenter le
risque d’érosion et d’infection que d’autres. Notre taux d’éro-
sion est faible mais notre technique est réalisée sans ouver-
ture vaginale. Nous ne constatons aucune érosion chez les 17
patientes traitées par prothèse de polypropylène mono- ou
multifilament. Toutes nos érosions apparaissent sur prothèse
de polyester multifilament. Dans un article récent, une compa-
raison entre bandelette de polypropylène monofilament (TVT,
Gynecare
®
) et bandelette de polypropylène multifilament (IVS,
Tyco
®
) est rapportée (29). Un taux supérieur d’érosions vagina-
les est constaté dans les cures d’incontinence urinaire d’effort
par prothèse de polypropylène multifilament (10 %) en com-
paraison avec la prothèse de polypropylène monofilament tri-
coté (1 %). La mise en évidence de complications infectieuses
graves ne cesse d’augmenter avec l’apparition de complications
d’abcès de la cuisse, de la vulve ou de cellulite pelvienne après,
entre autres, pose de prothèse transobturatrice (30). Le risque
infectieux semble majoré en cas de pose par voie vaginale, et
le matériel le plus sûre semble être le polypropylène monofila-
ment (31). Il convient donc de rester très prudent lors de l’utili-
sation de matériel prothétique, et en particulier lorsqu’il risque
d’entrer en contact avec un milieu potentiellement contaminant
comme le vagin. L’utilisation d’un treillis monofilament pour-
rait permettre d’éviter la capture des bactéries dans les brins et
de diminuer le risque infectieux.
CONCLUSION
La cœlioscopie semble permettre un traitement efficace du
prolapsus urogénital. Elle permet d’associer les avantages d’une
chirurgie moins invasive et une récupération postopératoire
rapide avec un traitement de référence en laparotomie, efficace
et adapté à la cœlioscopie. La promontofixation sous cœlioscopie
est particulièrement indiquée dans les formes sévères, stades 3 et
4. Peu de complications sont décrites, comme en laparotomie.
 6
6
1
/
6
100%