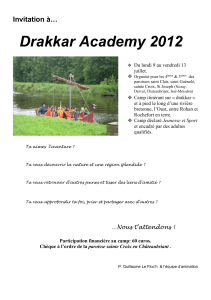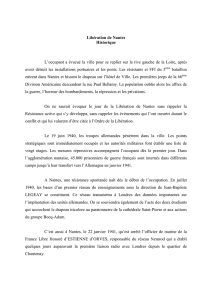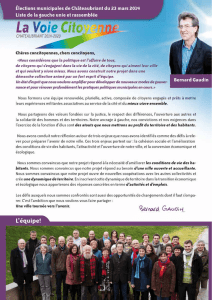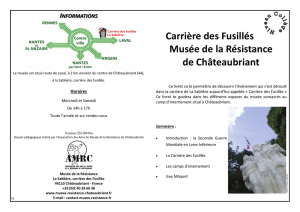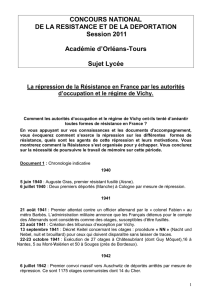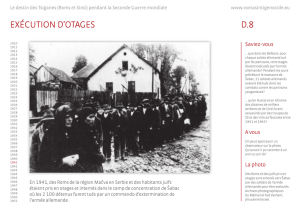Châteaubriant le 22 octobre 1941

LE PATRIOTE RÉSISTANT
N° 916 - février 2017
1010 mémoire
abattus, avec au moins 70 morts. Pour
la Hongrie actuelle, les chires sont de 83
cas sur 281 avions détruits, avec 40 morts,
et l’ensemble de la région fait encore ap-
paraître dans les statistiques un total de
169 aviateurs dont les corps n’ont pas été
retrouvés, et dont un certain nombre ont
certainement été victimes de lynchages.
Personne n’est en mesure de fournir des
chires précis d’ensemble sur les cas de
lynchage commis dans les régions occu-
pées par l’Allemagne nazie, comme sur le
nombre d’aviateurs ainsi assas sinés. Ces
actions, non seulement tolé rées, mais en-
couragées par les autorités nazies, n’étaient
pas forcément mentionnées dans la presse
locale, et tous les témoins n’étaient pas
des participants aux exactions. Plus de
200 cas ont été recensés avec certitude,
mais on estime parfois le total eectif
des morts dans ces conditions entre 300
et 350. L’Institut d’histoire contempo-
raine allemand parle, lui, d’environ 1 000
aviateurs lynchés.
Dans les années d’immédiat après-guerre,
on tenta de juger des coupables. Un tri-
bunal militaire américain jugea à Dachau
dans une relative improvisation quelque
600 accusés dans 200 procès (les accusés
de la région « Alpes-Danube » furent ju-
gés à Salzbourg). On a retenu cinq exécu-
tions, 34 peines d’emprisonnement (entre
quelques mois et la perpétuité) et 24 ac-
quittements. Ici comme ailleurs, les ef-
fets de la guerre froide se rent sentir et
un relatif oubli intervint par la suite. On
compte en Allemagne un certain nombre
de plaques ou de rappels sous une forme
ou une autre des morts violentes d’avia-
teurs alliés (« qui ont perdu la vie de façon
tragique », par exemple à Borkum). En
Autriche, on signale un unique rappel
public, en Hongrie par contre, aucun.
Les nazis avaient été des précurseurs
dans l’utilisation des bombardements
aériens contre des populations civiles.
L’Allemagne a certainement subi sous
les bombes alliées un sort tragique, et
cela d’autant plus que les prémisses
de ces attaques étaient erronées : la
volonté de « tenir » n’a jamais faibli au
sein de la population, et cela, jusqu’à
la défaite terrestre totale. Pourtant la
tentative de détourner le ressentiment
des foules contre les aviateurs abattus,
pour protéger les dirigeants nazis, était
particulièrement vicieuse. Un aveugle-
ment meurtrier et une action criminelle
supplémentaire à mettre au compte du
régime hitlérien.
JeAn-luc bellAnger
(1) Une étude portant sur la région « Alpes-
Danube » chire la responsabilité de ces
catégories à plus de 60 %.
n
Georg HOFFMANN, Fliegerlynchjustiz,
Gewalt gegen abgeschossene alliierte
Flugzeugbesatzungen 1943-1945, (Le lynchage
des aviateurs, La violence contre les équipages
d’avions alliés abattus, 1943-1945), Ed. Ferdinand
Schoeningh, Paderborn, 2015, (non traduit).
- Rappel - Jörg Friedrich, Der Brand, Ed.
Ullstein Heyne List, Munich, 2002 (L'incendie :
l’Allemagne sous les bombes 1940-1945, Ed.
de Fallois, 2004).
Une journée particulière
Châteaubriant
le 22 octobre 1941
Le 22 octobre 1941, 27 résistants, internés et otages sont fusillés à la Sablière à Châteaubriant (Loire-
Atlantique). Depuis, ce site est devenu symbole et lieu de rassemblement. Dans la ferme attenante
transformée en Musée, une exposition temporaire consacrée cette année à la négation de l’homme dans
l’univers concentrationnaire nazi accueille le public jusqu’au 14 octobre 2017. Présentation.
Exposition temporaire
au musée de la Résistance
de Chateaubriant
La ferme est transformée en Musée
dont la gestion et la programmation
est conée aux Amis du Musée de la
Résistance de Châteaubriant. Ouvert
en octobre 2001, il a été conçu et réali-
sé par le Musée de la Résistance natio-
nale (MRN) de Champigny-sur-Marne
(94), appuyé par le Collectif Histoire de
Châteaubriant mêlant résistants, ayants-
droit, enseignants, passionnés d'histoire
de la Résistance et d'histoire de la région.
Musée de site, il présente la vie et les résis-
tances dans le camp de Choisel, évoque
les nombreux camps d'internement, les
otages à travers des collections présen-
tant les objets des internés, comme la
pipe de Jean-Pierre Timbaud ou la va-
lise de Guy Môquet, alternant avec des
photos, des articles de presse, des lettres
et des aches. Une salle est consacrée à
la Résistance en Pays de Châteaubriant.
Présentée actuellement, La négation
de l'homme dans les camps nazis 1933-
1945 est la dixième exposition tempo-
raire créée par les Amis du Musée de
la Résistance de Châteaubriant, travail
réalisé en commun avec le réseau des
Musées de la Résistance.
12 panneaux (cf. page ci-contre) accom-
pagnés d'une cinquantaine d'objets pré-
sente les idées du nazisme – racisme,
exclusion – les premiers camps créés
par Hitler dès 1933 pour y enfermer les
opposants politiques, les dénonciations
des camps en France et en Allemagne
alternent, mettant en valeur images et
textes connus ou inédits. Le transport
des déportés en Allemagne, l'arrivée au
camp dans un système concentration-
naire pensé pour désorienter, déshuma-
niser, le génocide juif sont aussi évoqués,
comme la déportation des enfants. La
vie quotidienne et le travail dans les
camps font l'objet de deux panneaux,
de même que la dénonciation faite par
Marie-Claude Vaillant-Couturier dans ses
articles de presse et ses photos publiées
avant-guerre.
Les sanctions et les jugements contre
les responsables nazis sont au centre
des actes d'accusation lors du procès
de Nuremberg en 1945-1946 qui contri-
buent à une notion nouvelle : le crime
contre l'humanité. Après l'ouverture des
camps en 1945, la réexion sur la nature
des crimes nazis, la capacité à écouter
les témoins apportent des éléments
sur la violence politique et les notions
de reconstruction et de résilience.
lll
L
e 20 octobre 1941 le Feld Kommandant
Karl Hotz est exécuté à Nantes par
un groupe de trois résistants.
Les Allemands décident en représailles
de fusiller 50 otages deux jours plus
tard et le même jour, le 22 octobre 1941,
16 otages sont fusillés à Nantes (44),
5 otages au Mont-Valérien à Suresnes
(92), près de Paris, et 27 autres hommes
à Châteaubriant (44).
L'exécution des 50 otages – en fait 48 –
provoque une immense émotion dans
le pays et dans le monde. La tragédie est
très vite connue par le récit Le témoin des
martyrs rédigé par Louis Aragon, écrit,
imprimé, distribué clandestinement et
diffusé par les radios de Londres et de
Moscou. Le Général de Gaulle au mi-
cro de la BBC depuis Londres propose
un garde-à-vous national le 31 octobre.
L'exécution, une des premières fusillades
collectives en France, a une résonnance
extraordinaire à laquelle les Allemands
ne s'attendaient pas.
Le camp de Choisel
à Châteaubriant
Avant la Seconde Guerre mondiale,
Châteaubriant est une petite ville
bretonne, sous-préfecture de Loire-
Inférieure, dominée par son château,
importante par ses usines de matériel
agricole et sa gare. Au printemps 1940,
la cité vit l'exode de milliers de migrants
avec ses militaires et civils. Avec l'ar-
rivée des troupes allemandes nazies,
45 000 militaires français sont prison-
niers, entassés dans quatre camps, puis
transférés en Allemagne.
Un seul camp y est conservé, le camp de
Choisel, quartier situé à deux kilomètres
du centre-ville de Châteaubriant. Fin
avril 1941, y sont internés les premiers
Résistants : ouvriers des arsenaux, marins
bretons arrêtés comme communistes ou
militants de la CGT. En mai, arrivent les
« Parisiens », 54 puis 100 hommes, tous
communistes, puis 14 gaullistes de la ré-
gion. En septembre, viennent s'ajouter, ve-
nus des prisons parisiennes, 87 hommes
et 46 femmes. En octobre 1941, ils et elles
sont 600 interné(e) s dans les baraques
du camp de Choisel.
C'est en début d'après-midi, le mercre-
di 22 octobre 1941, que les Allemands
réunissent les 27 Résistants-otages dans
la baraque 6, pour leur remettre une
feuille de papier et une enveloppe. Leurs
dernières lettres bouleversantes et d'une
grande humanité seront bientôt connues
de tous, notamment celle écrite pour sa
famille par Guy Môquet, 17 ans.
Aujourd'hui disparu, le camp a fait
l'objet d'une nouvelle sculpture en pierre
inaugurée le 22 octobre 2016 pour se sou-
venir de ce lieu d'enfermement organi-
sé et géré par Vichy, pour y interner les
« Indésirables et terroristes » pendant
l'Occupation.
La sablière-carrière
des fusillés à Châteaubriant
Ce mercredi 22 octobre 1941, le temps
est superbe et c'est jour de marché à
Châteaubriant.
Les 27 internés et otages sont conduits
à la Sablière, située à la sortie de la ville,
à deux kilomètres du centre, pour y être
fusillés. Le sinistre convoi traverse la
ville et les otages, répartis par groupe
de neuf, menottes aux mains, en trois
camions, chantent l'Internationale et la
Marseillaise.
A la carrière les Allemands ont planté
neuf poteaux et 90 soldats allemands
forment le peloton d'exécution, qui se
déroule en trois salves à 15 h 50, 16 h et à
16 h 10. Les otages ont tous refusé d'avoir
les yeux bandés et les mains liées. Ils
meurent en chantant.
Les habitants de Châteaubriant, le len-
demain, malgré les risques de répression,
viennent eurir les lieux d'exécution à la
Sablière. Depuis, chaque année en octobre,
une foule considérable vient perpétuer le
souvenir. Ainsi le 23 octobre 2016, plusieurs
milliers de jeunes et d'anciens, venant de
partout, sont présents pour commémo-
rer le 75e anniversaire des 27 fusillés de
Châteaubriant et armer par leur présence
leur délité à la mémoire de la Résistance.
La Sablière-Carrière des Fusillés, pro-
priété de l'Amicale de Châteaubriant-
Voves-Rouillé-Aincourt (autant de noms
de camps), est aujourd'hui un site histo-
rique classé. L’Amicale en est proprié-
taire depuis 1945. Progressivement, elle
a acquis le terrain et les parcelles avoisi-
nantes, lançant une souscription en 1950,
pour ériger une sculpture monumentale
en pierre, disposer 27 stèles en pourtour du
site an d'informer les visiteurs – 12 000
par an en moyenne – et aménager la ferme
en Musée de la Résistance en 2001.
JeAn-PAul le mAguet
Administrateur au Musée de la Résistance
de Châteaubriant • Membre du Conseil
scientifique du Musée de la Résistance
nationale (MRN) • Conservateur honoraire
du Patrimoine.
lll

LE PATRIOTE RÉSISTANT
N° 916 - février 2017 11
mémoire
C
es cinq responsables, Joseph
Hellenthal né le 1er novembre 1901
à Saint-Ingbert (Sarre), Friedrich
Ochs, né le 25 janvier 1910 à Urloffen
(Bade), Karl Krell, né le 15 février 1906 à
Wriesen sur Oder (Brandenburg), Hans
Pfeffer (parfois écrit Pfeiffer), né le 28 août
1907 à Offenbach, et Rudolf Vetter, né
le 4 janvier 1898 à Vienne, (Hesse), sont
tous membres du Sicherheitsdienst. Ils
seront plus précisément jugés pour « as-
sociation de malfaiteurs », « violences
volontaires préméditées », « violences
volontaires préméditées ayant entraîné
la mort sans intention de la don-
ner », « complicité d’assassinat ».
L’expression « crimes de guerre »
sera parfois prononcée au cours
des audiences.
Le tribunal militaire de Metz
insiste pour dire qu’il ne juge pas la
police allemande dans son ensemble
mais la conduite particulière de
chacun des accusés, « qui a de son
plein gré adhéré à une formation
dont il pouvait se rendre compte que
les méthodes étaient contraires aux
lois et usages de la guerre. » La dé-
fense demande à ce que le tribunal
ait à juger si les faits reprochés sont
couverts ou non par les conventions
internationales, car ces lois « doivent
prévaloir sur toutes les lois internes
même contraires. » Auquel cas les pré-
venus sont innocents pour avoir obéi
à leur hiérarchie. Argument éternel
du coupable : j’ai obéi aux ordres ! Mais
le tribunal réplique qu’il ne juge que la
conduite particulière de l’accusé à son
niveau de responsabilité.
Le 12 juillet 1951, le substitut Maurel
peut commencer l’exposé des faits.
Le Tribunal de Metz situé rue du
Cambou est un ancien Militärgericht,
un bâtiment construit dans le style
néo-renaissance voulu par Guillaume
II du temps de l’occupation allemande
(Metz ayant été intégré dans le Bezirk
Lothringen en 1870, puis dans le Gau
Westmark du III
e
Reich en 1940). Il a
servi alors de prison militaire et de
tribunal. Juste retour des choses, on
l’a utilisé après 1945 pour juger les SS
du camp du Struthof et du camp de
Woippy en Moselle. Cette fois, ce sont
les membres de la Gestapo de Troyes,
restés emprisonnés depuis la Libération.
Après les témoignages et les interro-
gatoires des accusés, le tribunal aura
à répondre à huit-clos à 14 questions
précises concernant les activités de
chaque accusé à Troyes et dans l’Aube.
Enquêtes préliminaires
Dès la Libération, des enquêtes sont
diligentées. Les gendarmes sillonnent le
département pour recueillir des témoi-
gnages concernant les accusés. C’est le
juge de Metz, le Capitaine Bernier qui
leur donne mandat par commission
roga toire, d’enquêter dans le cadre de la
procédure engagée contre « Hellenthal et
consorts, inculpés d’association de mal-
faiteurs. » Les « Services de recherches
des criminels de guerre » font égale-
ment des enquêtes (dont l’interrogatoire
de Maurice Mizelle en mars 1946, qui
semble confondre Hellenthal et d’autres
« Joseph » connus des prisonniers pour
leurs bruta lités à la prison Hennequin,
Joseph Gutmann et Joseph Wetter. On
parle de « Joseph le tueur » à propos de
l’un d’eux). Concernant Ochs, le tribunal
militaire permanent de Paris demande
lui aussi des enquêtes. Les inspecteurs
Despagne, et Adam, le commissaire
Charbonneau agissent donc dans cette
procédure.
On essaie d’abord de cerner les respon-
sabilités pour les plus importants abus
et brigandages attribués à la Gestapo.
3 octobre 1943 : pillage de la maison
Tripogney à Rumilly-lès-Vaudes. Butin
entassé sur trois camions. 14 mars 1944 :
incendie de la maison Rato à Auxon après
son arrestation. 18 mars 1944 : incendie de
la ferme du Perchois à Saint-Phal, gardien
assommé, vol de 24 vaches et d’argent.
27 janvier 1944 : vol de la cave au grenier
dans la maison de M. Herscovici, mé-
decin, à Nogent-sur-Aube. La Gestapo
revint trois fois pour se servir. 12 mai
1944, pillage de la maison de M. Doré
à Luyères. Il fut déporté à Dachau avec
plusieurs personnes. 26 mai 1944 : pillage
et tortures à Chauffour-lès-Bailly chez
M. Hurtault qui en mourut. Wiegand est
présent. 26 juin 1944 : après la mort de
neuf Allemands, ceux-ci se déchaînèrent
au village de la Chaise contre la popula-
tion, tortures, vols, enfermements. Mêmes
scènes à Lavau, Courteranges, La
Chapelle-Saint-Luc, Palis, Marcilly
le Hayer, Landreville, Essoyes et
dans les communes traversées
par les Allemands dans leur fuite.
Des enquêtes eurent lieu à pro-
pos de Montgueux et Creney en
tant que lieux de supplices, de
Rigny la Nonneuse, Saint-Mards
en Othe et Mussy sur Seine, en
tant que maquis attaqués en force,
de Buchères et ses 67 innocents
massacrés. Beaucoup d’aboutirent
pas comme Buchères et Creney,
les criminels n’étant que de pas-
sage, le nécessaire n’a pas été fait
pour les retrouver, au grand dam
des familles.
Des interrogatoires prélimi-
naires de témoins, résistants,
ou personnes ayant fréquenté
les Allemands, avaient eu lieu
dès 1945. Des ouvriers comme
messieurs Lehlin, Hennicker et Gaillard,
peintres travaillant pour l’entreprise
Weber dans les locaux de la Gestapo
indiquèrent « avoir entendu les coups et
les cris et imaginé des scènes de sauva-
gerie ». Le chauffeur Eric Unruh, char-
gé de conduire Vetter et Hellenthal,
2 rue de Preize, pour l’arrestation du
communiste Henri Gillon, abattu par
Ochs alors qu’il tente de s’enfuir, est
également entendu.
Le 4 mai 1949, le Français Henri Jacquet
est « extrait » de la prison de Metz où il
purge une peine de 20 ans de travaux
forcés. C’est le fameux commissaire spé-
cial de la police de sûreté de Reims, déta-
ché pour la lutte anticommuniste, et dont
nombre de résistants ont eu beaucoup à
sourir en particulier Madeleine Billat ou
Eugène Kilian, tabassés par lui au commis-
sariat de Troyes et à Hennequin. Jacquet,
interrogé, répond qu’il ne sait pas grand-
chose et qu’il n’avait pas beaucoup de
rapports avec la Gestapo. Air connu.
Au programme
• Samedi 20 mai - 19h-23h - Nuit euro-
péenne des musées. Projections du docu-
mentaire Un automne 1941 réalisé par
Marc Grangiens en 2006, au Musée de
la Résistance de Châteaubriant.
Journée natio-
nale de la Résistance dans la cour du
Musée de la Résistance de Châteaubriant,
poèmes et chansons de la Résistance et
de la Déportation par le Théâtre Messidor
de Châteaubriant et les élèves du Collège
Robert Schuman et du Lycée Guy Môquet
à Châteaubriant.
– 14h-18h – Journées européennes du
patrimoine. Entrée libre et gratuite
Le site internet, mis à jour en perma-
nence, permet une consultation com-
plète sur la Carrière, le Musée et ses
contenus, les collections et les événe-
ments s'y déroulant, les expositions iti-
nérantes qui peuvent être prêtées aux
scolaires, centres culturels, comités d'éta-
blissement, municipalités, musées et
biblio thèques.
Des documents y sont téléchargeables
comme les dossiers pédagogiques :
primaire, collège et lycée.
n Contact :
Musée de la Résistance.
La Sablière-Carrière des Fusillés
44 110 Châteaubriant.
Tél. : 02 40 28 60 36.
Courriel : contact.musee.resistance
@orange.fr • www.musee-resistance-
chateaubriant.fr (Oce de Tourisme.
Tél. : 02 40 28 20 90)
Le procès
de la Gestapo de Troyes
2e partie : Metz 1951-1952
Le tribunal de Nuremberg, réuni de novembre 1945 à octobre 1946, jugea et condamna 24 principaux
responsables nazis pour « complot, crimes de guerre et crimes contre l’humanité ». Cinq des chefs de la
Gestapo de Troyes comparurent à Metz entre le 12 juillet 1951 et le 25 juillet 1952. Récit.
Un des 12 panneaux installés
pour l'exposition temporaire
créée par les Amis du Musée
de la Résistance
de Châteaubriant.
lll
Titre de Libération-Champagne, le
15 décembre 1948, lors de la pré-enquête.
1
/
2
100%